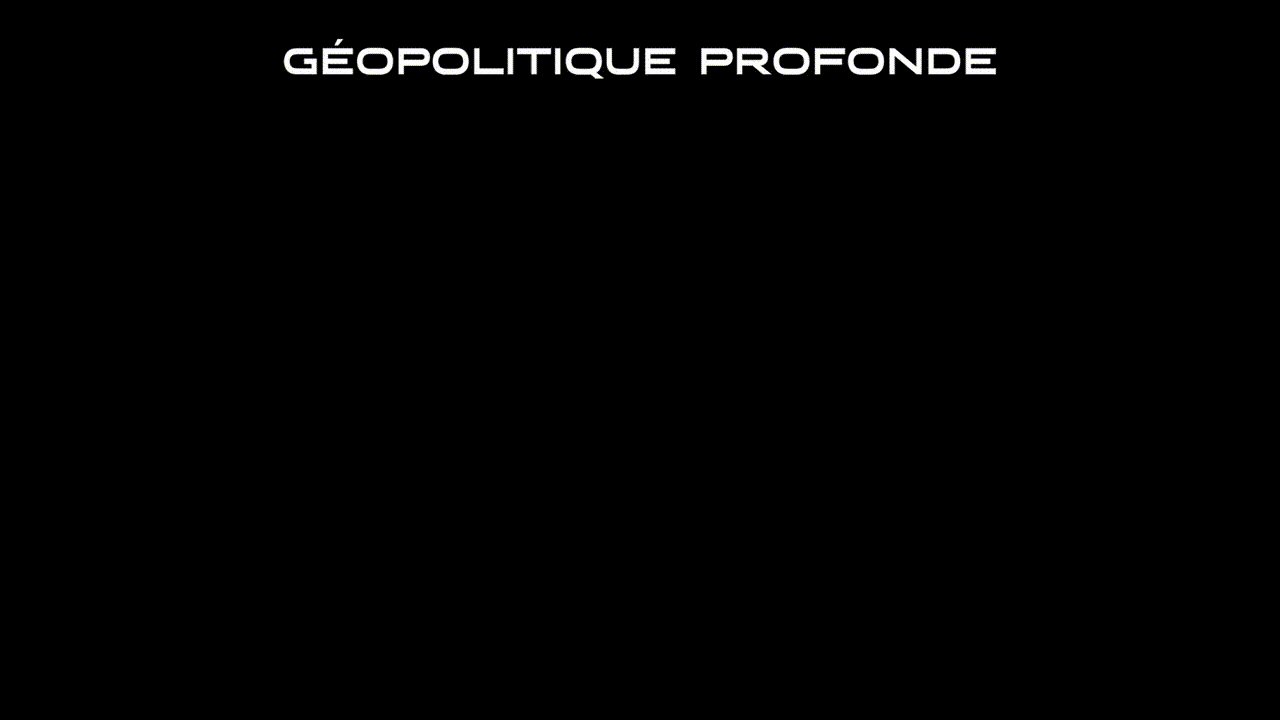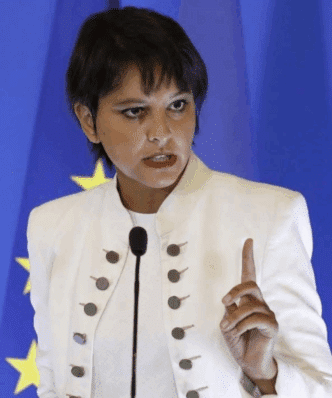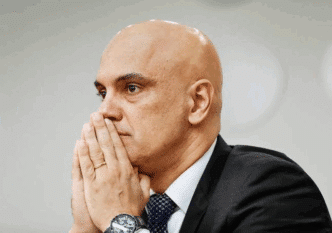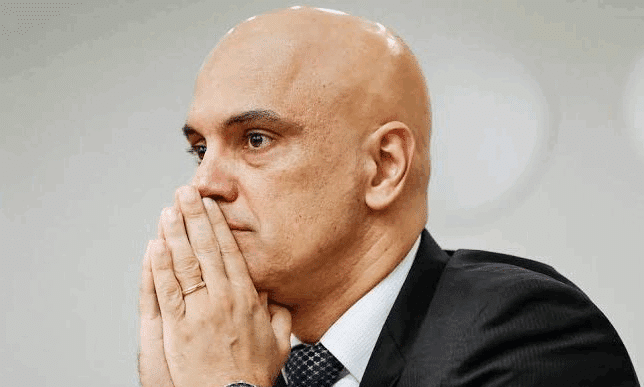🔥 Les essentiels de cette actualité
- En 2023, 42 millions de travailleurs européens n’avaient pas les moyens de partir une semaine en vacances, révélant une fracture sociale croissante.
- Les quatre grandes puissances économiques de l’UE comptaient chacune plus de 5 millions de salariés privés de vacances, malgré leurs discours sur la croissance.
- La situation est encore plus alarmante en Europe de l’Est et du Sud, avec des taux de privation atteignant jusqu’à 32 % en Roumanie.
- La précarité s’aggrave année après année, avec une hausse de plus d’un million de travailleurs concernés entre 2022 et 2023.
Pendant que les élites européennes discutent relance, croissance et pactes budgétaires, des dizaines de millions de travailleurs n’ont toujours pas accès à un droit aussi basique qu’une semaine de repos hors de chez eux.
Les dernières données disponibles d’Eurostat et relayées par la Confédération européenne des syndicats (CES), sont implacables : en 2023, 15 % des salariés de l’UE, soit 42 millions de personnes, n’avaient pas les moyens de partir une semaine en vacances.
Ce chiffre en dit long sur l’état réel du modèle social européen. Deux ans plus tard, rien ne permet d’imaginer une amélioration : les gouvernements n’ont pas bougé, la précarité s’est enracinée, les écarts se sont creusés.
5 millions de travailleurs sans vacances dans chaque « grande puissance » européenne
On pourrait croire que seules les économies les plus fragiles sont concernées, mais ce n’est pas le cas.
En 2023, les quatre plus grandes puissances économiques de l’Union européenne — l’Allemagne, la France, l’Espagne et l’Italie — affichaient chacune des niveaux de précarité alarmants. L’Italie comptait 6,2 millions de salariés privés de vacances, suivie de près par l’Allemagne avec 5,8 millions, l’Espagne avec 5,6 millions et la France avec 5,1 millions.
Ces pays brassent des milliards, alimentent les grands discours européens sur la croissance et la compétitivité, mais une part massive de leur population active n’a même pas les moyens de se reposer une semaine par an.

Une fracture Est-Ouest qui ne se referme pas
En Europe de l’Est et du Sud, la situation est encore plus brutale.
Toujours en 2023, la Roumanie détenait le triste record avec 32 % de travailleurs privés de vacances. La Hongrie suivait avec 26 %, la Bulgarie atteignait 24 %, tandis que le Portugal et Chypre affichaient chacun 23 %. En Slovaquie, ils étaient 22 % à ne pas pouvoir s’offrir une semaine de repos.
À l’opposé, dans les pays nordiques ou dans les bastions économiques comme les Pays-Bas, le Luxembourg ou la Slovénie, les taux de privation tournaient entre 5 % et 7 %. Quant à l’Autriche, la Tchéquie et la Belgique, elles restaient juste en dessous des 10 %.
Une « Union » européenne ? Oui. Mais manifestement, pas pour tout le monde.

2023 : la troisième année consécutive d’aggravation
La pauvreté des vacances chez les travailleurs n’a cessé d’augmenter.
En 2022, on comptait déjà 40,5 millions de salariés concernés. En 2023, ce chiffre est monté à 41,5 millions. Une hausse de plus d’un million en une seule année. La proportion est passée de 14 % à 15 %. Le tout, dans un silence médiatique assourdissant.
La CES dénonce une réalité qu’on préfère étouffer :
« Ces résultats sont le résultat d’une économie de plus en plus inégalitaire, dans laquelle les travailleurs sont contraints de renoncer à leurs vacances en raison de la hausse des coûts du logement, du transport et de la nourriture, combinée à une baisse du pouvoir d’achat et à la spéculation. »

Revenu et accès aux vacances : l’injustice persiste
On pourrait croire que tout est une question de niveau de vie. Ce serait trop simple.
Il y a bien une corrélation entre revenu net annuel et accès aux vacances, mais elle est modérée. En clair : le revenu compte, mais il n’explique pas tout.
L’exemple de l’Irlande est frappant : avec un revenu net annuel de 43 897 € en 2023, l’un des plus élevés d’Europe, le pays connaît encore un niveau élevé de précarité en matière de congés.
À l’inverse, la Slovénie s’en sort bien, malgré un revenu modeste. Ce n’est donc pas seulement une question de salaires, mais aussi de politiques sociales, de choix collectifs. Et de priorités.
Quand les travailleurs trinquent, l’Europe applaudit ses marchés
La CES attribue cette précarité grandissante à plusieurs facteurs : la hausse du coût de la vie, la stagnation des salaires, la baisse du pouvoir d’achat et la spéculation.
Ces éléments aggravent les inégalités, dans un contexte où les grandes fortunes ne cessent de croître, et où le « dialogue social » peine à produire des effets concrets.
Face à cette situation, la confédérantion demande la mise en œuvre stricte de la directive européenne sur le salaire minimum, l’introduction de conditions sociales pour accéder aux marchés publics – en particulier le respect des négociations collectives – ainsi qu’une législation européenne garantissant des emplois de qualité.
Selon sa secrétaire générale, Esther Lynch :
« Ces chiffres montrent que l’Europe est confrontée à une urgence en matière d’emplois de qualité et que notre contrat social continue de s’effriter en raison des inégalités économiques croissantes. »
On voit bien où sont les vraies priorités de l’UE
Pendant que des millions de travailleurs n’ont toujours pas accès à une simple semaine de repos, l’UE s’aligne sur un autre agenda : celui de la défense.
En 2025, la Commission propose un budget record pour 2028-2034, qui s’élève à 2 000 milliards d’euros, avec un financement multiplié par cinq dédié à la défense et à l’espace, ainsi qu’un fonds de 100 milliards d’euros pour la reconstruction de l’Ukraine.
Tous ces efforts répondent à un objectif clair : atteindre 5 % du PIB européen consacré à la défense d’ici 2035.
On arrose donc l’industrie militaire et la guerre en Ukraine à coups de centaines de milliards, tandis que l’Europe sociale creuse sa propre tombe.
Les marchés et l’armement passent avant les besoins fondamentaux : repos, bien-être, stabilité économique.
Ce choix de société en dit long. Il révèle une Europe prête à s’armer et à reconstruire ailleurs, mais qui oublie ses obligations envers ses propres citoyens.
IMPORTANT - À lire
Pendant que l'Europe s'enfonce dans les inégalités, la précarité et les priorités militaires, notre revue approfondit chaque mois les enjeux sociaux et géopolitiques. Analyses détaillées, regards critiques et perspectives alternatives pour mieux comprendre les défis de notre temps.
Ne manquez pas nos dossiers exclusifs et nos enquêtes de terrain. Abonnez-vous à notre revue papier et plongez au cœur de l'actualité avec des analyses approfondies que vous ne trouverez nulle part ailleurs. La qualité d'une revue indépendante, directement dans votre boîte aux lettres.