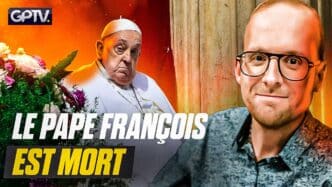🔥 Les essentiels de cette actualité
- Le pape François nous a quittés à 88 ans après une lutte contre la maladie.
- Le premier pape sud-américain et jésuite a bousculé les traditions et prôné une Église plus proche des pauvres.
- Sa gestion controversée a divisé les fidèles, certains saluant sa modernité, d’autres déplorant une trahison des valeurs fondamentales.
- Engagé socialement et écologiquement, François a aussi tenté de réformer l’Église face aux scandales de pédocriminalité et aux magouilles financières.
Un chapitre de l’histoire catholique vient de se clore. Le pape François nous a quittés ce lundi 21 avril au matin, à 88 ans, d’après l’annonce du Vatican. Le Saint-Père avait été admis à l’hôpital romain mi-février pour soigner une bronchite tenace.
La santé du pontife argentin s’était considérablement détériorée ces dernières années. Fini le temps où il pouvait se déplacer librement parmi les fidèles. Depuis 2022, ce n’était plus qu’avec une canne ou dans un fauteuil roulant qu’on le voyait apparaître – image poignante d’un homme diminué physiquement mais dont l’esprit restait vif.
François a enchaîné les problèmes médicaux : son genou lui faisait souffrir le martyre, sa hanche n’allait guère mieux. Sans parler de cette inflammation du côlon qui l’avait déjà beaucoup affaibli. Les médecins avaient même dû l’opérer d’une hernie, compliquant encore son quotidien au Vatican.
Cet homme, qui avait promis de renouveler l’Église et de la rapprocher des plus pauvres, aura finalement cédé à la maladie après un combat silencieux. Les fidèles se rappelleront sa simplicité et son franc-parler qui tranchaient souvent avec le protocole rigide du Saint-Siège.
Les défis de l’avenir pour l’Église catholique
Les prochains jours s’annoncent décisifs pour l’avenir de l’Église catholique, qui devra choisir un nouveau guide spirituel dans un monde où les valeurs traditionnelles semblent de plus en plus menacées.
Durant ses douze années à la tête de l’Église, François a fait trembler les murs du Vatican. Premier pape sud-américain et jésuite de l’histoire, il a pris le contrepied de ses prédécesseurs conservateurs, Benoît XVI et Jean-Paul II. Face à une institution en plein déclin, le Saint-Père argentin n’a pas hésité à bousculer les traditions et à secouer la poussière des tapis.
Les fidèles traditionalistes lui reprochent d’ailleurs cette approche parfois trop progressiste. Certains y voient même une trahison des valeurs fondamentales de l’Église, tandis que d’autres saluent sa volonté de moderniser une institution vieillissante.
Faut-il voir dans sa gestion controversée un signe des temps ? Alors que l’Occident subit une crise des valeurs sans précédent, François tente d’adapter l’Église plutôt que de résister à la tempête. Une stratégie qui divise profondément les catholiques à travers le monde.
Un pape inattendu venu des périphéries
Des banlieues oubliées de Buenos Aires aux dorures du Vatican, qui aurait parié sur un tel destin ?
« Il semble que les cardinaux sont allés me chercher au bout du monde », lance avec humilité le pape François à la foule venue l’acclamer ce fameux soir du 13 mars 2013.
Jorge Mario Bergoglio, ce jésuite argentin qu’on n’attendait pas, venait de créer la surprise. Il fallait voir la tête des habitués du sérail romain quand cet outsider a décroché la tiare ! L’ancien archevêque de Buenos Aires n’avait jamais fait partie du petit club des prélats qui tournent autour du Saint-Siège comme des satellites.
Ce soir-là, au balcon de Saint-Pierre, tous ont été frappés par sa simplicité désarmante. Pas de manteau d’hermine, pas de mozette rouge, rien des atours traditionnels. Juste une soutane blanche, sans fioritures. Un pape qui refuse d’emblée le clinquant du Vatican, vous imaginez le choc pour l’establishment ?
C’est qu’il vient du terrain, lui. Des quartiers où la misère n’est pas un concept théologique mais une réalité quotidienne. François connaît la boue des bidonvilles mieux que les marbres pontificaux. Son élection ressemblait presque à une révolution silencieuse dans une institution millénaire.
Entre les fastes du Vatican et les paroisses délabrées d’Amérique latine, le contraste était saisissant. Comme si l’Église, pour une fois, avait choisi de regarder vers ses périphéries plutôt que vers son centre. Les fidèles rassemblés ce soir-là ne s’y sont pas trompés : quelque chose de profond venait de changer dans l’ordre catholique mondial.
Les origines et le parcours de Jorge Mario Bergoglio
Jorge Mario Bergoglio naît le 17 décembre 1936 à Buenos Aires, de parents italiens. Sa vie se déroule principalement en Argentine, pays qui façonnera son parcours religieux.
C’est en 1958 qu’il embrasse la vie religieuse, rejoignant les jésuites comme novice. Avant ça ? Un jeune homme ordinaire avec des rêves ordinaires : il a une petite amie prénommée Amalia et envisage sérieusement de se marier. Mais voilà, un jour, dans l’intimité d’un confessionnal, la révélation le frappe et bouleverse tous ses projets.

Les années passent, Jorge prononce ses vœux définitifs. Devenu prêtre, il grimpe progressivement dans la hiérarchie de sa congrégation. Sa carrière prend de l’ampleur.
Le contexte politique argentin se tend dangereusement. En 1976, un coup d’État secoue le pays : le général Jorge Rafael Videla renverse la présidente Isabel Perón. À cette époque troublée, Bergoglio n’est pas n’importe qui dans l’Église – il occupe déjà le poste stratégique de supérieur provincial des jésuites de Buenos Aires. Une position d’influence au moment même où l’Argentine bascule dans l’une des dictatures les plus sanglantes d’Amérique latine.
Ce début de carrière, dans l’ombre d’un régime autoritaire, marquera profondément l’homme qui deviendra plus tard le chef de l’Église catholique.
Le retour en Argentine et l’engagement social
C’est en exil forcé que Jorge Mario Bergoglio avait pris ses distances avec l’Argentine, à la suite de la dictature. Mais il était revenu dans son pays natal, où il s’était vite imposé comme une figure populaire. Difficile de résister à ce prélat aux yeux malicieux, au sourire chaleureux et à la décontraction rare dans les hautes sphères religieuses.
« Ce n’était pas un bureaucrate en soutane, mais un homme profondément spirituel, humain, les pieds sur terre », dit la journaliste argentine Elisabetta Piqué, autrice de sa biographie.
Devenu archevêque en 1998, puis cardinal en 2001, Bergoglio avait conservé une simplicité remarquable. On le voyait encore dans les bus de Buenos Aires, se rendant sans escorte dans les quartiers pauvres pour rencontrer les oubliés.
Déjà, il incarnait une Église des actes, loin des élites et des discours vides. Il parlait aux fidèles ordinaires, ceux que beaucoup de structures avaient abandonnés.
Durant la crise économique argentine (1998-2010), il avait vu la misère de près. Ce vécu avait forgé sa haine des inégalités. Frédéric Mounier l’a bien raconté dans Le pape qui voulait changer l’Église.

Lorsqu’il fut nommé cardinal, il demanda à ses proches de ne pas venir à Rome et d’utiliser leur argent pour les pauvres. Une attitude en rupture avec les privilèges habituels.
Élu pape, il choisit le nom de François, en hommage à saint François d’Assise. Un geste fort, inspiré par les mots qu’un évêque lui glissa à l’oreille : « N’oublie pas les pauvres. »
Dès le premier jour, ce nom résuma sa ligne : une Église proche des petits, loin du faste. À une époque où les élites cumulaient richesses et promesses non tenues, il incarna une autre voie.
Engagement face aux crises mondiales
Le pape François, dès ses premiers jours au Vatican, s’est mis à dos l’establishment en abordant sans détour la crise migratoire européenne. C’était presque trop évident, mais trop impoli pour que les autres le disent.
Quand il a posé le pied à Lampedusa en 2013, puis à Lesbos deux ans plus tard, le pape n’y allait pas pour se faire photographier avec des réfugiés. Il y allait pour pointer du doigt ce qu’il appelle la « mondialisation de l’indifférence ». Devant les élites internationales, il n’a pas peur de remuer le couteau dans la plaie.
Il rappelait constamment aux pays occidentaux qu’ils ont des racines chrétiennes, comme si nous avions besoin qu’on nous le rappelle. Mais ce qui dérange bien davantage les dirigeants, c’est quand il leur parlait de leur « vocation à la charité ». Ça fait moins plaisir à entendre quand on gère des frontières.
Les années ont passé mais François n’a pas changé. Face au retour de Trump à la Maison Blanche et ses projets d’expulsions massives, le pape s’était encore dressé contre. Du jamais vu pour un chef de l’Église qui ne craignait apparemment pas de froisser le dirigeant le plus puissant du monde.
Et quand il qualifiait de « cruauté » la guerre à Gaza, on peut dire qu’il n’épargnait personne. Là où d’autres religieux restent silencieux ou parlent à mots couverts, François frappait fort. Trop fort pour certains qui préféreraient un pape plus docile, moins dérangeant pour l’ordre établi.
La réforme de l’Église
Depuis son élection, le pape François s’était lancé dans une bataille contre les vieux démons qui hantaient l’Église. Les scandales de pédocriminalité et les magouilles financières avaient transformé le Vatican en champ de ruines sous Benoît XVI – difficile de ne pas y voir un signe de la décadence occidentale qui touchait même les plus hautes sphères spirituelles.
François avait retroussé ses manches dès son arrivée, bien décidé à secouer la poussière qui s’était accumulée sur les dorures vaticanes. Pas question pour lui de se laisser engluer dans cette Curie romaine paralysée par des siècles d’habitudes et de petits arrangements entre amis. Les cardinaux en costume de soie avaient dû s’accrocher à leur chapeau quand il avait commencé à mettre son nez dans les comptes.

Les finances du Saint-Siège, ce n’était pas triste ! Un vrai panier de crabes où l’argent des fidèles partait dans des circuits aussi opaques que douteux. François n’avait pas fait dans la dentelle, lui qui préférait une « Église pauvre pour les pauvres » plutôt qu’une banque du Vatican qui jouait à la spéculation comme les grands de ce monde.
Mais le vrai défi restait cette institution millénaire qui résistait au changement comme un vieil arbre dont les racines plongeaient trop profond. Combien de temps cette volonté réformatrice allait-elle tenir face aux résistances internes ? Car les conservateurs du Vatican n’avaient pas dit leur dernier mot, et chacune des initiatives du pape argentin faisait grincer des dents dans les couloirs feutrés de la cité papale.
Un pontificat « audacieux »
Au fond, la vraie question était de savoir si cette Église, minée de l’intérieur par ses propres contradictions, allait pouvoir retrouver sa crédibilité auprès des fidèles. Les scandales avaient laissé des traces, et la confiance perdue ne se regagnait pas d’un coup de baguette magique, même avec la bonne volonté d’un pape venu « du bout du monde ».
François ne mâchait pas ses mots. En 2014, il balançait aux cardinaux de la Curie un sermon qui décoiffait. Il y dénonçait sans détour « l’Alzheimer spirituel », ces petits arrangements qu’on fait avec sa conscience, « le terrorisme des bavardages » qui gangrène l’institution, et même la « schizophrénie existentielle » qui menaçait les hauts dignitaires. Du jamais vu !
Ce pape détonnait dans le paysage. À tel point que Frédéric Mounier n’hésitait pas à écrire dans son bouquin : « Certains voient en François le Gorbatchev de l’Église catholique. » La comparaison faisait froid dans le dos quand on savait comment avait fini l’URSS…
On pouvait se demander si ce pontife argentin n’était pas trop radical dans sa volonté de moderniser l’Église. Ses prédécesseurs y allaient plus doucement. Lui, il fracassait les traditions comme on casse une vitre.
François divisait. D’un côté, les catholiques traditionalistes qui le trouvaient trop progressiste. De l’autre, ceux qui applaudissaient son franc-parler. Un peu comme nos politiciens : ils promettent de tout changer… puis finissent par nous décevoir.
Une vision sociale et écologique
Doctrinalement, ce pape tranchait avec ses prédécesseurs. Il osait critiquer les dégâts causés par le néolibéralisme et militait pour davantage de justice sociale. Il s’aventurait même sur le terrain écolo, prônant une meilleure protection de l’environnement. Mais la vraie rupture, c’était son souhait de voir l’Église sortir enfin de son obsession pour la morale sexuelle.
« On ne peut pas insister seulement sur les questions liées à l’avortement, au mariage homosexuel et à l’utilisation de méthodes contraceptives », avait-il déclaré sans ambages.
Une phrase qui avait fait l’effet d’une bombe dans certains cercles traditionalistes.
Cette volonté de recentrer les débats avait provoqué un tollé chez les conservateurs. Certains y voyaient une trahison des valeurs fondamentales de l’Église, tandis que d’autres saluaient ce pragmatisme qui pouvait reconnecter l’institution avec une société en pleine mutation.
Ce tournant, bien que modéré, pourrait avoir marqué un changement profond dans la façon dont l’Église abordait les problèmes contemporains. Restait à voir si ces belles paroles seraient suivies d’actes concrets, ou si, comme tant d’autres promesses venues d’en haut, elles s’évanouiraient face aux résistances internes.
Les défis du dialogue interreligieux
Malgré son aura progressiste comparé à Benoît XVI, le pape François était resté un gardien inflexible de certains dogmes. Pas question pour lui de redéfinir le mariage, qu’il considérait toujours comme une alliance sacrée entre un homme et une femme.
François jonglait maladroitement avec les contradictions sur l’homosexualité. D’un côté, il assurait que ce n’était « pas un crime » mais de l’autre, il persistait à la qualifier de « péché ». Un pas en avant, deux en arrière : une valse bien connue dans l’Église.

Concernant l’avortement, il ne mâchait pas ses mots non plus, osant une comparaison brutale avec « l’action d’un tueur à gages ». Derrière les sourires et les selfies, le fond du message restait profondément conservateur.
Ce souverain pontife incarnait le grand écart permanent de son époque : moderne dans sa communication, mais enraciné dans des positions morales traditionnelles. Un paradoxe qui avait déçu ceux qui espéraient une véritable évolution doctrinale.
Durant son pontificat, François avait œuvré pour le dialogue entre religions, avec une attention particulière portée à l’islam. Fait marquant : sa visite historique en Irak, première d’un pape dans ce pays martyrisé par les conflits. Un geste fort, courageux, hautement symbolique.
Parallèlement, il tentait un rapprochement avec l’Église orthodoxe, multipliant les gestes fraternels. Mais la guerre en Ukraine était venue balayer ces efforts. Le soutien affiché du patriarche Kirill à Poutine avait refroidi les espoirs du Vatican.
Une preuve supplémentaire que les grandes manœuvres spirituelles pèsent peu face aux intérêts géopolitiques. Et malgré les appels du pape à la paix, sa voix résonnait souvent bien faiblement dans le vacarme des armes.
Face au scandale des prêtres pédocriminels, François avait levé le secret pontifical et imposé de signaler les cas. Mais pour de nombreuses victimes, ce n’était pas suffisant. Elles attendaient des actes plus radicaux.
La mort du pape François marque la fin d’un pontificat résolument tourné vers les marges, les pauvres et les exclus. Son héritage spirituel, politique et social continuera de faire débat, mais une chose est sûre : le « pape du peuple » aura imprimé une marque indélébile sur l’Église catholique moderne.
Alors que le conclave s’apprête à choisir son successeur, une nouvelle page s’ouvre dans l’histoire de la papauté.
IMPORTANT - À lire
Vous avez aimé cet article sur le pape François et son impact sur l'Église catholique ? Notre revue papier mensuelle approfondit ces sujets passionnants. Chaque mois, nous analysons les grands enjeux religieux, sociaux et géopolitiques qui façonnent notre monde, avec un regard unique et pertinent.
Plongez au cœur de l'actualité mondiale avec nos dossiers fouillés, nos interviews exclusives et nos analyses pointues. Découvrez les dessous des crises internationales, les mutations profondes de nos sociétés et les défis majeurs auxquels sont confrontées les grandes religions. Notre revue est un must pour tous ceux qui veulent comprendre le monde d'aujourd'hui !