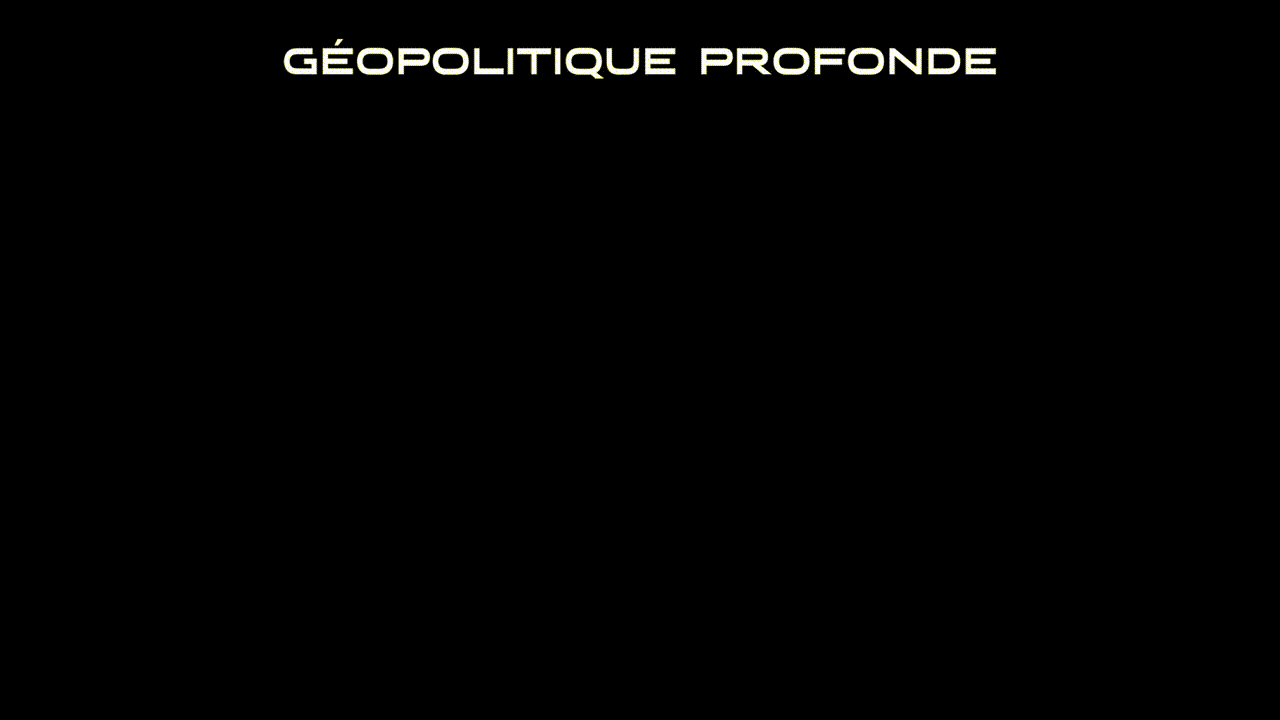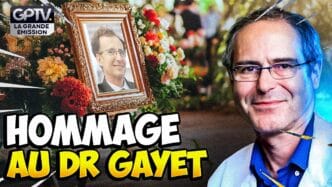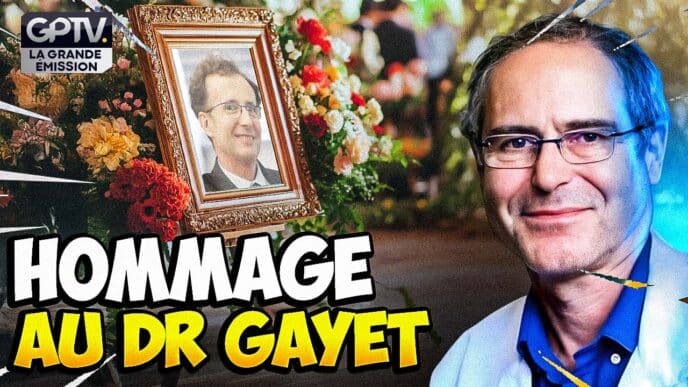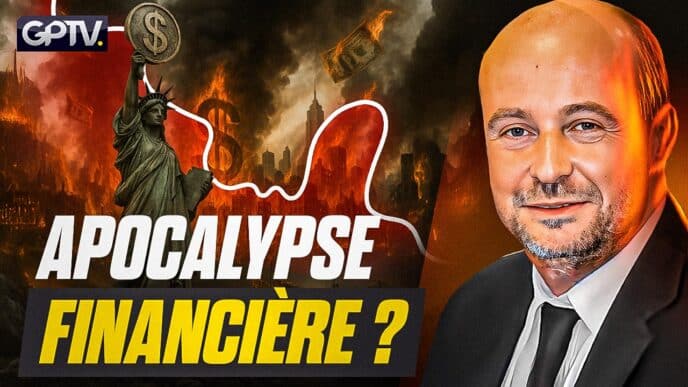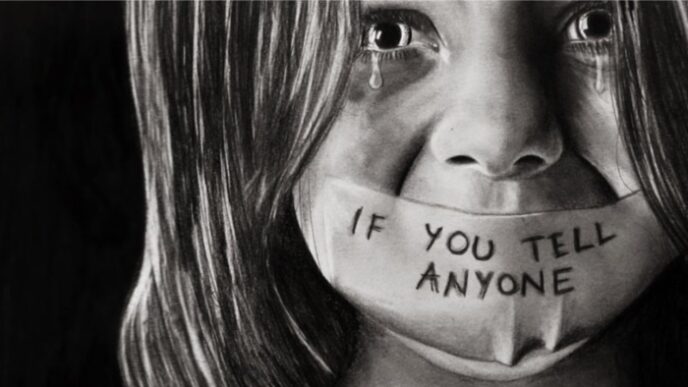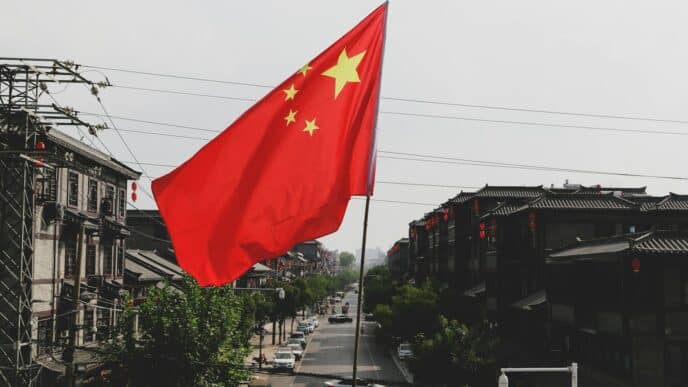L’ancien Premier ministre Dominique de Villepin tente un retour remarqué dans le débat intellectuel et politique avec un essai publié dans la revue Le Grand Continent, intitulé Le pouvoir de dire non. Un texte d’une soixantaine de pages où il prétend décrypter la « nouvelle équation impériale » du monde, tout en ressassant les mêmes obsessions élitistes, éloignées des préoccupations concrètes des Français.
Sous des allures de réflexion, Villepin ne fait en réalité que recycler un discours éculé, à mille lieues des réalités sociales et économiques qui minent nos sociétés. Son texte, à peine voilé d’intellectualisme, n’est ni un diagnostic lucide ni une proposition concrète : c’est une tribune creuse, destinée à flatter les cercles de pouvoir et à tester les eaux en vue d’un éventuel retour politique.
Une obsession : Trump, encore et toujours
Dès les premières lignes de son essai, Dominique de Villepin sonne l’alerte contre… Donald Trump. Selon lui, l’ancien président américain constituerait une « emprise idéologique » dangereuse pour l’Europe. Il accuse Trump de séduire les dirigeants européens qui osent s’inspirer de son discours. Autrement dit, il réactive l’épouvantail favori des élites mondialisées : le populisme à l’américaine.
Ce discours n’est pas nouveau. Mais il révèle une chose : l’obsession maladive de l’establishment français pour un homme qui a eu le tort de dire non aux dogmes du globalisme. Plutôt que de s’interroger sur les raisons profondes du succès de Trump ou de Viktor Orbán, Villepin préfère les condamner avec condescendance. Comme si les peuples qui les ont élus ne méritaient que le mépris de leur ancien ministre.
Pourtant, lui-même l’écrit noir sur blanc : « Trump n’est pas la maladie du monde, il en est le symptôme. » Mais aussitôt ce constat posé, Villepin retombe dans ses travers : il consacre l’essentiel de son propos à dénoncer les symptômes, jamais à interroger les causes.

Une élite qui parle d’en haut
Dominique de Villepin a toujours cultivé une image d’intellectuel raffiné, de diplomate cultivé, de poète engagé. Mais cette posture, flatteuse pour les salons parisiens, se révèle profondément déconnectée des aspirations populaires. Dans cet essai comme dans ses précédentes prises de parole, il affiche une incompréhension totale des colères sociales, des inquiétudes identitaires, et du besoin de souveraineté exprimé un peu partout en Europe.
Son appel à un « nouveau multilatéralisme » sonne creux à une époque où les peuples veulent retrouver le contrôle de leurs frontières, de leurs lois, de leur économie. Loin de se remettre en question, Villepin s’enferme dans le confort de ses convictions mondialistes, comme si l’Histoire ne lui avait rien appris.
Il critique l’« illimétisme » américain, ce mythe de croissance infinie et d’exceptionnalisme, mais feint d’ignorer que la France aussi a sombré dans un déni profond, sous l’effet des mêmes élites dont il fut l’un des piliers. De quelle autorité peut-il aujourd’hui donner des leçons, lui qui fut l’un des artisans du système qu’il prétend désormais critiquer à demi-mot ?
Un discours qui camoufle une ambition
Ce qui frappe à la lecture de son texte, c’est l’ambiguïté permanente. Villepin critique, alerte, théorise… mais ne propose rien de concret. Tout est suggestion, posture, esquive. Sauf sur un point : la mise en scène savamment orchestrée de son propre rôle d’ »ancien sage » qui reviendrait éclairer la République.
Derrière les métaphores géopolitiques, les références historiques et les analyses abstraites, se dessine clairement le profil d’un homme qui veut revenir. Villepin se pose en visionnaire, en stratège détaché, mais tout dans sa démarche laisse penser qu’il teste à nouveau sa cote auprès des élites politico-médiatiques. Une méthode bien connue : publier un essai, multiplier les entretiens, sonder les éditorialistes… et préparer le terrain pour 2027.
Officiellement, il affirme n’avoir aucun contact avec Édouard Philippe ou Bruno Retailleau. Il jure qu’il ne nourrit aucune ambition personnelle. Mais cette fausse modestie, cette rhétorique du « je n’y pense pas », est trop bien rodée pour n’être qu’une coïncidence.
Une vision floue et dépassée du monde
En parlant de « nouvelle équation impériale », Villepin se rêve en déchiffreur du chaos mondial. Mais son analyse repose sur une vision étrangement datée. Il décrit une Amérique qui s’effondre, un monde qui bascule, un système qui se désagrège. Soit. Mais à aucun moment il n’aborde les sujets concrets qui préoccupent les Français : désindustrialisation, insécurité, immigration incontrôlée, perte de souveraineté énergétique, etc.
Ce refus de nommer les problèmes – ou d’y apporter des réponses – trahit le malaise de toute une génération politique. Villepin incarne cette droite molle, intellectuelle, qui préfère disserter sur les cycles de l’Histoire plutôt que d’affronter les enjeux immédiats.
Et pendant ce temps, le peuple trinque. Tandis que lui sirote un café noir dans un bistrot de Saint-Germain-des-Prés, la France périphérique étouffe, la classe moyenne s’effondre, et les jeunes fuient un avenir bouché.

Une manœuvre politique qui ne dit pas son nom
Ce texte n’est pas un cri du cœur, ni un sursaut républicain. C’est une manœuvre politique habillée d’un vernis intellectuel. Dominique de Villepin tente de réactiver son image d’homme d’État pour mieux revenir dans le jeu. Il se présente comme une conscience lucide face au déclin, mais il n’est qu’un acteur de plus dans ce théâtre fatigué de la politique française.
Et ce qui le rend encore plus inaudible, c’est qu’il continue de parler comme si rien n’avait changé. Comme si le monde d’avant – celui de l’ONU triomphante, du multilatéralisme béat, et de la souveraineté diluée – pouvait encore être sauvé. Or les peuples, eux, ont compris que ce modèle était mort. Ils cherchent autre chose : une rupture, un cap, une vraie refondation.
Conclusion : le crépuscule d’une figure du passé
Dominique de Villepin aurait pu se taire, laisser derrière lui le souvenir d’un homme qui a dit non à la guerre en Irak. Mais il a préféré revenir, écrire, parler, juger. Et ce faisant, il révèle sa vraie nature : celle d’un homme de l’ancien monde, incapable de comprendre celui qui vient.
Son essai est un miroir tendu à une élite qui refuse de se voir. Une tentative désespérée de reprendre la main, mais sans jamais sortir de sa zone de confort. Il parle d’avenir, mais regarde dans le rétroviseur. Il parle au nom de l’Europe, mais oublie les peuples. Il dénonce les dérives du monde, mais refuse d’assumer sa propre responsabilité.
Dominique de Villepin ne dit pas non. Il dit encore.
IMPORTANT - À lire
Dominique de Villepin tente un retour en publiant un essai dans la revue Le Grand Continent. Mais derrière son analyse géopolitique se cache surtout une ambition politique inavouée. Notre revue papier décrypte chaque mois les non-dits de l'actualité.
Pour aller plus loin que les postures intellectuelles, découvrez nos analyses approfondies sur les vrais enjeux du moment. Chaque mois, notre revue papier vous livre une expertise unique pour comprendre les dessous de la politique française et internationale.