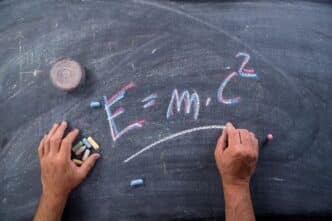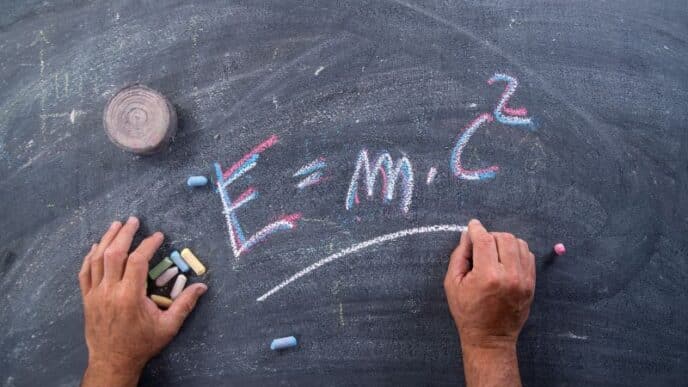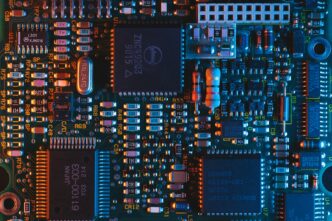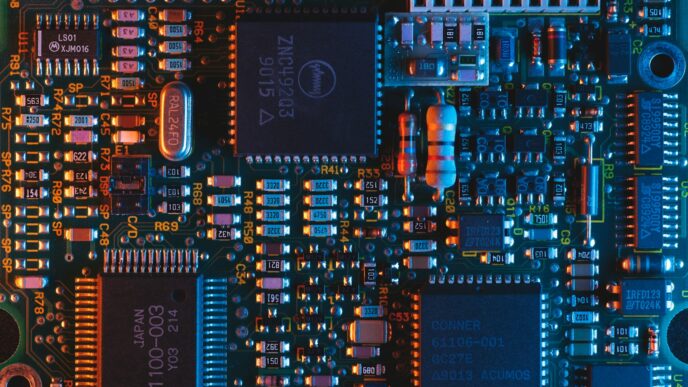🔥 Les essentiels de cette actualité
- Le procès antitrust de Google pourrait bouleverser le monde numérique. En jeu : la vente de Chrome et des restrictions sur l’IA.
- Google accusé de pratiques anti-concurrentielles via des contrats avec Apple. Les autorités réclament un démantèlement.
- Le verdict pourrait redéfinir notre relation avec internet. Google défend sa position dominante par la qualité de ses services.
- Un tournant judiciaire pour les géants du numérique, avec des implications sur la souveraineté numérique et l’avenir d’internet.
Google et son patron Sundar Pichai sont sur la sellette depuis le lundi 21 avril dans un procès antitrust qui pourrait bien rabattre les cartes du monde numérique. Après Meta, c’est au tour du champion de la recherche en ligne d’être dans le viseur de la justice américaine.
Le juge Amit Mehta, qui préside les audiences à Washington, va devoir trancher dans le vif durant ces trois semaines d’affrontement judiciaire. Rappelons que l’entreprise a déjà été déclarée coupable en août d’avoir maintenu sa domination de manière illégale. Comment ? En signant des contrats juteux, notamment avec Apple, pour rester le moteur de recherche par défaut sur vos appareils – une pratique que les autorités considèrent comme anti-concurrentielle.
Les procureurs réclament un démantèlement qui ferait trembler la Silicon Valley : la vente de Chrome, le navigateur utilisé par des milliards d’internautes, ou encore des restrictions dans le développement de l’intelligence artificielle. Des sanctions qui, si elles étaient appliquées, bouleverseraient l’équilibre du marché tech mondial.
Les enjeux du procès pour Google
Ce procès arrive à point nommé alors que les géants du numérique semblent intouchables, accumulant des profits colossaux tout en échappant souvent aux règles qui s’imposent aux entreprises ordinaires. Beaucoup y verront peut-être le signe que même les mastodontes californiens doivent finalement rendre des comptes – même si l’histoire nous a souvent montré que ces multinationales trouvent toujours le moyen de rebondir, quelles que soient les contraintes imposées.
L’issue de ce bras de fer judiciaire pourrait redéfinir notre relation avec internet et nos outils numériques quotidiens. Google prépare déjà sa défense, arguant que sa position dominante résulte simplement de la qualité de ses services et non de pratiques déloyales – un argument que le juge évaluera avec attention dans les semaines à venir.
La magistrate du ministère américain de la justice, Gail Slater, a déclaré lundi 21 avril : « C’est l’avenir de l’Internet qui est en jeu », élevant ce procès au rang d’« historique ».
Face à la puissance de Google, la représentante de l’accusation a posé les termes du débat :
« Allons-nous donner des choix aux Américains et permettre à l’innovation et à la concurrence de prospérer en ligne ? Ou allons-nous maintenir le statu quo qui favorise les monopoles des grandes entreprises technologiques ? »
Les parallèles historiques et les implications actuelles
Cette charge contre la firme de Mountain View rappelle d’autres batailles contre des géants économiques trop puissants. Mme Slater a établi un parallèle entre Google et ces empires d’antan que furent la Standard Oil pour le pétrole ou AT&T dans les télécoms, qu’elle a qualifiés de monopoles « écrasants ».
C’est l’hégémonie des GAFAM et leur pouvoir de façonner nos vies numériques qui se trouve aujourd’hui questionnée. Un enjeu crucial à l’heure où ces entreprises dictent de plus en plus les règles du jeu mondial, souvent sans véritable contre-pouvoir ni contrôle démocratique.

À travers ce procès, c’est aussi la question de notre souveraineté numérique qui est soulevée. Peut-on vraiment laisser quelques multinationales américaines décider seules de notre avenir connecté, sans que les citoyens ou les États n’aient leur mot à dire ?
Ce procès marque un tournant parmi les actions judiciaires engagées depuis 2020 contre les mastodontes du numérique – soutenues par les républicains et les démocrates américains.
Le changement de cap sous l’administration Trump
Après l’arrivée de Trump au pouvoir, l’establishment américain a changé de cap. Les géants tech ne sont plus intouchables comme ils l’étaient depuis la condamnation de Microsoft en 2000. Pendant vingt ans, ces multinationales ont joui d’une impunité presque totale.
Les autorités antitrust américaines ont longtemps laissé ces entreprises accumuler un pouvoir démesuré. Contrôle de l’information, manipulation des données personnelles, censure sélective… tout était permis tant que l’argent coulait à flots et que les bonnes personnes étaient financées.
Si ce procès aboutit, il pourrait créer un précédent et ouvrir la voie à un rééquilibrage des forces. Mais l’État américain n’agit jamais sans calcul politique. Ces poursuites visent peut-être moins à protéger le citoyen ordinaire qu’à réorganiser les alliances entre pouvoirs économiques et politiques.
L’affaire révèle les nouvelles alliances entre géants du numérique et l’administration Trump. Sundar Pichai, le patron de Google, a rencontré Trump à Mar-a-Lago en décembre puis à la Maison-Blanche en mars. Google a aussi déposé un chèque pour l’investiture présidentielle.
Comment Google réagit face au procès en cours
Google a supprimé tous ses programmes de « diversité » en interne, ces mêmes programmes que Trump n’a jamais cessé de critiquer. C’est un signal clair envoyé au nouveau président.
Trump promet aux géants américains comme Google de les protéger contre la bureaucratie européenne et ses régulations. Il a déclaré en octobre qu’un démantèlement de Google affaiblirait l’Amérique face à la Chine.
Mais le président laisse quand même se poursuivre les procès antitrust contre Google. Certains membres de son entourage veulent voir ces monopoles numériques régulés. Trump garde ainsi toutes ses cartes en main, et Google ne peut pas encore dormir tranquille.
Google a été reconnu coupable d’abus de pouvoir dans la recherche internet. Le géant américain a déboursé 26,3 milliards de dollars en 2021 pour que son moteur soit installé par défaut sur les iPhone.
Face à ces pratiques, l’accusation exige la fin de ces contrats exclusifs, veut contraindre Google à partager ses données de recherche avec ses rivaux et pousse à la vente forcée de Chrome.
Une attaque frontale sur l’intelligence artificielle
Lundi, l’avocat du ministère de la justice, David Dahlquist, a attaqué Google sur le front de l’intelligence artificielle.
« C’est la prochaine évolution de Google pour poursuivre son cercle vicieux », a-t-il dit.
Une accusation qui en dit long sur les pratiques du géant californien.
En janvier dernier, Google aurait déboursé « une somme énorme » pour imposer son service Gemini comme assistant d’IA par défaut sur les téléphones Samsung.
Dahlquist a pointé du doigt l’utilisation que fait Google de ses propres données pour entraîner ses intelligences artificielles. Un cercle fermé où le mastodonte du web se gave de nos données personnelles pour renforcer sa position dominante. Perplexity, un concurrent de Google dans le domaine de l’IA, a publié un billet réclamant le « choix » pour les fabricants de smartphones.
Vers la fin de l’impunité des géants tech ?
L’affaire rappelle que les monopoles technologiques ne sont pas intouchables, même quand ils brassent des milliards. Ce réveil judiciaire arrive après des années où ces mastodontes ont pu étendre leur emprise sur nos vies numériques, collecter nos données et dicter leurs conditions au marché.
Google riposte face au procès antitrust.
« Google a gagné sa place sur le marché de la recherche à la régulière », s’est défendu son avocat John Schmidtlein.
L’avocat a précisé que les concurrents dans l’IA comme OpenAI « se portent bien », laissant entendre qu’il n’y a pas de monopole qui étouffe l’innovation.
Dans un billet, le géant de Mountain View a qualifié la plainte de « tournée vers le passé ». Google souligne que le paysage numérique actuel grouille de nouveaux acteurs qui le concurrencent directement – Amazon ou les chatbots comme ChatGPT et le chinois DeepSeek.
Les arguments de Google face aux accusations
Google voit dans les propositions de remèdes du gouvernement une menace à son modèle économique. Ces mesures seraient déconnectées des reproches formulés et entraîneraient une hausse des prix des smartphones. Ils agitent aussi l’épouvantail de la sécurité des données personnelles si elles étaient partagées avec des concurrents.
Face à la pression judiciaire, le géant n’est prêt qu’à céder des concessions minimales: une réduction à douze mois de la durée des contrats imposant son moteur de recherche, et un assouplissement des clauses d’exclusivité. Des concessions qui montrent la volonté de Google de préserver son empire, construit sur des pratiques commerciales agressives que le gouvernement qualifie désormais d’illégales.
Ces mastodontes technologiques se battent pour maintenir leur position dominante, quitte à user d’arguments fallacieux sur la protection du consommateur.
Les batailles juridiques en cours et à venir
Google se trouve acculé. Harcelé par les procédures antitrust en Europe concernant la pub en ligne, contraint d’obéir au Digital Markets Act, le géant du web n’a plus beaucoup de marge de manœuvre. Et pourtant, ces batailles juridiques sont loin d’être terminées.
Le verdict sur le monopole de la recherche devrait tomber fin août, mais le procès sur les sanctions pour la domination publicitaire ne démarrera qu’à l’horizon 2025-2026. Google a déjà prévenu qu’il ferait appel – une stratégie qui pourrait faire traîner l’affaire pendant des années.
Souvenez-vous de Microsoft qui avait échappé au démantèlement d’Explorer après un marathon judiciaire. Les grandes firmes savent toujours comment s’en sortir.

Trump peut stopper ces poursuites en acceptant un accord à l’amiable. Les sanctions seraient alors négociées en coulisses. Le président américain n’a jamais caché son approche pragmatique des affaires. Difficile de prédire ce qu’il décidera, tant l’homme a fait de l’imprévisibilité sa marque de fabrique.
D’ici là, Google continue d’amasser des milliards, preuve que la justice n’est pas la même pour tous.
Le procès Google ne se limite pas à une simple affaire judiciaire : il incarne un combat pour un internet plus ouvert, équitable et démocratique.
Quelle que soit l’issue, cette affaire restera une référence dans la lutte contre les abus de position dominante dans le secteur numérique.
IMPORTANT - À lire
Vous souhaitez aller plus loin dans la compréhension des enjeux numériques et géopolitiques ? Notre revue papier mensuelle décrypte en profondeur les dessous des procès antitrust qui secouent les géants de la Silicon Valley. Des analyses exclusives pour saisir les implications de ces batailles judiciaires sur notre souveraineté numérique.
Chaque mois, plongez au cœur des coulisses du pouvoir avec des enquêtes fouillées sur les liens entre les GAFAM et l'establishment politique. Notre revue vous offre les clés pour comprendre comment ces mastodontes façonnent notre avenir connecté, souvent sans véritable contre-pouvoir démocratique. Un regard critique indispensable à l'ère du tout-numérique.