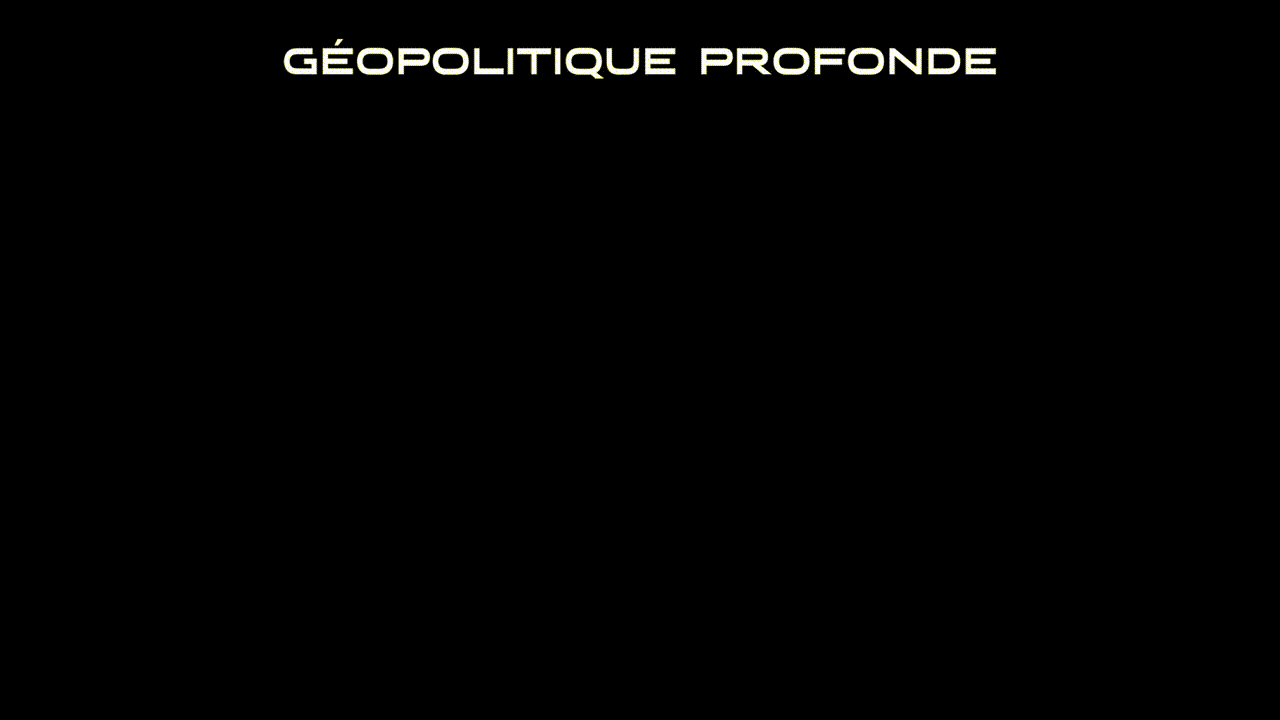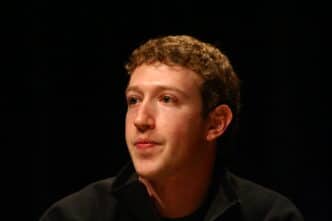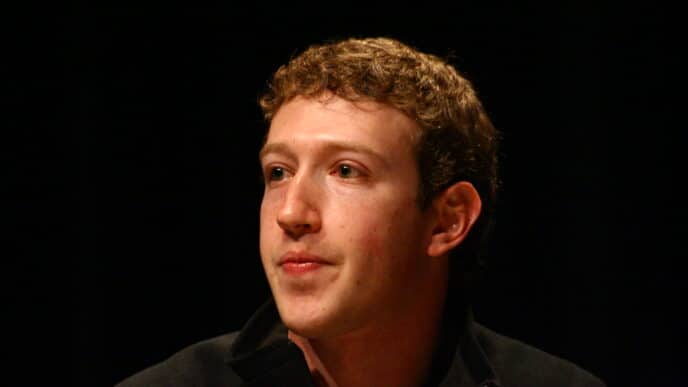🔥 Les essentiels de cette actualité
- Marco Rubio annonce un changement de cap américain sur l’Ukraine, indiquant que le soutien pourrait bientôt cesser. Les États-Unis revoient leurs priorités.
- L’Europe risque de se retrouver seule à financer la guerre, alors que les troupes russes avancent et que l’armée ukrainienne souffre. Les citoyens européens paient le prix fort.
- Des discussions diplomatiques secrètes à Paris suggèrent un possible cessez-le-feu. Les élites européennes persistent, mais les peuples ne sont pas consultés.
- La guerre devient non rentable pour l’Amérique. Washington se retire discrètement, laissant l’Europe gérer seule la suite. Les médias restent silencieux.
Alors que les Français tirent le diable par la queue, que nos campagnes s’éteignent dans l’indifférence et que nos services publics tombent en ruine, nos dirigeants, eux, persistent à suivre aveuglément les injonctions venues de l’extérieur.
Mais cette fois, les signaux changent de direction. Même aux États-Unis, certains poids lourds de la diplomatie laissent entendre que le soutien à l’Ukraine touche peut-être à sa fin. Depuis Paris, un message a été envoyé, clair comme de l’eau de roche : la page ukrainienne pourrait bientôt se tourner à Washington.
Et comme souvent, ce sont les Européens qui risquent de rester seuls pour ramasser les morceaux — et régler la facture.
Rubio sonne la fin de la récré
Secrétaire d’État de Trump et figure incontournable des Républicains, Marco Rubio a dit tout haut ce que les élites européennes refusent encore de formuler : le soutien à l’Ukraine n’est pas éternel.
« Il faut déterminer dans les prochains jours si la paix est faisable ou non en Ukraine. »
Puis, sans détour :
« Si ce n’est pas possible, nous devons passer à autre chose, car les États-Unis ont d’autres priorités. »
Des propos clairs, qui marquent une inflexion dans la position américaine. Après deux ans de guerre, Washington reconsidère son engagement, pendant que l’Europe continue de dépenser sans compter, comme si rien n’avait changé.
Sur le terrain, la situation ne laisse pourtant plus de place à l’illusion : les troupes russes gagnent du terrain dans le Donbass, l’armée ukrainienne fait face à de lourdes difficultés — manque de munitions, fatigue des hommes, moral en berne.
Et malgré tout cela, l’omerta médiatique persiste. Pas un mot dans les grands journaux, ou alors pour commenter la dernière déclaration de Zelensky, comme si tout allait bien. Refuser de voir la réalité ne la fera pas disparaître.
Les États-Unis décrochent, l’Europe paie
Pendant que nos gouvernements continuent de signer des chèques à neuf chiffres, que nos armées puisent dans leurs dernières réserves, et que les citoyens européens supportent seuls l’effort de guerre, les États-Unis commencent à organiser discrètement leur désengagement.
Un retrait pragmatique, sans fracas, pendant que sur le Vieux Continent, on s’entête à jouer les prolongations, coûte que coûte.
Mercredi et jeudi, Antony Blinken était à Paris, accompagné de Steve Witkoff, proche du camp trumpiste. Au programme : des échanges diplomatiques à huis clos, où l’on a parlé d’un possible cessez-le-feu entre Kiev et Moscou.

Mais comme toujours, rien ne filtre. Tout se décide loin des peuples, loin des parlements, loin des soldats qui meurent, et loin des contribuables qui financent.
Ce qui se trame dans les coulisses, c’est peut-être la fin du soutien occidental à l’Ukraine, ou du moins une bascule stratégique majeure, sans que personne n’ose en débattre ouvertement.
Et bien sûr, silence total dans les grands médias. Pas une question dérangeante, pas un doute exprimé. Jusqu’à quand allons-nous nourrir un conflit qui s’enlise, tandis que nos propres nations s’enfoncent dans la crise ?
La guerre n’est plus rentable pour l’Amérique
Le signal est désormais limpide : les États-Unis revoient leurs priorités. Deux ans de guerre, des dizaines de milliards de dollars dépensés, et un conflit qui s’enlise sans perspective claire de victoire. Le temps de l’investissement illimité semble toucher à sa fin.
« À la marge, nous serons prêts à aider quand vous serez prêts à la paix, mais nous n’allons pas poursuivre cet effort pour des semaines et des mois. »
La déclaration est nette, sans détour. Washington ne compte plus porter seul le poids d’un conflit qui se joue essentiellement sur le sol européen. Un repositionnement stratégique logique… pour un pays qui pense d’abord à ses propres intérêts.
« Cette guerre se déroule sur le continent européen. »
À l’Europe de prendre ses responsabilités, et surtout, de passer à la caisse.
Et pendant ce temps, chez nous, les factures d’énergie explosent, les campagnes se vident, les hôpitaux craquent, les écoles étouffent. Mais rien n’est trop cher pour financer un conflit dont les retombées concrètes pour les Français sont inexistantes — sinon négatives.
Des milliards sont débloqués sans débat, pendant que nos dirigeants refusent de voir que l’alignement systématique sur les choix américains n’a jamais été synonyme de souveraineté. À force de suivre sans réfléchir, on s’efface et on s’appauvrit.
Et qui paie, au final ? Toujours les mêmes. Nous.
La fin du chèque en blanc américain ?
Les propos de Rubio, couplés à l’agitation diplomatique observée à Paris, signalent clairement un changement d’ère : le vent tourne, et pas en faveur de Kiev. Les États-Unis réajustent leur position, et laissent entendre qu’ils ne continueront pas à financer indéfiniment une guerre sans issue. L’Ukraine pourrait bien se retrouver isolée. Et comme souvent, ce sont les Européens qui devront assumer la suite — seuls.
« Je pense que le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne peuvent nous aider, faire avancer les choses et nous rapprocher d’une résolution. J’ai trouvé leurs idées très utiles et constructives. »
Autrement dit : aux Européens de prendre le relais, d’assumer la charge, de proposer une sortie. Washington n’abandonne pas, mais se retire prudemment du premier rang. Ce n’est plus son combat direct. À nous de gérer — ou de subir.
Mais dans tout cela, la question essentielle reste absente : quelle est vraiment cette « résolution » évoquée dans les salons feutrés parisiens ? Encore plus de milliards ? Encore plus d’armes ? Encore combien de morts avant qu’un cessez-le-feu ne soit sérieusement envisagé ?
Pendant que nos élites participent à ces tractations, les peuples européens paient, sans qu’on les consulte.
Cette guerre n’aurait jamais dû être la nôtre. Mais par suivisme, par lâcheté, par idéologie, nos élites ont embarqué nos peuples dans une confrontation dont ils ne maîtrisent rien. Et aujourd’hui, ce sont les Américains eux-mêmes qui nous disent : débrouillez-vous.
Le réveil sera douloureux. Mais il faut ouvrir les yeux : l’Ukraine n’était qu’un pion. L’Europe, un tiroir-caisse. Et les peuples ? Une variable d’ajustement.
IMPORTANT - À lire
Vous voulez en savoir plus sur les tractations diplomatiques à huis clos qui se trament dans les coulisses ? Découvrez chaque mois dans notre revue papier des analyses approfondies sur les enjeux géopolitiques mondiaux, comme le repositionnement stratégique des États-Unis face à la guerre en Ukraine.
Pas de langue de bois ni de politiquement correct : notre revue vous offre un décryptage clair et sans concession de l'actualité internationale. Avec des informations exclusives et des points de vue originaux, plongez au cœur des grands dossiers qui façonnent notre monde. Abonnez-vous dès maintenant !