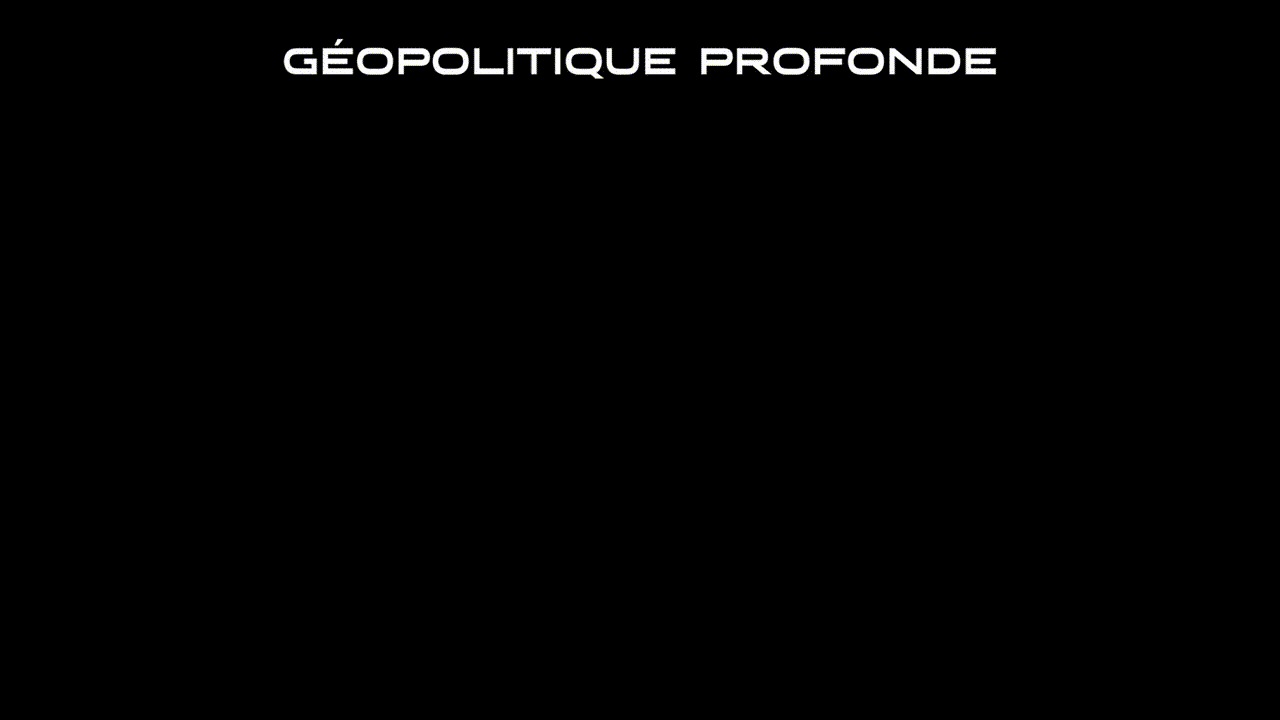🔥 Les essentiels de cette actualité
- Visite éclair de Macron à Mayotte: une journée de com’ et de promesses creuses. Les Mahorais attendent des actes concrets face aux problèmes structurels. Découvrez les critiques et les enjeux.
- Argent public gaspillé pour une tournée diplomatique dans l’océan Indien. Coût élevé pour les contribuables français pendant que Mayotte souffre de pauvreté et d’insécurité. Lisez la suite pour les détails.
- Macron promet un « coup d’accélérateur » pour Mayotte, mais les habitants doutent. Scandale et manque de volonté politique dénoncés. Plongez dans l’analyse complète de cette visite controversée.
Emmanuel Macron a posé le pied à Mayotte ce lundi 21 avril. L’avion présidentiel s’est posé à 8h15 sur le tarmac de Mamoudzou (7h15 à Paris), capitale de ce département français situé à l’autre bout du monde, laissé pour compte depuis si longtemps.
Le chef de l’État a prévu d’y passer une journée complète, s’offrant une séance photo avec la population locale et quelques poignées de mains avec les élus. Une visite éclair qui marque le début d’une tournée de cinq jours dans l’océan Indien, un déplacement qui ressemble davantage à des vacances aux frais du contribuable qu’à une véritable mission présidentielle.
Macron va aussi, dit-on, « faire le point » sur la reconstruction après le passage du cyclone Chido en décembre 2024. Des promesses qui sonnent creux pour les Mahorais, habitués à voir débarquer des ministres et des présidents avec leurs belles paroles, avant d’être abandonnés dès que les caméras s’éteignent.
Visite d’Emmanuel Macron à Mayotte 2025 : une journée sous le feu des critiques
Mayotte reste le département le plus pauvre de France, rongé par l’insécurité et l’immigration clandestine. Mais le Président préfère sans doute y faire une apparition rapide plutôt que de s’attaquer vraiment aux problèmes structurels qui gangrènent l’île depuis des années. Les habitants ont peu d’espoir que cette visite change quoi que ce soit à leur sort.
Les promesses d’Emmanuel Macron à Mayotte lors de sa visite de 2025
Sur le tarmac de l’aéroport, Macron a déroulé son discours habituel face à la presse : « Je veux rendre hommage à la force de résistance de tout le peuple mahorais. On a répondu à l’urgence extrême. Maintenant, je suis là pour faire le constat de ce qui est bien fait, ce qui n’est pas assez bien fait, pour donner un coup d’accélérateur. » Comme d’habitude, des mots et encore des mots, mais qu’en sera-t-il des actes ?
Le président s’est déplacé avec sa cour : Manuel Valls aux outre-mer, Annie Genevard à l’agriculture, Yannick Neuder à la santé et Thani Mohamed-Soilihi à la francophonie. Un débarquement ministériel impressionnant pour les caméras, moins sûr pour le portefeuille des Français qui paient ces déplacements officiels à prix d’or.
Difficile de ne pas voir dans cette visite une opération de communication bien rodée. Après les violences qui ont secoué l’île, Macron vient jouer les pompiers de service alors que les problèmes structurels perdurent depuis des années sans réelle volonté politique d’y remédier. La recette est connue : grands discours, petites actions, et retour à Paris.
Les attentes des Mahorais face aux promesses
Le « coup d’accélérateur » promis résonnera-t-il autrement que les précédentes promesses jamais tenues ? Les Mahorais, abandonnés par l’État depuis trop longtemps, ne se contentent plus de paroles en l’air. Ils attendent des mesures concrètes que ce gouvernement, comme les précédents, tarde à mettre en œuvre.
En pleine opération séduction dans l’océan Indien, Macron s’envole pour rappeler que la France existe encore dans cette région stratégique. Après Mayotte et La Réunion, ces départements français qui servent de vitrine à notre influence – mais qu’on laisse se dégrader le reste du temps – notre président se rend à Madagascar puis à l’île Maurice.
Le « Jupiter » de l’Élysée participera jeudi à Antananarivo au cinquième sommet de la Commission de l’océan Indien, où cinq États insulaires (Madagascar, Maurice, Comores, Seychelles et France pour La Réunion) se retrouvent. Une belle photo de famille diplomatique en perspective !
EN DIRECT | Le Président Emmanuel Macron vient d’arriver à Mayotte. x.com/i/broadcasts/1…
Tournée océan Indien 2025 : une visite diplomatique controversée
Reste à savoir combien coûtera cette démonstration de « puissance régionale » aux contribuables français, à l’heure où les fins de mois sont difficiles pour la plupart d’entre nous. Pendant ce temps, nos départements d’outre-mer croulent sous les problèmes quotidiens, bien loin des discours grandiloquents et des promesses de « coopération renforcée ».
Cette tournée diplomatique risque de ressembler à tant d’autres : beaucoup de mots, quelques poignées de main, et peu de résultats concrets pour les Français qui paient la facture de ces déplacements présidentiels.
La domination maritime française
La France, grâce à ses îles éparpillées comme des grains de sable sur toutes les mers du globe, détient le second domaine maritime mondial. Imaginez : 10 millions de km² – un quart de cette immense étendue bleue se trouvant dans l’océan Indien.
C’est avec ces minuscules terres ultramarines – les fameuses îles Éparses (Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India) – que notre pays s’arroge le contrôle de plus de la moitié du canal du Mozambique. Des terres quasi désertes, des rochers battus par les vagues que presque personne n’habite, mais qui offrent à la France un pouvoir considérable. Ce canal est redevenu, depuis quelques années, un point névralgique du trafic maritime mondial. Hasard ? J’en doute.
Notre pays ne se contente pas de planter son drapeau, il y déploie aussi sa machine militaire. Une base navale à La Réunion, des patrouilleurs, des effectifs… Ces investissements militaires s’accompagnent de moyens économiques impressionnants, surtout quand on les compare aux maigres ressources des pays voisins.
Les bénéficiaires de la puissance maritime
Mais qui profite réellement de cette domination maritime française ? Certainement pas le contribuable métropolitain, qui voit son niveau de vie s’effondrer pendant que l’État parade avec sa flotte dans des eaux lointaines. Et qui contrôle véritablement ces richesses sous-marines potentielles ? Les grands groupes industriels et leurs lobbies, sans aucun doute.
L’élite parisienne ne manque jamais une occasion de s’approprier des ressources à l’autre bout du monde, tout en laissant notre souveraineté s’éroder ici, en métropole.
Madagascar, têtu, continue de revendiquer les îles Éparses comme son territoire depuis des décennies, tandis que les Comores n’ont jamais digéré la « trahison » de Mayotte. Cette dernière a choisi de rester dans le giron français lors de l’indépendance comorienne en 1975 – une décision qui reste une épine dans le pied des relations diplomatiques régionales.
L’État mauricien n’est pas en reste dans cette bataille territoriale. Il garde un œil avide sur Tromelin, ce petit bout de terre situé au nord de La Réunion, qu’il considère comme faisant partie intégrante de son territoire national.
Ces disputes territoriales dans l’océan Indien rappellent que la France, malgré ses discours sur la décolonisation, garde jalousement ses possessions d’outre-mer. Ces confettis d’empire, comme les appelait l’ancien ministre François Mitterrand, sont devenus des enjeux stratégiques majeurs à l’heure où Paris cherche désespérément à maintenir son influence mondiale face aux nouvelles puissances.
RACISTE ET ISLAMOPHOBE ? Le département où Le Pen obtient son meilleur score au 1er tour est Mayotte: 42,7% des voix ! (15,4pts de+qu’en 2017) Sa fermeté contre l’immigration clandestine et l’insécurité séduisent femmes voilées et électorat musulman à 95%. la1ere.francetvinfo.fr/mayotte/marine…
Les enjeux géopolitiques dans l’océan Indien
Les populations locales, elles, observent ces querelles géopolitiques avec un mélange d’amertume et de fatigue. Privés de leur autodétermination, certains habitants de ces territoires contestés se demandent si leurs intérêts comptent vraiment dans ces jeux de pouvoir entre capitales.
Le canal du Mozambique, véritable trésor sous-marin, déborde d’hydrocarbures et de ressources halieutiques que la France ne peut plus considérer comme son pré carré. Aujourd’hui, c’est Pékin qui déploie ses milliards dans la région, construisant ports après ports, pendant que ses chalutiers ratissent les fonds marins sans vraiment demander la permission à quiconque.
L’impérialisme silencieux chinois n’est d’ailleurs pas isolé. Washington, Moscou et New Delhi ont tous flairé la bonne affaire et renforcent leur présence dans ce couloir maritime stratégique. On y observe même des manœuvres militaires conjointes entre les navires russes, chinois et sud-africains – difficile de ne pas y voir une démonstration de force face aux intérêts occidentaux.
Les stratégies des grandes puissances
La Russie, après s’être fait claquer la porte au nez par la Commission de l’Océan Indien en 2020, n’a pas perdu de temps pour trouver d’autres alliés dans la région. Elle soutient désormais ouvertement les revendications malgaches sur les îles Éparses, ces confettis français que nos élites semblent prêtes à brader au nom de je ne sais quelle repentance post-coloniale.
Plus inquiétant encore pour nos départements d’outre-mer, le Kremlin s’est également rapproché des Comores dans leur éternelle contestation de la souveraineté française sur Mayotte. Une stratégie qui rappelle étrangement comment les grandes puissances aiment instrumentaliser les contentieux territoriaux quand ça arrange leurs intérêts commerciaux et géopolitiques.
Macron, face aux blocages sur Mayotte, ne devrait réclamer qu’une entrée par étapes dans la COI via des projets de santé. Pas de bouleversement mais encore une fois une timidité politique qui permet d’éviter les décisions difficiles – une stratégie désormais classique de l’Élysée. Pendant ce temps, les Mahorais continuent de vivre dans l’insécurité croissante que l’État refuse de voir.
La situation à Mayotte
Pourquoi attendre si longtemps pour intégrer pleinement ce territoire français ? Le dossier traîne pendant que les problèmes s’accumulent. C’est typique d’un pouvoir qui navigue à vue, multipliant les demi-mesures au lieu d’agir avec fermeté. Les Mahorais méritent mieux que cette politique des petits pas qui ne réglera rien aux problèmes de fond.
L’exécutif cherche surtout à éviter une crise supplémentaire sans se soucier des conséquences à long terme. Cette « inclusion progressive » ressemble fort à un nouvel enfumage politique dont Macron a le secret. Pendant ce temps, l’immigration clandestine explose, et l’insécurité avec.
Mayotte, cet oublié de la République, se débrouille comme il peut avec le peu qu’on lui laisse. Entre une invasion migratoire massive venue des Comores et les dégâts apocalyptiques du cyclone Chido qui a ravagé l’île en décembre — le pire en quasi un siècle —, l’économie locale est à genoux. Les habitants attendent désespérément qu’on s’occupe enfin d’eux, pendant que Paris nous promet un énième « plan de refondation » qui devrait être voté cet été. Encore des mots, toujours des mots…
Droit du sol à Mayotte : un consensus atteint entre députés et sénateurs pour renforcer les conditions d’accès à la nationalité française. En savoir + 👉 la1ere.francetvinfo.fr/droit-du-sol-a…
Les défis économiques et sociaux
Pourtant, ce territoire français affiche le triste record de département le plus pauvre du pays. Une situation qui empire d’année en année sans que personne n’y fasse vraiment attention. Nos compatriotes mahorais se sentent abandonnés, laissés pour compte, comme si leur sort n’intéressait pas les élites parisiennes.
Le fameux projet de loi de « refondation » — notez bien les guillemets — sera-t-il à la hauteur de l’urgence ? J’en doute fortement. On nous promet monts et merveilles pendant que la population souffre au quotidien face à l’insécurité grandissante et une situation économique désastreuse. Ce n’est pas avec des promesses qu’on reconstruira les infrastructures détruites par Chido.
Mayotte, ravagée par le passage du cyclone, a déjà bénéficié d’une loi d’urgence votée en février dernier pour faciliter sa reconstruction. Cette catastrophe a fait 40 morts et laissé derrière elle une facture colossale de 3,5 milliards d’euros de dégâts. L’État revient maintenant avec un nouveau texte, soi-disant de « refondation ».
Les réponses de l’État
Présenté par Emmanuel Macron comme un plan de « refondation » pour relancer l’économie et rétablir l’ordre à Mayotte, ce projet de loi masque difficilement ses véritables priorités. Derrière les promesses de développement se dessine un durcissement clair de la politique migratoire : renforcement des conditions d’obtention des titres de séjour, facilitation des expulsions et incitation au retour volontaire. Autrement dit, une stratégie de réduction ciblée de la population étrangère, sous couvert de rationalisation administrative.
Bien sûr, comme d’habitude, ce texte s’accompagne de vagues promesses fiscales censées stimuler l’économie et l’emploi, ainsi que de quelques mesures de soutien à la jeunesse. Des effets d’annonce dont on peine à croire qu’ils changeront véritablement le quotidien des Mahorais, qui restent les grands oubliés de la République.
Derrière ces beaux discours de reconstruction se cache une vision sécuritaire et répressive qui ne s’attaque pas aux véritables problèmes de fond que rencontre ce territoire français depuis des décennies.
IMPORTANT - À lire
Vous voulez aller plus loin que les effets d'annonce de Macron à Mayotte ? Découvrez notre revue mensuelle qui décrypte l'actualité géopolitique sans langue de bois. Plongez au cœur des enjeux qui façonnent notre monde, avec des analyses pointues et des révélations exclusives.
Chaque mois, recevez directement chez vous un concentré d'informations essentielles pour comprendre les dessous des cartes. De la Chine à la Russie en passant par l'Afrique, notre revue vous offre un tour d'horizon complet des grandes manœuvres diplomatiques et des rapports de force qui bouleversent l'échiquier mondial.