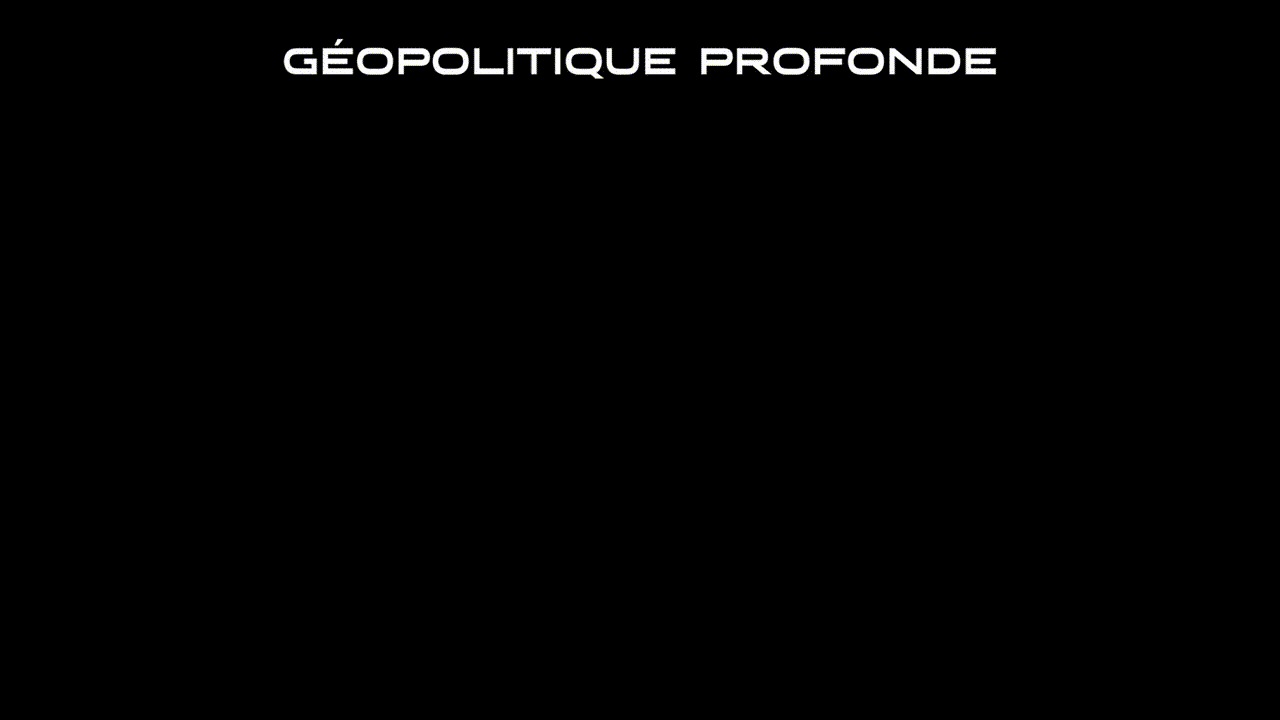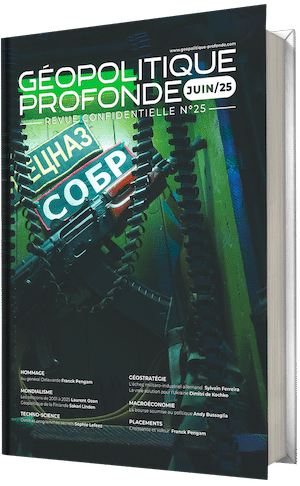Il y a moins d’un an, un des vice-présidents de la Réserve Fédérale américaine rejoignait le centre de recherche de BlackRock (le BlackRock Investment Institute). Ce dernier intégrait donc discrètement le numéro un des gestionnaires d’actifs, quelques mois seulement après avoir démissionné de son poste au sein de la banque centrale étasunienne.
Cet homme a l’allure svelte (à gauche de la photo, aux côtés de Netanyahu) et au regard vif malgré ses 76 printemps, se nomme Stanley Fisher.

Son nom et son visage ne vous disent probablement rien, mais s’il existe un individu qui symbolise à lui seul, l’Oligarchie financière contemporaine c’est bien ce petit Monsieur. En effet, le parcours exemplaire de cet homme de l’ombre révèle de précieuses informations sur l’influence d’une certaine élite dominatrice sûre d’elle-même, dans le fonctionnement de l’économie mondiale.
Fischer en plus d’être un parfait exemple de pantouflage, symbolise le poids considérable de la finance internationale sur le monde politique. Sa carrière et ses différentes responsabilités peuvent nous permettre d’identifier les rapports de force et les pratiques courantes des hautes sphères oligarchiques transnationales.
Attardons-nous donc un instant sur le profil de cette prestigieuse recrue de BlackRock. Élément intéressant, Fischer est né sur le continent africain, plus précisément dans la ville de Mazabuka en Zambie. Ce dernier est issu d’une famille juive résidant dans l’ancienne Rhodésie du Nord. La Zambie était à l’époque une colonie britannique, elle obtint son indépendance au cours de l’année 1964.
Fischer est donc né au milieu du second conflit mondial, en 1943, dans le monde colonial britannique dans la capitale zambienne : Lusaka. Au lendemain de la guerre, dans les années cinquante, sa famille part pour une autre colonie britannique : la Rhodésie du Sud (aujourd’hui le Zimbabwe).
En théorie, Fischer disposait de la citoyenneté britannique, mais ce qui est certain c’est que dès son adolescence Fischer va s’impliquer activement au sein d’un mouvement de jeunesse sioniste dénommé Habonim.
En 1960, dans le cadre de ce militantisme sioniste, il voyagea en Israël et étudia l’hébreu dans un kibboutz. Celui-ci prévoyait alors de commencer ses études à l’Université hébraïque de Jérusalem, mais il émigra finalement au Royaume-Uni, après avoir reçu une bourse de la prestigieuse London School of Economics. Après son cursus universitaire britannique, Fischer ne retourna pour autant en Israël. Il traversa cette fois l’Atlantique pour se rendre aux États-Unis pour étudier au MIT afin d’y obtenir un doctorat.
Au début des années 1970, Fischer entama alors une carrière de professeur agrégé à l’Université de Chicago. C’est au sein de cette grande université, fondée en 1890 par John D. Rockefeller, qu’il commença son activité professionnelle d’universitaire. Fischer enseigna naturellement au sein du département d’économie désigné comme l’École de Chicago (qui a d’ailleurs donné son nom à une école de pensée économique se rattachant à une vision néolibérale de l’économie).
En effet, l’École de Chicago est généralement associée à la théorie néoclassique des prix, au libre marché et au monétarisme ainsi qu’à une opposition au keynésianisme, dont la majorité des professeurs et élèves se rattachent. Ainsi cette école de pensée est souvent symbolisée pour le grand public par la figure de Milton Friedman, prix Nobel d’économie en 1976. Les théories de l’école de Chicago sont notamment à l’origine des politiques économiques de la Banque mondiale du milieu des années 1980 au milieu des années 1990, qui ont conduit à la privatisation de nombreuses entreprises publiques des pays en voie de développement…
Fischer est néanmoins présenté comme une figure centrale de l’économie « néo keynésienne », c’est-à-dire une optique économique qui ne vise pas à substituer l’État au marché, mais qui cherche à trouver les moyens d’améliorer le fonctionnement de l’économie… Il devient ensuite professeur au Département d’économie du MIT de 1977 à 1988. C’est à cette période qu’il sera notamment directeur de thèse de Ben Bernanke, plus tard dirigeant de la Réserve Fédérale américaine pendant la crise des Subprimes de 2007-2008, ou encore de Mario Draghi, directeur de la BCE de 2011 à 2018.
En janvier 1988, il commence une carrière de haut responsable au sein de grands organismes financiers, ainsi pendant deux ans il est vice-président section Économie du développement et économiste en chef à la Banque mondiale. Il est ensuite nommé premier directeur général adjoint du Fonds monétaire international (FMI), de 1994 à 2001. C’est d’ailleurs, à cette occasion qu’il intègre l’influent organe consultatif financier, basé à Washington, le Group of Thirty (pour en savoir plus sur le Groupe des Trente ou G30 cf. notre article précédent).
Pour ce qui est de son activité dans les Think Thank du mondialisme financier : il est également membre du groupe Bilderberg et a notamment assisté à ses conférences de manière officielle en 1996, 1998, 1999 et 2018. C’est également à souligner, il est membre émérite du Council on Foreign Relations (CFR).
Au début des années 2000, Fischer se décide à « faire fortune ». Il est alors recruté par une grande banque privée et devient vice-président de Citigroup, président de Citigroup International et chef du groupe des clients du secteur public. Fischer reste cadre chez Citigroup seulement trois petites années de février 2002 à avril 2005, assez pour empocher des millions de dollars en salaires et en actions.
L’une des premières « consécrations politiques » de sa carrière arrive au tournant de l’année 2005 ou Fischer est nommé gouverneur de la Banque d’Israël par le cabinet israélien, après avoir été recommandé par le Premier ministre Ariel Sharon et le ministre des Finances Benjamin Netanyahu. Évidemment entre temps, Fischer a pris la nationalité israélienne sans pour autant renoncer à sa citoyenneté américaine. D’ailleurs, il est à noter que Fischer avait déjà travaillé en collaboration avec la Banque d’Israël par le passé. Il avait notamment conseillé le gouvernement américain sur le programme de stabilisation économique d’Israël en 1985.

Sous sa direction, en 2010, la Banque d’Israël fait des merveilles dans un contexte de crise économique mondiale. Elle se classe même au premier rang des banques centrales grâce à son fonctionnement efficace, selon le World Competitiveness Yearbook d’IMD. Le régulateur Fischer fait l’objet de multiples éloges internationaux saluant sa gestion de l’économie israélienne au lendemain de la crise financière mondiale. En effet, en septembre 2009, la Banque d’Israël était la première banque du monde développé à relever ses taux d’intérêt…
Au cours des années 2009, 2010, 2011 et 2012, Fischer a même reçu une note « A » sur le bulletin de la banque centrale publié par le magazine Global Finance. En octobre 2010, Fischer est également déclaré gouverneur de l’année de la banque centrale par le magazine Euromoney. Fischer est donc au début de la décennie 2010 l’une des grandes « stars » des principaux banquiers centraux. Mais c’est aussi à cette période qu’il va connaitre son seul échec notable dans sa carrière.
En effet, sa candidature au poste de directeur général du FMI en remplacement de Dominique Strauss-Kahn est rejetée en 2011. Fischer ayant dépassé la limite d’âge nouvellement instituée par le FMI (67 au lieu de 65 ans). Le 30 juin 2013, à son zénith, Fischer finit tout de même par démissionner de son poste de gouverneur de la Banque d’Israël à mi-chemin de son deuxième mandat.
Et c’est ainsi que six mois plus tard, cas unique dans l’histoire, le président démocrate Barack Obama le nomme vice-président du Federal Reserve System (FED). Avant lui, aucun grand banquier central n’avait été nommé au sein de deux grandes banques centrales. Même s’il est binational (Israélo-américain), ayant joué un rôle fondamental pendant 8 ans dans la politique israélienne, il aurait pu être identifié, aux yeux de l’opinion publique, comme une personnalité israélienne.

Mais en nommant Fischer à ce poste, Obama appliquait des consignes. Il déclara pompeusement à cette occasion que Fischer avait déjà apporté des décennies de leadership et d’expertise à travers ses différentes missions au sein du Fonds monétaire international et à la Banque d’Israël. Ce fut également à cette occasion que la timide Janet Yellen devint la première femme présidente de la Réserve fédérale au début de 2014.
Néanmoins après trois ans d’activité, Fischer démissionna pour des raisons personnelles à la mi-octobre 2017, 8 mois avant la fin de son mandat de vice-président en juin 2018.
En réalité, il ne cachait pas son hostilité à Donald Trump. Et déclarera même plus tard que le président Trump « ne comprend pas le commerce international ».
Et c’est ainsi qu’à peine plus d’un an après avoir quitté la vice-présidence de la Réserve Fédérale, Stanley Fischer intégra la société BlackRock, géant américain de la gestion d’actifs. L’ancien banquier central est depuis moins d’un an, conseiller senior de l’institut de recherche de BlackRock. « Son expérience et son expertise aideront nos investisseurs et nos clients à saisir l’impact des développements mondiaux sur leurs portefeuilles », selon Larry Finck (directeur général) et Philipp Hildebrand (vice-président) dans le communiqué interne au début de l’année 2019.
Ce qui est significatif c’est que BlackRock n’a pas hésité à se payer le luxe de recruter l’un des banquiers centraux les plus importants du monde, amenant et mettant au service de l’entreprise ses réseaux et ses connaissances. D’ailleurs, au regard de l’âge de Fischer et de son goût des responsabilités, il ne semble pas qu’un homme comme lui intègre BlackRock uniquement pour satisfaire sa cupidité. À BlackRock, il va continuer à faire de la politique…
Il est incontestable que BlackRock a la capacité d’influencer la politique de nations et les décisions d’entreprises (on le voit avec la France et Macron). Et cet état de fait a sûrement pesé dans la balance, lorsque Fischer a décidé de rejoindre le gestionnaire d’actif. D’ailleurs, on le sait, l’exemple Fischer est loin d’être un cas isolé et ce n’est pas la première fois qu’un banquier central rejoint une institution financière privée. Mais il est symptomatique de voir cette figure âgée procéder de la sorte à une époque où la défiance légitime entre le politique et le financier, et plus généralement entre le peuple et la banque, ne cesse de croitre.

Il est vrai que la liste est longue :
- Depuis 2015, Ben Bernanke, ancien président de la Réserve Fédérale durant la crise des Subprimes, a lui de son côté, rejoint Pimco (fonds obligataire filiale du 4ème gestionnaire d’actifs au monde : Allianz), en tant qu’« expert ». La même année, le gérant obligataire californien s’était également offert les services de Jean-Claude Trichet (BCE).
- D’ailleurs, n’oublions pas que Philipp Hildebrand, époux de la veuve de Robert Louis-Dreyfus et actuel vice-président du colosse BlackRock « asset management » aux 6 000 milliards de dollars sous gestion, était l’ancien président de la banque centrale suisse (2010). Ce dernier avait toutefois dû quitter son poste en 2012 dans le cadre de soupçons de délit d’initié impliquant son ex-femme qui avait acheté pour 400 000 dollars de francs suisses quelques semaines avant que son mari n’instaure le cours plancher…
- L’ancien gouverneur de la Banque d’Angleterre Mervyn King, a lui aussi « pantouflé » en rejoignant Citigroup. Alors que durant sa carrière de régulateur, King avait fait son cinéma, en osant dénoncer l’incompétence et la cupidité des banquiers.
- Sans parler de notre ancien gouverneur de la Banque de France, Christian Noyer qui entame sa reconversion dans le privé via une « fintech de la Blockchain » : nommée Selt (émanation du Crédit Agricole, de Citigroup et du cabinet d’audit Deloitte).
Le passage dans le privé n’est évidemment pas l’apanage des régulateurs. On s’en souvient, l’ancien président de la Commission européenne José-Manuel Barroso avait déclenché une vague d’indignation sur le vieux continent en rejoignant Goldman Sachs à l’automne 2016. Vice-président non exécutif des activités internationales, il avait d’ailleurs pour mission d’assister l’établissement dans le cadre du Brexit.
Ainsi le cas Fisher et tous ces exemples de pantouflages servent, encore une fois, à démontrer que malgré les mots, il n’existe aucune séparation entre les responsabilités publiques et le secteur financier. Nos politiques ou hauts responsables ne sont que des employés, là pour exécuter des consignes qui leur viennent du haut de la pyramide capitaliste.
Stanley Fischer et les grandes figures employées de l’oligarchie financière ne se cachent même plus face à l’opinion publique. Ce qui n’a rien d’étonnant quand on sait que nos élites raisonnent selon l’adage bien connu de l’écrivain huguenot anglo-néerlandais Mandeville : « les vices privés font la vertu publique ».
Mais si dans les pays anglo-saxons ces pratiques sont presque normalisées tant les peuples sont endormis, en France, pays de tradition latine et étatiste, elles sont en train de réveiller une partie des classes populaires. Demain, l’opulence, le népotisme et l’incompétence de nos responsables politiques cosmopolites qui doit selon eux, contribuer à l’édification future d’un monde meilleur pourrait bel et bien se retourner contre eux.
Aussi, les disciples de Mandeville et de la double éthique, qui soutiennent que la guerre, le vol, la prostitution, l’alcool et les drogues, ou encore la cupidité, par ce qu’ils contribuent « à l’avantage de la société civile », ont tort de penser que ce système est éternel…
En effet, il est très probable que la domination de nos élites vicieuses et illégitimes arrive à son terme d’ici peu.
Marc Gabriel Draghi
IMPORTANT - À lire
Vous voulez aller plus loin que cet article et comprendre tous les enjeux géopolitiques actuels ? Chaque mois, notre revue papier décortique l'actualité géopolitique et économique pour vous offrir des analyses approfondies.
Ne vous laissez plus manipuler par des élites déconnectées du réel. Abonnez-vous à notre revue dès maintenant et recevez chaque mois des informations exclusives, des décryptages précis et des révélations sur les véritables enjeux qui se cachent derrière les décisions de nos dirigeants.
Reprenez le contrôle de votre épargne et de votre avenir !