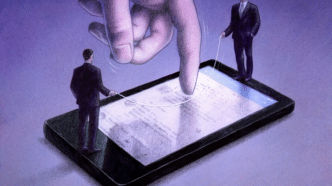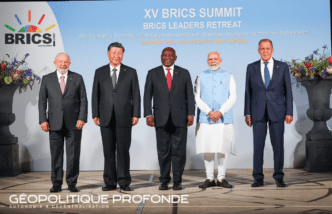Comprendre le coup d’État des oligarchies économiques et financières via les médias, en occident.
SOMMAIRE
- I. Le retour inattendu de la russophobie: Les origines de la « désinformation » contemporaine
- II. L’élection de Trump : « C’est la faute de Facebook »
- III. Pourquoi avons-nous besoin de toutes ces données sur les personnes ?
- IV. Internet: Du chouchou au démon
- V. Le Russiagate !
- VI. Pourquoi la « guerre contre la terreur » de l’après 11 septembre n’a jamais pris fin
- VII. La montée en puissance des « extrémistes nationaux »
- VIII. L’ONG Borg
- IX. COVID-19
- X. Les ordinateurs portables d’Hunter : l’exception à la règle
- XI. Le nouvel État à parti unique
- XII. La fin de la censure
- XIII. Après la démocratie
- Annexe : Le dictionnaire de la Désinformation
Prologue : La guerre de l’information
En 1950, le sénateur Joseph McCarthy a affirmé avoir la preuve qu’un réseau d’espionnage communiste opérait au sein du gouvernement. Du jour au lendemain, ces accusations explosives ont fait le tour de la presse nationale, mais les détails n’ont cessé de changer.
Dans un premier temps, McCarthy a déclaré qu’il disposait d’une liste contenant les noms de 205 communistes au sein du département d’État ; le lendemain, il a ramené cette liste à 57.
Comme il gardait la liste secrète, les incohérences n’avaient pas d’importance. Ce qui compte, c’est la puissance de l’accusation, qui a fait du nom de McCarthy un synonyme de la politique de l’époque.
Pendant plus d’un demi-siècle, le maccarthysme a constitué un chapitre déterminant de la vision du monde des libéraux américains : une mise en garde contre l’attrait dangereux des listes noires, des chasses aux sorcières et des démagogues.
Jusqu’en 2017, lorsqu’une nouvelle liste d’agents russes présumés a bouleversé la presse et la classe politique américaines.
Une nouvelle organisation, Hamilton 68, affirmait avoir découvert des centaines de comptes affiliés à la Russie qui avaient infiltré Twitter pour semer le chaos et aider Donald Trump à remporter l’élection.
La Russie était accusée de pirater les plateformes de médias sociaux, les nouveaux centres de pouvoir, et de les utiliser pour diriger secrètement des événements à l’intérieur des États-Unis.
Rien de tout cela n’était vrai. Après avoir examiné la liste secrète de Hamilton 68, le responsable de la sécurité de Twitter, Yoel Roth, a admis en privé que son entreprise permettait à de « vraies personnes » d’être « unilatéralement qualifiées de laquais de la Russie sans preuve ni recours ».
L’épisode Hamilton 68 s’est déroulé comme un remake presque parfait de l’affaire McCarthy, avec une différence importante : McCarthy a dû faire face à une certaine résistance de la part des principaux journalistes, des agences de renseignement américaines et de ses collègues du Congrès.
À notre époque, ces mêmes groupes se sont alignés pour soutenir les nouvelles listes secrètes et attaquer quiconque les remettait en question.
Lorsque la preuve est apparue, au début de l’année, que Hamilton 68 était un canular de haut niveau perpétré contre le peuple américain, elle a été accueillie par un grand mur de silence dans la presse nationale.
Le désintérêt était si profond qu’il suggérait une question de principe plutôt que de commodité pour les porte-drapeaux du libéralisme américain qui avaient perdu la foi dans la promesse de la liberté et embrassé un nouvel idéal.
Dans les derniers jours de son mandat, le président Barack Obama a pris la décision d’engager le pays sur une nouvelle voie.
Le 23 décembre 2016, il a promulgué la Loi sur la lutte contre la propagande étrangère et la désinformation, qui utilise le langage de la défense de la patrie pour lancer une guerre de l’information ouverte et offensive.
Le spectre imminent de Donald Trump et des mouvements populistes de 2016 a réveillé des monstres endormis en Occident.

La désinformation, vestige à moitié oublié de la guerre froide, a été à nouveau évoquée comme une menace urgente et existentielle.
La Russie aurait exploité les vulnérabilités de l’internet ouvert pour contourner les défenses stratégiques américaines en infiltrant les téléphones et les ordinateurs portables des particuliers. L’objectif final du Kremlin était de coloniser l’esprit de ses cibles, une tactique que les spécialistes de la cyberguerre appellent le « piratage cognitif ».
La lutte contre ce spectre a été considérée comme une question de survie nationale.
« Les États-Unis perdent la guerre d’influence », avertissait un article publié en décembre 2016 dans le journal de l’industrie de la défense, Defense One.
L’article citait deux initiés du gouvernement qui affirmaient que les lois rédigées pour protéger les citoyens américains de l’espionnage étatique mettaient en péril la sécurité nationale.
Selon Rand Waltzman, ancien directeur de programme à l’Agence des projets de recherche avancée de défense (Defense Advanced Research Projects Agency), les adversaires des États-Unis jouissent d’un « avantage significatif » en raison des « contraintes juridiques et organisationnelles auxquelles nous sommes soumis et pas eux ».
Ce point a été repris par Michael Lumpkin, qui a dirigé le Global Engagement Center (GEC) du département d’État, l’agence désignée par Obama pour mener la campagne de contre-désinformation des États-Unis.
M. Lumpkin a qualifié d’obsolète le Privacy Act de 1974, une loi datant de l’après-Watergate qui protège les citoyens américains contre la collecte de leurs données par le gouvernement.
« La loi de 1974 a été créée pour s’assurer que nous ne recueillions pas de données sur les citoyens américains. Eh bien… par définition, le World Wide Web est mondial. Il n’y a pas de passeport qui l’accompagne. »
« S’il s’agit d’un citoyen tunisien aux États-Unis ou d’un citoyen américain en Tunisie, je n’ai pas la capacité de le discerner…«
« Si j’avais plus de possibilités de travailler avec ces [informations personnelles identifiables] et si j’y avais accès… je pourrais faire plus de ciblage, de manière plus définitive, pour m’assurer que je peux envoyer le bon message au bon public et au bon moment ».
Le message de l’establishment de la défense américaine était clair : pour gagner la guerre de l’information – un conflit existentiel qui se déroule dans les dimensions sans frontières du cyberespace – le gouvernement devait se passer des distinctions juridiques dépassées entre les terroristes étrangers et les citoyens américains.
Depuis 2016, le gouvernement fédéral a dépensé des milliards de dollars pour transformer le complexe de contre-désinformation en l’une des forces les plus puissantes du monde moderne : un Léviathan tentaculaire dont les tentacules s’étendent aux secteurs public et privé, que le gouvernement utilise pour diriger un effort de « toute la société » qui vise à prendre le contrôle total d’Internet et à ne réaliser rien de moins que l’éradication de l’erreur humaine.
La première étape de la mobilisation nationale pour vaincre la désinformation a consisté à fusionner l’infrastructure de sécurité nationale des États-Unis avec les plateformes de médias sociaux, où se déroulait la guerre.
L’agence gouvernementale chargée de la lutte contre la désinformation, le GEC, a déclaré que sa mission consistait à « rechercher et engager les meilleurs talents dans le secteur technologique ». À cette fin, le gouvernement a commencé à nommer des cadres du secteur technologique comme commissaires à l’information de facto en temps de guerre.
Dans des entreprises comme Facebook, Twitter, Google et Amazon, les cadres supérieurs ont toujours compté des vétérans de l’establishment de la sécurité nationale.

Mais avec la nouvelle alliance entre la sécurité nationale américaine et les médias sociaux, les anciens espions et fonctionnaires des agences de renseignement sont devenus un bloc dominant au sein de ces entreprises ; ce qui avait été une échelle de carrière par laquelle les gens passaient de leur expérience gouvernementale à des emplois dans le secteur privé de la technologie s’est transformé en un ouroboros qui a moulé les deux ensemble.
Avec la fusion D.C.-Silicon Valley, les bureaucraties fédérales ont pu s’appuyer sur des relations sociales informelles pour imposer leur agenda au sein des entreprises technologiques.
À l’automne 2017, le FBI a créé son groupe de travail sur l’influence étrangère dans le but exprès de surveiller les médias sociaux pour signaler les comptes qui tentent de « discréditer les personnes et les institutions américaines ». Le département de la sécurité intérieure a endossé un rôle similaire.
À peu près au même moment, Hamilton 68 a explosé. Publiquement, les algorithmes de Twitter ont transformé le « tableau de bord » exposant l’influence russe en un sujet d’actualité majeur.
En coulisses, les dirigeants de Twitter ont rapidement compris qu’il s’agissait d’une escroquerie.
Selon le journaliste Matt Taibbi, lorsque Twitter a procédé à la rétro-ingénierie de la liste secrète, il a découvert qu’« au lieu de suivre l’influence de la Russie sur les attitudes américaines, Hamilton 68 s’est contenté de rassembler une poignée de comptes, pour la plupart réels et pour la plupart américains, et de décrire leurs conversations organiques comme étant des manigances russes ».
Cette découverte a incité le responsable de la confiance et de la sécurité de Twitter, Yoel Roth, à suggérer dans un courriel d’octobre 2017 que l’entreprise prenne des mesures pour dénoncer le canular et « appeler cela pour la connerie que c’est. »
En fin de compte, ni Roth ni personne d’autre n’a dit un mot. Au lieu de cela, ils ont laissé un pourvoyeur de conneries industrielles – le terme démodé de désinformation – continuer à déverser son contenu directement dans le flux d’informations.
Il ne suffit pas que quelques agences puissantes luttent contre la désinformation.
La stratégie de mobilisation nationale appelait à une approche « non seulement de l’ensemble du gouvernement, mais aussi de l’ensemble de la société », selon un document publié par le GEC en 2018.
« Pour contrer la propagande et la désinformation », a déclaré l’agence, « il faudra tirer parti de l’expertise de l’ensemble du gouvernement, des secteurs de la technologie et du marketing, du monde universitaire et des ONG. »
C’est ainsi que la « guerre contre la désinformation » créée par le gouvernement est devenue la grande croisade morale de son temps.
Les officiers de la CIA à Langley en sont venus à partager une cause avec de jeunes journalistes branchés de Brooklyn, des organisations non gouvernementales progressistes de Washington, des groupes de réflexion financés par George Soros à Prague, des consultants en équité raciale, des consultants en capital-investissement, des employés d’entreprises technologiques de la Silicon Valley, des chercheurs de l’Ivy League et des membres de la famille royale britannique qui ont failli à leur mission.
Les républicains « Jamais Trump » ont uni leurs forces à celles du Comité national démocrate, qui a déclaré que la désinformation en ligne était « un problème qui touche l’ensemble de la société et qui nécessite une réponse de l’ensemble de la société ».
Même les critiques les plus virulents du phénomène – y compris Taibbi et Jeff Gerth de la Columbia Journalism Review, qui a récemment publié une dissection du rôle de la presse dans la promotion des fausses allégations de collusion entre Trump et la Russie – se sont concentrés sur les échecs des médias, un point de vue largement partagé par les publications conservatrices, qui traitent la désinformation comme une question de parti pris de censures partisanes.
Mais s’il ne fait aucun doute que les médias se sont totalement déshonorés, ils sont aussi un bouc émissaire commode – de loin l’acteur le plus faible du complexe de contre-désinformation.
La presse américaine, autrefois gardienne de la démocratie, a été vidée de sa substance au point d’être portée comme une marionnette par les agences de sécurité et les agents des partis américains.
Il serait agréable d’appeler ce qui s’est passé une tragédie, mais un public est censé apprendre quelque chose d’une tragédie.
En tant que nation, l’Amérique n’a non seulement rien appris, mais elle a été délibérément empêchée d’apprendre quoi que ce soit tout en étant amenée à courir après des ombres. Ce n’est pas parce que les Américains sont stupides, c’est parce que ce qui s’est passé n’est pas une tragédie, mais quelque chose de plus proche du crime. La désinformation est à la fois le nom du crime et le moyen de le couvrir ; une arme qui sert aussi de déguisement.
Le crime est la guerre de l’information elle-même, qui a été lancée sous de faux prétextes et qui, de par sa nature, détruit les frontières essentielles entre le public et le privé, entre l’étranger et le national, dont dépendent la paix et la démocratie.
En associant la politique anti-establishment des populistes nationaux à des actes de guerre commis par des ennemis étrangers, elle a justifié le recours à des armes de guerre contre des citoyens américains.
Il a transformé les lieux publics où se déroule la vie sociale et politique en pièges de surveillance et en cibles pour des opérations psychologiques de masse. Le crime est la violation systématique des droits des Américains par des fonctionnaires non élus qui contrôlent secrètement ce que les individus peuvent penser et dire.
Ce que nous voyons aujourd’hui, dans les révélations exposant les rouages du régime de censure de l’État et des entreprises, n’est que la fin du commencement. Les États-Unis n’en sont encore qu’aux premiers stades d’une mobilisation de masse qui vise à soumettre tous les secteurs de la société à un régime technocratique unique.
Cette mobilisation, qui a commencé comme une réponse à la menace prétendument urgente de l’ingérence russe, évolue maintenant vers un régime de contrôle total de l’information qui s’est arrogé la mission d’éradiquer les dangers abstraits tels que l’erreur, l’injustice et le mal – un objectif digne uniquement des dirigeants qui se croient infaillibles, ou des super-vilains de bandes dessinées.
La première phase de la guerre de l’information a été marquée par des manifestations d’incompétence et d’intimidation brutale typiquement humaines.
Mais la prochaine étape, déjà en cours, est réalisée par des processus évolutifs d’intelligence artificielle et de précensure algorithmique qui sont encodés de manière invisible dans l’infrastructure de l’internet, où ils peuvent modifier les perceptions de milliards de personnes.
Quelque chose de monstrueux est en train de prendre forme en Amérique. Formellement, elle présente la synergie du pouvoir de l’État et des entreprises au service d’un zèle tribal qui est la marque du fascisme.
Pourtant, quiconque passe du temps en Amérique et n’est pas un zélote ayant subi un lavage de cerveau peut dire qu’il ne s’agit pas d’un pays fasciste.
Ce qui est en train de naître, c’est une nouvelle forme de gouvernement et d’organisation sociale qui est aussi différente de la démocratie libérale du milieu du vingtième siècle que la première République américaine l’était du monarchisme britannique dont elle est issue et qu’elle a fini par supplanter.
Un État organisé selon le principe qu’il existe pour protéger les droits souverains des individus est en train d’être remplacé par un léviathan numérique qui exerce son pouvoir au moyen d’algorithmes opaques et de la manipulation d’essaims numériques.
Cela ressemble au système chinois de crédit social et de contrôle de l’État par un parti unique, mais cela aussi passe à côté du caractère distinctement américain et providentiel du système de contrôle.
Dans le temps que nous perdons à essayer de le nommer, la chose elle-même peut disparaître à nouveau dans l’ombre bureaucratique, couvrant toute trace par des suppressions automatisées à partir des centres de données top secret d’Amazon Web Services, « le nuage de confiance pour le gouvernement ».
D’un point de vue technique ou structurel, l’objectif du régime de censure n’est pas de censurer ou d’opprimer, mais de gouverner. C’est pourquoi les autorités ne peuvent jamais être qualifiées de coupables de désinformation.
Pas lorsqu’elles ont menti sur les ordinateurs portables de Hunter Biden, pas lorsqu’elles ont prétendu que la fuite du laboratoire était une conspiration raciste, pas lorsqu’elles ont affirmé que les vaccins empêchaient la transmission du nouveau coronavirus.
La désinformation, aujourd’hui et pour toujours, est ce qu’ils disent qu’elle est. Ce n’est pas un signe que le concept est mal utilisé ou corrompu ; c’est le fonctionnement précis d’un système totalitaire.
Si la philosophie sous-jacente de la guerre contre la désinformation peut être exprimée en une seule phrase, c’est bien celle-ci : « On ne peut pas se fier à son propre esprit. »
Ce qui suit est une tentative de voir comment cette philosophie s’est manifestée dans la réalité.
Il aborde le sujet de la désinformation sous treize angles, à l’instar des « treize façons de regarder un merle », poème de Wallace Stevens datant de 1917, dans l’espoir que la synthèse de ces points de vue partiels donne une impression utile de la véritable forme de la désinformation et de son dessein ultime.
I. La russophobie revient, de manière inattendue : les origines de la « désinformation » contemporaine
Les fondements de la guerre de l’information actuelle ont été posés en réponse à une série d’événements qui se sont déroulés en 2014.
La Russie a d’abord tenté de réprimer le mouvement Euromaidan soutenu par les États-Unis en Ukraine ; quelques mois plus tard, elle a envahi la Crimée ; et plusieurs mois après, l’État islamique s’est emparé de la ville de Mossoul, dans le nord de l’Irak, et l’a déclarée capitale d’un nouveau califat.
Dans trois conflits distincts, un ennemi ou une puissance rivale des États-Unis a été considéré comme ayant utilisé avec succès non seulement la puissance militaire, mais aussi des campagnes de messagerie sur les médias sociaux conçues pour confondre et démoraliser ses ennemis – une combinaison connue sous le nom de « guerre hybride ».

Ces conflits ont convaincu les responsables de la sécurité des États-Unis et de l’OTAN que le pouvoir des médias sociaux de façonner les perceptions du public avait évolué au point de pouvoir décider de l’issue des guerres modernes – une issue qui pourrait être contraire à celle souhaitée par les États-Unis.
Ils en ont conclu que l’État devait se donner les moyens de prendre le contrôle des communications numériques afin de pouvoir présenter la réalité telle qu’il la souhaite et d’empêcher qu’elle ne devienne autre chose.
Techniquement, la guerre hybride désigne une approche qui combine des moyens militaires et non militaires – des opérations secrètes et clandestines mêlées à la cyberguerre et aux opérations d’influence – afin de désorienter et d’affaiblir une cible tout en évitant une guerre conventionnelle directe et à grande échelle.
Dans la pratique, elle est notoirement vague.
« Le terme couvre désormais tous les types d’activités russes perceptibles, de la propagande à la guerre conventionnelle, et tout ce qui existe entre les deux », a écrit Michael Kofman, analyste de la Russie, en mars 2016.
Au cours de la dernière décennie, la Russie a en effet employé à plusieurs reprises des tactiques associées à la guerre hybride, notamment en cherchant à cibler le public occidental par des messages diffusés sur des chaînes telles que RT et Sputnik News et par des opérations cybernétiques telles que l’utilisation de comptes de « trolls ».
Mais ces pratiques n’étaient pas nouvelles, même en 2014, et les États-Unis, ainsi que toutes les autres grandes puissances, s’y livraient également. Dès 2011, les États-Unis construisaient leurs propres « armées de trolls« en ligne en développant des logiciels pour « manipuler secrètement les sites de médias sociaux en utilisant de fausses personnalités en ligne pour influencer les conversations sur Internet et diffuser de la propagande pro-américaine ».
« C’est précisément ce qui a commencé à se produire quelques mois plus tard, lorsque les détracteurs de Trump ont popularisé l’idée qu’une main russe cachée était le marionnettiste des développements politiques à l’intérieur des États-Unis.
Le principal promoteur de cette affirmation est un ancien agent du FBI et analyste de la lutte contre le terrorisme, Clint Watts. Dans un article d’août 2016 intitulé « How Russia Dominates Your Twitter Feed to Promote Lies (And, Trump, Too) », Clint Watts et son coauteur, Andrew Weisburd, décrivent comment la Russie a relancé sa campagne « Active Measures » de l’époque de la guerre froide, en utilisant la propagande et la désinformation pour influencer les audiences étrangères.
En conséquence, selon l’article, les électeurs de Trump et les propagandistes russes promouvaient sur les médias sociaux les mêmes histoires destinées à faire passer l’Amérique pour faible et incompétente. Les auteurs affirment de manière extraordinaire que « la fusion des comptes favorables à la Russie et des électeurs de Trump dure depuis un certain temps ».
Si cela était vrai, cela signifiait que toute personne exprimant son soutien à Donald Trump pouvait être un agent du gouvernement russe, qu’elle ait ou non l’intention de jouer ce rôle. Cela signifiait que ceux qu’ils appelaient les « Trumpkins », qui représentaient la moitié du pays, attaquaient l’Amérique de l’intérieur. Cela signifiait que la politique était désormais une guerre, comme c’est le cas dans de nombreuses régions du monde, et que des dizaines de millions d’Américains étaient l’ennemi.
M. Watts s’est fait un nom en tant qu’analyste de la lutte contre le terrorisme en étudiant les stratégies de médias sociaux utilisées par ISIS, mais avec des articles comme celui-ci, il est devenu l’expert des médias sur les trolls russes et les campagnes de désinformation du Kremlin. Il semble qu’il ait également bénéficié de puissants soutiens.
Dans son livre L’assaut contre le renseignement, Michael Hayden, chef de la CIA à la retraite, a qualifié M. Watts d' »homme qui, plus que tout autre, a tenté de tirer la sonnette d’alarme plus de deux ans avant les élections de 2016″.
Dans son livre, M. Hayden attribue à M. Watts le mérite de lui avoir enseigné le pouvoir des médias sociaux :
« Watts m’a fait remarquer que Twitter rendait les faussetés plus crédibles par la simple répétition et le volume. Il l’a qualifié de « propagande informatique ». Twitter alimente à son tour les médias grand public ».
Une fausse histoire amplifiée algorithmiquement par Twitter et diffusée par les médias – ce n’est pas une coïncidence si cela décrit parfaitement les « conneries » diffusées sur Twitter à propos des opérations d’influence russes : en 2017, c’est Watts qui a eu l’idée du tableau de bord Hamilton 68 et qui a aidé à mener l’initiative.
II. L’élection de Trump : « C’est la faute de Facebook »
Personne ne pensait que Trump était un politicien normal.
En tant qu’ogre, Trump a horrifié des millions d’Américains qui ont ressenti une trahison personnelle dans la possibilité qu’il occupe le même poste que George Washington et Abe Lincoln.
Trump a également menacé les intérêts commerciaux des secteurs les plus puissants de la société. C’est cette dernière offense, plutôt que son racisme supposé ou son caractère non présidentiel flagrant, qui a plongé la classe dirigeante dans un état d’apoplexie.

Étant donné qu’il s’est concentré sur la réduction du taux d’imposition des sociétés, il est facile d’oublier que les responsables républicains et la classe des donateurs du parti considéraient Trump comme un dangereux radical qui menaçait leurs liens commerciaux avec la Chine, leur accès à une main-d’œuvre importée bon marché et l’activité lucrative de la guerre permanente. Mais c’est bien ainsi qu’ils le voyaient, comme en témoigne la réaction sans précédent à la candidature de Trump enregistrée par le Wall Street Journal en septembre 2016 :
« Aucun dirigeant des 100 plus grandes entreprises du pays n’avait fait de don à la campagne présidentielle du républicain Donald Trump jusqu’au mois d’août, un net revirement par rapport à 2012, lorsque près d’un tiers des PDG des entreprises du classement Fortune 100 avaient soutenu le candidat du GOP, Mitt Romney. »
Ce phénomène n’est pas propre à Trump. Bernie Sanders, le candidat populiste de gauche en 2016, était également considéré comme une menace dangereuse par la classe dirigeante. Mais alors que les démocrates ont réussi à saboter Sanders, Trump a réussi à franchir les barrières de son parti, ce qui signifie qu’il a dû être traité par d’autres moyens.
Deux jours après l’entrée en fonction de Donald Trump, le sénateur Chuck Schumer, tout sourire, a déclaré à Rachel Maddow, de la chaîne MSNBC, qu’il était « vraiment stupide » de la part du nouveau président de se mettre à dos les agences de sécurité qui étaient censées travailler pour lui :
« Laissez-moi vous dire que si vous vous attaquez à la communauté du renseignement, elle a six façons de se venger de vous à partir de dimanche. »
Trump avait utilisé des sites comme Twitter pour contourner les élites de son parti et entrer directement en contact avec ses partisans. Par conséquent, pour paralyser le nouveau président et s’assurer que personne comme lui ne puisse jamais revenir au pouvoir, les agences de renseignement devaient briser l’indépendance des plateformes de médias sociaux. Comme par hasard, il s’agissait de la même leçon que de nombreux responsables du renseignement et de la défense avaient tirée des campagnes d’ISIS et de la Russie en 2014 – à savoir que les médias sociaux étaient trop puissants pour être laissés en dehors du contrôle de l’État – mais appliquée à la politique intérieure, ce qui signifiait que les agences seraient désormais aidées par des politiciens qui avaient tout intérêt à profiter de l’effort.
Immédiatement après l’élection, Hillary Clinton a commencé à accuser Facebook d’être responsable de sa défaite. Jusqu’à présent, Facebook et Twitter s’étaient efforcés de rester en dehors de la mêlée politique, craignant de compromettre leurs profits potentiels en s’aliénant l’un ou l’autre parti. Mais un changement profond s’est produit, car l’opération derrière la campagne de Clinton s’est réorientée non seulement pour réformer les plateformes de médias sociaux, mais aussi pour les conquérir. La leçon qu’ils ont tirée de la victoire de Trump est que Facebook et Twitter – plus que le Michigan et la Floride – sont les champs de bataille cruciaux où les compétitions politiques sont gagnées ou perdues.
« Beaucoup d’entre nous commencent à parler de l’ampleur du problème », a déclaré Teddy Goff, stratège numérique en chef de Clinton, à Politico la semaine suivant l’élection, en faisant référence au rôle présumé de Facebook dans la diffusion de la désinformation russe qui a aidé Trump.
« Tant au niveau de la campagne que de l’administration, et plus largement de l’orbite d’Obama, c’est l’une des choses que nous aimerions aborder après l’élection », a déclaré M. Goff.
La presse a répété ce message si souvent qu’elle a donné à la stratégie politique l’apparence d’une validité objective :
- « Donald Trump a gagné grâce à Facebook ; New York Magazine, 9 novembre 2016.
- « Facebook, en porte-à-faux après les élections, remettrait en question son influence » ; The New York Times, 12 novembre 2016.
- La propagande russe a contribué à la diffusion de « fake news » pendant les élections, selon des experts ». The Washington Post, 24 novembre 2016.
- « La désinformation, et non les fausses nouvelles, a fait élire Trump, et elle ne s’arrête pas » ; The Intercept, 6 décembre 2016.
Et cela s’est poursuivi dans d’innombrables articles qui ont dominé le cycle de l’information pendant les deux années suivantes.
Dans un premier temps, Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, a qualifié d’« assez folle« l’accusation selon laquelle les « fake news » publiées sur sa plateforme avaient influencé le résultat de l’élection.
Mais Mark Zuckerberg a dû faire face à une campagne de pression intense au cours de laquelle tous les secteurs de la classe dirigeante américaine, y compris ses propres employés, lui ont reproché d’avoir placé un agent de Poutine à la Maison Blanche, l’accusant de fait de haute trahison. La goutte d’eau qui a fait déborder le vase est arrivée quelques semaines après l’élection, lorsque Obama lui-même a « dénoncé publiquement la diffusion de fausses nouvelles sur Facebook ».
Deux jours plus tard, Zuckerberg s’est plié à l’exercice : « Facebook annonce une nouvelle offensive contre les fake news après les commentaires d’Obama ».
L’affirmation fausse, mais fondamentale selon laquelle la Russie a piraté l’élection de 2016 a permis de justifier – tout comme les affirmations sur les armes de destruction massive qui ont déclenché la guerre d’Irak – de plonger l’Amérique dans un état d’exception en temps de guerre. Les règles normales de la démocratie constitutionnelle étant suspendues, une coterie d’agents du parti et de responsables de la sécurité a ensuite installé une nouvelle architecture de contrôle social, vaste et largement invisible, sur le backend des plus grandes plateformes d’internet.
Bien qu’il n’y ait jamais eu d’ordre public, le gouvernement américain a commencé à appliquer la loi martiale en ligne.
III. Pourquoi avons-nous besoin de toutes ces données sur les personnes ?
La doctrine américaine de la guerre contre-insurrectionnelle (COIN) appelle à « gagner les cœurs et les esprits ».
L’idée est que la victoire contre les groupes d’insurgés dépend de l’obtention du soutien de la population locale, ce qui ne peut être accompli par la seule force brute.

Dans des pays comme le Viêt Nam et l’Irak, le soutien a été obtenu en combinant la construction d’une nation et l’attrait pour les habitants en leur fournissant des biens qu’ils étaient supposés apprécier : de l’argent et des emplois, par exemple, ou de la stabilité.
Parce que les valeurs culturelles varient et que ce qui est apprécié par un villageois afghan peut sembler sans valeur à un comptable suédois, les contre-insurgés qui réussissent doivent apprendre à connaître les motivations de la population locale. Pour conquérir un esprit, il faut d’abord y pénétrer pour comprendre ses désirs et ses craintes.
En cas d’échec, il existe une autre approche dans l’arsenal militaire moderne pour la remplacer : le contre-terrorisme. Là où la contre-insurrection tente de gagner le soutien local, le contre-terrorisme tente de traquer et de tuer les ennemis désignés.
Malgré l’apparente tension entre leurs approches opposées, les deux stratégies ont souvent été utilisées en tandem. Toutes deux s’appuient sur de vastes réseaux de surveillance pour recueillir des renseignements sur leurs cibles, qu’il s’agisse de savoir où creuser des puits ou de localiser des terroristes afin de les tuer.
Mais le contre-insurgé en particulier s’imagine que s’il peut en apprendre suffisamment sur une population, il sera possible de réorganiser sa société.
Pour obtenir des réponses, il suffit d’utiliser les bonnes ressources : une combinaison d’outils de surveillance et de méthodes de sciences sociales, dont les résultats communs alimentent des bases de données centralisées toutes puissantes, censées contenir la totalité de la guerre.
En réfléchissant à mon expérience en tant qu’officier de renseignement de l’armée américaine en Afghanistan, j’ai observé que « les outils d’analyse de données à la portée de toute personne ayant accès à un centre d’opérations ou à une salle de crise semblaient promettre la convergence imminente de la carte et du territoire », mais qu’ils ont fini par devenir un piège, car « les forces américaines pouvaient mesurer des milliers d’éléments différents que nous ne pouvions pas comprendre ».
Nous avons essayé de combler ce déficit en acquérant encore plus de données. Si seulement nous pouvions rassembler suffisamment d’informations et les harmoniser avec les bons algorithmes, nous pensions que la base de données devinerait l’avenir.
Ce cadre est non seulement fondamental pour la doctrine américaine moderne de contre-insurrection, mais il a également été à l’origine de la construction de l’internet.
Le Pentagone a construit le proto-internet connu sous le nom d’ARPANET en 1969 parce qu’il avait besoin d’une infrastructure de communication décentralisée capable de survivre à une guerre nucléaire, mais ce n’était pas le seul objectif.
L’internet, écrit Yasha Levine dans son histoire du sujet, Surveillance Valley, était aussi « une tentative de construire des systèmes informatiques capables de collecter et de partager des renseignements, d’observer le monde en temps réel, d’étudier et d’analyser les gens et les mouvements politiques dans le but ultime de prédire et de prévenir les bouleversements sociaux ».
« Certains ont même rêvé de créer une sorte de radar d’alerte précoce pour les sociétés humaines : un système informatique en réseau qui surveillerait les menaces sociales et politiques et les intercepterait de la même manière que les radars traditionnels le faisaient pour les avions hostiles. »
À l’époque du « programme de liberté » de l’internet, la mythologie populaire de la Silicon Valley la dépeignait comme un laboratoire de monstres, d’autodidactes, de libres penseurs et de bricoleurs libertaires qui voulaient simplement faire des choses géniales sans que le gouvernement ne les ralentisse.
L’autre version de l’histoire, décrite dans le livre de M. Levine, souligne que l’internet « a toujours eu une nature à double usage, enracinée dans la collecte de renseignements et la guerre ». Il y a du vrai dans les deux versions, mais après 2001, la distinction a disparu.
Comme l’écrit Shoshana Zuboff dans L’ère du capitalisme de surveillance, au début de la guerre contre le terrorisme, « l’affinité élective entre les agences de renseignement publiques et le capitalisme de surveillance naissant Google s’est épanouie dans le feu de l’action pour produire une difformité historique unique : l’exceptionnalisme de la surveillance ».
En Afghanistan, l’armée a dû recourir à des drones coûteux et à des « équipes de terrain humain » composées d’universitaires aventureux pour sonder la population locale et en extraire les données sociologiques pertinentes.
Mais comme les Américains passent des heures par jour à alimenter volontairement les monopoles de données liés au secteur de la défense avec leurs moindres pensées, il a dû sembler trivialement facile à quiconque contrôlant les bases de données de manipuler les sentiments de la population dans son pays.
Il y a plus de dix ans, le Pentagone a commencé à financer le développement d’ une série d’outils pour détecter et contrer les messages terroristes sur les médias sociaux.
Certains faisaient partie d’une initiative plus large de « guerre mémétique« au sein de l’armée, qui comprenait des propositions visant à utiliser les mèmes pour « vaincre une idéologie ennemie et gagner les masses de non-combattants indécis », mais la plupart des programmes, lancés en réponse à la montée d’ISIS et à l’utilisation habile des médias sociaux par le groupe djihadiste, se sont concentrés sur le renforcement des moyens automatisés de détection et de censure de la messagerie terroriste en ligne.
Ces efforts ont culminé en janvier 2016 avec l’annonce par le département d’État de l’ouverture du Centre d’engagement mondial susmentionné, dirigé par Michael Lumpkin. Quelques mois plus tard, le président Obama a confié au GEC la responsabilité de la nouvelle guerre contre la désinformation.
Le jour même de l’annonce de la création du GEC, M. Obama et « divers membres de haut rang de l’establishment de la sécurité nationale ont rencontré des représentants de Facebook, Twitter, YouTube et d’autres puissances de l’Internet pour discuter de la manière dont les États-Unis peuvent lutter contre les messages d’ISIS par le biais des médias sociaux ».
Dans le sillage des bouleversements populistes de 2016, des figures de proue du parti au pouvoir aux États-Unis se sont emparées de la boucle de rétroaction de la surveillance et du contrôle affinée par la guerre contre le terrorisme comme méthode de maintien du pouvoir à l’intérieur des États-Unis.
Les armes créées pour combattre ISIS et Al-Qaïda ont été retournées contre les Américains qui nourrissaient des pensées incorrectes sur le président ou les boosters de vaccins ou les pronoms de genre ou la guerre en Ukraine.
L’ancien fonctionnaire du département d’État Mike Benz, qui dirige aujourd’hui une organisation appelée Foundation for Freedom Online (Fondation pour la liberté en ligne ) qui se présente comme un organisme de surveillance de la liberté d’expression numérique, décrit comment une société appelée Graphika, qui est « essentiellement un consortium de censure financé par le ministère américain de la Défense » et qui a été créée pour lutter contre les terroristes, a été réaffectée à la censure de l’expression politique aux États-Unis. La société, « initialement financée pour aider à effectuer un travail de contre-insurrection sur les médias sociaux dans les zones de conflit pour l’armée américaine », a ensuite été « redéployée au niveau national pour la censure de Covid et la censure politique », a déclaré M. Benz à un intervieweur.
« Graphika a été déployé pour surveiller le discours sur les médias sociaux concernant Covid et les origines de Covid, les conspirations de Covid ou les questions de Covid.
La lutte contre ISIS s’est transformée en lutte contre Trump et la « collusion russe », qui s’est transformée en lutte contre la désinformation.
Mais il ne s’agissait que de changements de marque ; l’infrastructure technologique sous-jacente et la philosophie de la classe dirigeante, qui revendiquait le droit de refaire le monde sur la base d’un sens religieux de l’expertise, sont restées inchangées.
L’art humain de la politique, qui aurait nécessité de véritables négociations et compromis avec les partisans de Trump, a été abandonné au profit d’une science spécieuse de l’ingénierie sociale descendante visant à produire une société totalement administrée.
Pour la classe dirigeante américaine, la COIN a remplacé la politique comme moyen approprié de traiter avec les indigènes.
IV. L’Internet : du chouchou au démon
Il fut un temps où l’internet allait sauver le monde. Le premier boom des dot-com dans les années 1990 a popularisé l’idée que l’internet était une technologie permettant de maximiser le potentiel humain et de répandre la démocratie.
Le document « Un cadre pour le commerce électronique mondial », publié en 1997 par l’administration Clinton, présentait la vision suivante :
« L’internet est un média qui a de formidables possibilités de développement :
« L’Internet est un média qui a un potentiel énorme pour promouvoir la liberté individuelle et l’autonomisation de l’individu » et « par conséquent, dans la mesure du possible, l’individu devrait être laissé maître de la manière dont il ou elle utilise ce média ».
Les personnes intelligentes de l’Occident se sont moquées des efforts naïfs déployés dans d’autres parties du monde pour contrôler le flux d’informations.
En 2000, le président Clinton s’est moqué du fait que la répression de l’internet en Chine était « comme essayer de clouer de la gelée au mur ».
Le battage médiatique s’est poursuivi sous l’administration Bush, lorsque les sociétés Internet ont été considérées comme des partenaires essentiels du programme de surveillance de masse de l’État et de son projet d’instauration de la démocratie au Moyen-Orient.
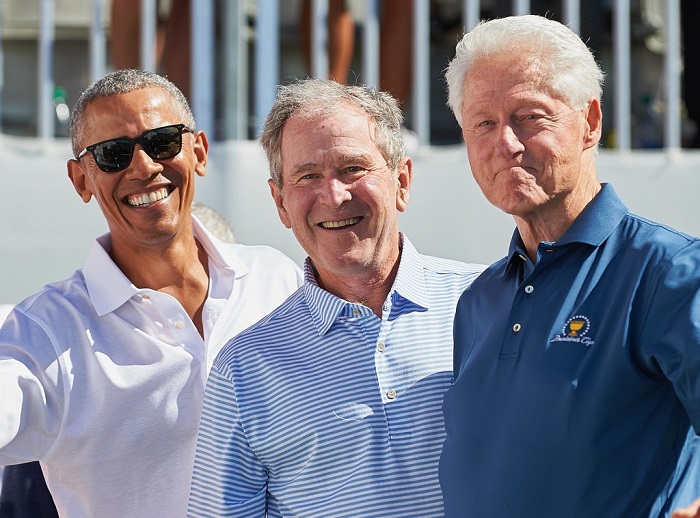
Mais le battage médiatique s’est vraiment emballé lorsque le président Obama a été élu grâce à une campagne axée sur les « big data » qui a donné la priorité à la diffusion sur les médias sociaux.
Il semblait y avoir un véritable alignement philosophique entre le style politique d’Obama, président de l’« espoir » et du « changement » dont le principe directeur en matière de politique étrangère était « Ne faites pas de conneries », et la société de recherche sur internet dont la devise initiale était « Ne faites pas le mal ».
Des liens personnels étroits unissaient également les deux pouvoirs, avec 252 cas, au cours de la présidence d’Obama, de personnes passant d’un emploi à l’autre, à la Maison Blanche et chez Google. De 2009 à 2015, les employés de la Maison-Blanche et de Google se rencontraient en moyenne plus d’une fois par semaine.
En tant que secrétaire d’État d’Obama, Hillary Clinton a dirigé le programme gouvernemental de « liberté sur Internet », qui visait à « promouvoir les communications en ligne en tant qu’outil d’ouverture des sociétés fermées ».
Dans un discours prononcé en 2010, Hillary Clinton a mis en garde contre l’expansion de la censure numérique dans les régimes autoritaires :
« Un nouveau rideau d’information est en train de s’abattre sur une grande partie du monde », a-t-elle déclaré. « Et au-delà de ce rideau, les vidéos virales et les articles de blog sont en train de devenir le samizdat de notre époque. »
L’ironie suprême veut que les mêmes personnes qui, il y a dix ans, menaient l’agenda de la liberté pour d’autres pays aient depuis poussé les États-Unis à mettre en place l’une des machines de censure les plus importantes et les plus puissantes qui existent, sous couvert de lutte contre la désinformation.
L’ironie n’est peut-être pas le mot juste pour décrire la différence entre le Clinton épris de liberté d’il y a dix ans et l’activiste pro-censure d’aujourd’hui, mais elle permet de saisir ce qui semble être la volte-face d’une catégorie de personnes qui étaient les porte-drapeaux publics d’idées radicalement différentes à peine dix ans plus tôt.
Ces personnes – des hommes politiques, avant tout – voyaient (et présentaient) la liberté de l’internet comme une force positive pour l’humanité lorsqu’elle leur donnait du pouvoir et servait leurs intérêts, mais comme quelque chose de démoniaque lorsqu’elle brisait ces hiérarchies de pouvoir et profitait à leurs opposants.
Voilà comment combler le fossé entre la Hillary Clinton de 2013 et la Clinton de 2023 : toutes deux considèrent Internet comme un outil extrêmement puissant pour conduire les processus politiques et opérer des changements de régime.
C’est pourquoi, dans le monde de Clinton et d’Obama, l’ascension de Donald Trump a été perçue comme une profonde trahison – parce que, selon eux, la Silicon Valley aurait pu l’arrêter, mais ne l’a pas fait.
En tant que responsables de la politique gouvernementale en matière d’internet, ils avaient aidé les entreprises technologiques à bâtir leur fortune sur la surveillance de masse et avaient évangélisé l’internet comme un phare de la liberté et du progrès, tout en fermant les yeux sur leurs violations flagrantes des lois antitrust.
En retour, les entreprises technologiques ont commis l’impensable, non pas parce qu’elles ont permis à la Russie de « pirater l’élection », une accusation désespérée lancée pour masquer l’odeur de l’échec, mais parce qu’elles ont refusé d’intervenir pour empêcher la victoire de Donald Trump.
Dans son livre Qui détient l’avenir ?, le pionnier de la technologie Jaron Lanier écrit :
« L’activité principale des réseaux numériques est désormais la création de méga-dossiers ultra-secrets sur ce que font les autres, et l’utilisation de ces informations pour concentrer l’argent et le pouvoir ».
Les économies numériques produisant des concentrations toujours plus grandes de données et de pouvoir, l’inévitable s’est produit : les entreprises technologiques sont devenues trop puissantes.
Que pouvaient faire les dirigeants du parti au pouvoir ? Deux options s’offrent à eux.
Ils pouvaient utiliser le pouvoir réglementaire du gouvernement pour contre-attaquer : briser les monopoles de données et restructurer le contrat social qui sous-tend l’internet afin que les individus conservent la propriété de leurs données au lieu de se les faire arracher chaque fois qu’ils cliquent sur un espace public.
Ou bien, ils pourraient préserver le pouvoir des entreprises technologiques tout en les forçant à abandonner le simulacre de neutralité et à se ranger derrière le parti au pouvoir – une perspective tentante, compte tenu de ce qu’ils pourraient faire avec tout ce pouvoir.
Ils ont choisi l’option B.
En déclarant les plateformes coupables d’avoir élu Trump – un candidat tout aussi détestable pour les élites hautement éduquées de la Silicon Valley qu’il l’était pour les élites hautement éduquées de New York et de Washington -, on a fourni le club que les médias et la classe politique ont utilisé pour battre les entreprises technologiques afin qu’elles deviennent plus puissantes et plus obéissantes.
V. Russiagate ! Russiagate ! Russiagate !
Si l’on imagine que la classe dirigeante américaine était confrontée à un problème – Donald Trump semblait menacer sa survie institutionnelle – l’enquête sur la Russie n’a pas seulement fourni les moyens d’unir les différentes branches de cette classe, à l’intérieur et à l’extérieur du gouvernement, contre un ennemi commun.
Elle leur a également donné la forme ultime d’influence sur le secteur non aligné le plus puissant de la société : l’industrie technologique. La coordination nécessaire pour mener à bien la machination de la collusion russe était le véhicule, fusionnant:
1. Les objectifs politiques du Parti démocrate,
2. L’agenda institutionnel des agences de renseignement et de sécurité,
3. Le pouvoir narratif et la ferveur morale des médias avec…
4. L’architecture de surveillance des entreprises technologiques.
Le mandat secret de la FISA qui a permis aux agences de sécurité américaines de commencer à espionner la campagne de Trump était basé sur le dossier Steele, un travail de hache partisan payé par l’équipe d’Hillary Clinton qui consistait en des rapports manifestement faux alléguant une relation de travail entre Donald Trump et le gouvernement russe.
Bien qu’il ait été une arme puissante à court terme contre Trump, le dossier était aussi une connerie évidente, ce qui laissait supposer qu’il pourrait éventuellement devenir un handicap.
La désinformation a résolu ce problème tout en plaçant une arme de qualité nucléaire dans l’arsenal de la résistance anti-Trump.

Au début, la désinformation n’était qu’un point de discussion parmi une demi-douzaine d’autres dans le camp anti-Trump. Elle l’emportait sur les autres parce qu’elle était capable d’expliquer tout et n’importe quoi tout en restant si ambiguë qu’elle ne pouvait être réfutée.
Sur le plan défensif, il a permis d’attaquer et de discréditer quiconque remettait en question le dossier ou l’affirmation plus large selon laquelle Trump était de connivence avec la Russie.
Tous les vieux trucs maccarthystes ont été remis au goût du jour. Le Washington Post a affirmé avec force que la désinformation avait fait basculer l’élection de 2016, une croisade qui a commencé dans les jours qui ont suivi la victoire de Trump, avec l’article « La propagande russe a contribué à la diffusion de « fake news » pendant les élections, selon des experts ». Le principal expert cité dans l’article est Clint Watts.
Un flux régulier de fuites de responsables du renseignement à des journalistes spécialisés dans la sécurité nationale avait déjà établi le faux récit selon lequel il existait des preuves crédibles de collusion entre la campagne de Trump et le Kremlin.
Lorsque Trump a gagné en dépit de ces rapports, les hauts fonctionnaires responsables de leur diffusion, en particulier le chef de la CIA John Brennan, ont redoublé d’efforts.
Deux semaines avant l’entrée en fonction de Trump, l’administration Obama a publié une version déclassifiée d’une évaluation de la communauté du renseignement, connue sous le nom d’ICA, sur les « Activités et intentions russes dans les récentes élections », qui affirmait que « Poutine et le gouvernement russe ont développé une nette préférence pour le président élu Trump ».
L’ICA a été présenté comme le consensus objectif et apolitique atteint par de multiples agences de renseignement.
Dans la Columbia Journalism Review, Jeff Gerth écrit que l’évaluation a fait l’objet d’une « couverture massive et largement non critique » dans la presse.
En réalité, l’ICA était tout le contraire : un document politique élaboré de manière sélective qui omettait délibérément les preuves contraires afin de donner l’impression que la collusion n’était pas une rumeur largement contestée, mais un fait objectif.
Un rapport classifié de la commission du renseignement de la Chambre des représentants sur la création de l’ICA a montré à quel point elle était inhabituelle et manifestement politique.
« Ce ne sont pas 17 agences, ni même une douzaine d’analystes des trois agences qui ont rédigé l’évaluation », a déclaré au journaliste Paul Sperry un haut responsable du renseignement qui a lu une version préliminaire du rapport de la Chambre des représentants.
« Seuls cinq agents de la CIA l’ont rédigée, et M. Brennan les a choisis tous les cinq. Et le rédacteur principal était un bon ami de Brennan ».
Nommé par M. Obama, M. Brennan avait rompu avec les précédents en se mêlant de politique alors qu’il était directeur de la CIA. Cela a ouvert la voie à sa carrière post-gouvernementale en tant qu’analyste de MSNBC et figure de la « résistance », qui a fait les gros titres en accusant Trump de trahison.
Mike Pompeo, qui a succédé à Brennan à la CIA, a déclaré qu’en tant que directeur de l’agence, il avait appris que « des analystes chevronnés qui travaillaient sur la Russie depuis presque toute leur carrière étaient devenus des spectateurs » lors de la rédaction de l’ICA. Selon Sperry, Brennan « a exclu du rapport des preuves contradictoires sur les motivations de Poutine, malgré les objections de certains analystes du renseignement qui soutenaient que Poutine comptait sur la victoire de Clinton et considérait Trump comme un ‘joker' ». (C’est également Brennan qui a passé outre les objections d’autres agences pour inclure le dossier Steele dans l’évaluation officielle).
Malgré ses irrégularités, l’ICA a fonctionné comme prévu : Trump a commencé sa présidence sous un nuage de suspicion qu’il n’a jamais pu dissiper. Comme l’avait promis Schumer, les responsables du renseignement n’ont pas tardé à prendre leur revanche.
Et ce n’est pas seulement une vengeance, mais aussi une action planifiée à l’avance.
L’affirmation selon laquelle la Russie a piraté le scrutin de 2016 a permis aux agences fédérales de mettre en œuvre le nouveau mécanisme de censure public-privé sous le prétexte de garantir « l’intégrité des élections ».
Les personnes qui ont exprimé des opinions vraies et protégées par la Constitution sur l’élection de 2016 (et plus tard sur des questions telles que le COVID-19 et le retrait des États-Unis d’Afghanistan) ont été qualifiées de non américaines, de racistes, de conspirationnistes et de laquais de Vladimir Poutine, et ont été systématiquement éliminées de la place publique numérique pour empêcher que leurs idées ne répandent la désinformation.
Selon une estimation extrêmement prudente basée sur les rapports publics, il y a eu des dizaines de millions de cas de censure de ce type depuis l’élection de Trump.
Et voici le point culminant de cet article : Le 6 janvier 2017 – le jour même où le rapport de l’ICA de Brennan a apporté un soutien institutionnel à la fausse affirmation selon laquelle Poutine aurait aidé Trump – Joe Johnson, le secrétaire sortant du ministère de la Sécurité intérieure nommé par Obama, a annoncé qu’en réponse à l’ingérence électorale russe, il avait désigné les systèmes électoraux américains comme « infrastructure nationale critique ».
Cette décision a placé les biens de 8 000 administrations électorales du pays sous le contrôle du ministère de la Sécurité intérieure.
C’était un coup que Johnson tentait de réaliser depuis l’été 2016, mais qui, comme il l’a expliqué dans un discours ultérieur, a été bloqué par les acteurs locaux qui lui ont dit « que la gestion des élections dans ce pays était la responsabilité souveraine et exclusive des États, et qu’ils ne voulaient pas d’une intrusion fédérale, d’une prise de contrôle fédérale ou d’une réglementation fédérale de ce processus. »
Johnson a donc trouvé une solution de contournement en faisant adopter unilatéralement la mesure dans les derniers jours de son mandat.
On comprend maintenant pourquoi Johnson était si pressé : en l’espace de quelques années, toutes les affirmations utilisées pour justifier la saisie fédérale extraordinaire du système électoral du pays allaient s’effondrer.
En juillet 2019, le rapport Mueller a conclu que Donald Trump n’était pas entré en collusion avec le gouvernement russe – la même conclusion à laquelle est parvenu le rapport de l’inspecteur général sur les origines de l’enquête Trump-Russie, publié plus tard dans l’année.
Enfin, le 9 janvier 2023, le Washington Post a discrètement publié dans son bulletin d’information sur la cybersécurité un addendum à l’étude du Center for Social Media and Politics de l’Université de New York. Sa conclusion :
« Les trolls russes sur Twitter ont eu peu d’influence sur les électeurs de 2016 ».
Mais à ce moment-là, cela n’avait plus d’importance. Au cours des deux dernières semaines de l’administration Obama, le nouvel appareil de contre-désinformation a remporté l’une de ses plus importantes victoires : le pouvoir de superviser directement les élections fédérales, ce qui aurait de profondes conséquences pour la compétition de 2020 entre Trump et Joe Biden.
VI. Pourquoi la « guerre contre la terreur » de l’après 11 septembre n’a jamais pris fin
Clint Watts, qui a dirigé l’initiative Hamilton 68, et Michael Hayden, l’ancien général de l’armée de l’air, chef de la CIA et directeur de la NSA qui a défendu Watts, sont tous deux des vétérans de l’establishment antiterroriste américain.
Hayden compte parmi les plus hauts responsables du renseignement que les États-Unis aient jamais produits et a été l’un des principaux architectes du système de surveillance de masse mis en place après le 11 septembre. En effet, un pourcentage stupéfiant des figures clés du complexe de contre-désinformation ont fait leurs armes dans les mondes de la lutte contre le terrorisme et de la guerre contre-insurrectionnelle.

Michael Lumpkin, qui a dirigé le GEC, l’agence du département d’État qui a servi de premier centre de commandement dans la guerre contre la désinformation, est un ancien Navy SEAL ayant une expérience de la lutte contre le terrorisme. Le GEC lui-même est issu du Centre de communication stratégique antiterroriste avant d’être réorienté vers la lutte contre la désinformation.
Twitter avait la possibilité d’arrêter le canular Hamilton 68 avant qu’il ne devienne incontrôlable, mais il a choisi de ne pas le faire. Pourquoi ?
La réponse se trouve dans les courriels envoyés par une responsable de Twitter, Emily Horne, qui déconseillait de dénoncer l’escroquerie.
Twitter disposait d’une preuve irréfutable que l’Alliance pour la sécurisation de la démocratie, le groupe de réflexion néolibéral à l’origine de l’initiative Hamilton 68, était coupable de l’accusation qu’il portait contre d’autres : colporter de la désinformation pour attiser les divisions politiques nationales et saper la légitimité des institutions démocratiques.
Mais cela doit être mis en balance avec d’autres facteurs, a suggéré M. Horne, tels que la nécessité de rester dans le collimateur d’une organisation puissante.
« Nous devons être prudents dans la manière dont nous nous opposons publiquement à l’ASD », a-t-elle écrit en février 2018.
L’ASD a eu de la chance d’avoir quelqu’un comme Horne à l’intérieur de Twitter. Mais ce n’était peut-être pas de la chance. Mme Horne avait déjà travaillé au département d’État, où elle s’occupait du portefeuille « médias numériques et sensibilisation des groupes de réflexion ».
Selon son profil LinkedIn, elle « a travaillé en étroite collaboration avec des journalistes de politique étrangère couvrant [ISIS] […] et a exécuté des plans de communication relatifs aux activités de la Coalition contre [ISIS] ».
En d’autres termes, elle avait une expérience des opérations antiterroristes similaire à celle de M. Watts, mais plus axée sur la communication avec la presse et les groupes de la société civile.
De là, elle est devenue directrice des communications stratégiques pour le Conseil de sécurité nationale d’Obama, qu’elle n’a quitté que pour rejoindre Twitter en juin 2017.
Si l’on met l’accent sur cette chronologie, voici ce qu’elle révèle : Horne a rejoint Twitter un mois avant le lancement de l’ASD, juste à temps pour plaider en faveur de la protection d’un groupe dirigé par le type de courtiers en pouvoir qui détenaient les clés de son avenir professionnel.
Ce n’est pas une coïncidence si la guerre contre la désinformation a commencé au moment même où la Guerre Mondiale Contre la Terreur (GWOT-Global War on Terrorism Service Medal) semblait enfin toucher à sa fin.
Pendant deux décennies, la GWOT a concrétisé les avertissements du président Dwight Eisenhower concernant la montée en puissance d’un complexe militaro-industriel exerçant une « influence injustifiée ».
Elle s’est transformée en une industrie intéressée, qui se justifie elle-même, employant des milliers de personnes au sein et en dehors du gouvernement, qui opèrent sans contrôle clair ni utilité stratégique. Il aurait peut-être été possible pour les services de sécurité américains de déclarer la victoire et de passer d’une position de guerre permanente à une position de temps de paix, mais comme me l’a expliqué un ancien responsable de la sécurité nationale à la Maison Blanche, c’était peu probable.
« Si vous travaillez dans la lutte contre le terrorisme, il n’y a aucune raison de dire que vous êtes en train de gagner, de leur botter le cul, et qu’ils sont une bande de perdants. Il s’agit avant tout d’exagérer la menace ».
Il a décrit « d’énormes incitations à gonfler la menace » qui ont été intériorisées dans la culture de l’establishment de la défense américaine et qui sont « d’une nature telle qu’elles n’exigent pas que l’on soit particulièrement lâche ou intellectuellement malhonnête ».
« Cette énorme machinerie a été construite autour de la guerre contre le terrorisme », a déclaré le fonctionnaire.
« Une infrastructure massive qui comprend le monde du renseignement, tous les éléments du ministère de la Défense, y compris les commandements de combat, la CIA et le FBI et toutes les autres agences. Et puis il y a tous les contractants privés et la demande des groupes de réflexion. Ce sont des milliards et des milliards de dollars qui sont en jeu. »
Le passage sans heurt de la guerre contre la terreur à la guerre contre la désinformation était donc, dans une large mesure, une simple question d’autopréservation professionnelle.
Mais cela n’a pas suffi à maintenir le système précédent ; pour survivre, il fallait continuellement élever le niveau de la menace.
Dans les mois qui ont suivi les attentats du 11 septembre 2001, George W. Bush a promis d’assécher les marais du radicalisme au Moyen-Orient. Ce n’est qu’en rendant la région sûre pour la démocratie, disait-il, qu’il pourrait s’assurer qu’elle cesserait de produire des djihadistes violents comme Oussama ben Laden.
Aujourd’hui, pour assurer la sécurité de l’Amérique, il ne suffit plus d’envahir le Moyen-Orient et d’apporter la démocratie à ses habitants.
Selon la Maison Blanche de Biden et l’armée d’experts en désinformation, la menace vient désormais de l’intérieur.
Un réseau d’extrémistes de droite, de fanatiques de QAnon et de nationalistes blancs est soutenu par une population beaucoup plus large de quelque 70 millions d’électeurs de Trump dont les sympathies politiques constituent une cinquième colonne à l’intérieur des États-Unis.
Mais comment ces personnes se sont-elles radicalisées pour accepter le jihad blanc amer et destructeur de l’idéologie Trumpiste ?
Par l’internet, bien sûr, où les entreprises technologiques, en refusant de « faire plus » pour combattre le fléau des discours de haine et des « fake news », ont permis à la désinformation toxique d’empoisonner l’esprit des utilisateurs.
Après le 11 septembre, la menace terroriste a été utilisée pour justifier des mesures telles que le Patriot Act, qui a suspendu les droits constitutionnels et placé des millions d’Américains sous une surveillance de masse.
Ces politiques, autrefois controversées, ont fini par être acceptées comme les prérogatives naturelles du pouvoir de l’État.
Comme l’a fait remarquer le journaliste Glenn Greenwald, la directive de George W. Bush « avec nous ou avec les terroristes » a suscité une certaine indignation à l’époque, mais elle est aujourd’hui la mentalité dominante au sein du libéralisme américain et du parti démocrate au sens large ».
La guerre contre le terrorisme a été un échec cuisant qui s’est soldé par le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan. Elle est également devenue très impopulaire auprès de l’opinion publique. Pourquoi, alors, les Américains choisiraient-ils de confier aux dirigeants et aux sages de cette guerre le soin de mener une guerre encore plus vaste contre la désinformation ?
On peut se risquer à une supposition : les Américains ne les ont pas choisis. Les Américains ne sont plus censés avoir le droit de choisir leurs propres dirigeants ou de remettre en question les décisions prises au nom de la sécurité nationale. Quiconque dit le contraire peut être qualifié d’extrémiste national.
VII. La montée en puissance des « extrémistes nationaux »
Quelques semaines après les émeutes des partisans de Trump au Capitole le 6 janvier 2021, l’ancien directeur du Centre de lutte contre le terrorisme de la CIA, Robert Grenier, a écrit un article pour le New York Times dans lequel il préconise que les États-Unis mènent un « programme global de contre-insurrection » contre leurs propres citoyens.
La contre-insurrection, comme le sait Grenier, n’est pas une opération chirurgicale limitée, mais un vaste effort mené dans toute une société et qui implique inévitablement des destructions collatérales. Il ne suffirait pas de cibler les extrémistes les plus violents qui ont attaqué les forces de l’ordre au Capitole pour vaincre l’insurrection.
La victoire nécessiterait de gagner les cœurs et les esprits des autochtones – dans ce cas, les chrétiens sans avenir et les populistes ruraux radicalisés par leurs griefs pour embrasser le culte du MAGA, semblable à celui de Ben Laden.
Heureusement pour le gouvernement, il existe un cadre d’experts disponibles pour traiter ce problème difficile : des gens comme Grenier, qui travaille aujourd’hui comme consultant dans le secteur privé de la lutte contre le terrorisme, où il est employé depuis qu’il a quitté la CIA.
Bien sûr, il y a des extrémistes violents en Amérique, comme il y en a toujours eu. Toutefois, le problème est moins grave aujourd’hui qu’il ne l’était dans les années 1960 et 1970, lorsque la violence politique était plus fréquente.
Les affirmations exagérées concernant une nouvelle race d’extrémisme domestique si dangereuse qu’elle ne peut être traitée par les lois existantes, y compris les lois sur le terrorisme domestique, sont elles-mêmes un produit de la guerre de l’information menée par les États-Unis, qui a effacé la différence entre le discours et l’action.
« Les guerres civiles ne commencent pas par des coups de feu. Elles commencent par des mots », a proclamé Clint Watts en 2017 lors de son témoignage devant le Congrès.
« La guerre de l’Amérique contre elle-même a déjà commencé. Nous devons tous agir maintenant sur le champ de bataille des médias sociaux pour réprimer les rébellions de l’information qui peuvent rapidement déboucher sur des confrontations violentes. »
Watts est un vétéran de l’armée et du gouvernement qui semble partager la conviction, commune à ses collègues, qu’une fois que l’internet est entré dans sa phase populiste et a menacé des hiérarchies bien établies, il est devenu un grave danger pour la civilisation.
Mais il s’agit là d’une réponse craintive, fondée sur des croyances largement, et sans doute sincèrement, partagées au sein du Beltway, qui a pris pour un acte de guerre une réaction populiste tout aussi sincère, qualifiée de « révolte du public » par l’ancien analyste de la CIA Martin Gurri. La norme introduite par Watts et d’autres, qui est rapidement devenue le consensus de l’élite, traite les tweets et les mèmes – les principales armes de désinformation – comme des actes de guerre.
Le recours à la catégorie floue de la désinformation a permis aux experts en sécurité d’associer les mèmes racistes aux fusillades de masse de Pittsburgh et de Buffalo et aux manifestations violentes comme celle qui s’est déroulée au Capitole.
Il s’agissait d’une rubrique permettant de catastrophiser les discours et de maintenir un état de peur et d’urgence permanent. Et elle a reçu le soutien total du Pentagone, de la communauté du renseignement et du président Biden, qui tous, note Glenn Greenwald, ont déclaré que « la menace la plus grave pour la sécurité nationale américaine » n’est pas la Russie, l’ISIS, la Chine, l’Iran ou la Corée du Nord, mais « les extrémistes nationaux en général – et les groupes suprémacistes blancs d’extrême droite en particulier ».
L’administration Biden n’a cessé de développer les programmes de lutte contre le terrorisme intérieur et l’extrémisme. En février 2021, les responsables du DHS ont annoncé qu’ils avaient reçu des fonds supplémentaires pour renforcer les efforts déployés à l’échelle du département pour « prévenir le terrorisme intérieur », y compris une initiative visant à contrer la propagation de la désinformation en ligne, qui utilise une approche apparemment empruntée au manuel soviétique, appelée « inoculation attitudinale ».

VIII. L’ONG Borg
En novembre 2018, le Shorenstein Center on Media Politics and Public Policy.de la Harvard Kennedy School a publié une étude intitulée « La lutte contre la désinformation aux États-Unis : une analyse du paysage ».
Le champ d’application du document est complet, mais ses auteurs se concentrent particulièrement sur la centralité des organisations à but non lucratif financées par la philanthropie et sur leur relation avec les médias.
Le Centre Shorenstein est un nœud clé dans le complexe décrit dans le document, ce qui confère aux observations des auteurs un point de vue d’initié.
« Dans cette analyse du paysage, il est apparu qu’un certain nombre de défenseurs clés qui interviennent pour sauver le journalisme ne sont pas des entreprises, des plateformes ou le gouvernement des États-Unis, mais plutôt des fondations et des philanthropes qui craignent la perte d’une presse libre et le fondement d’une société saine. »[…]
« Aucun des acteurs faisant autorité – le gouvernement et les plateformes qui diffusent le contenu – n’étant intervenu assez rapidement pour résoudre le problème, il incombe désormais aux rédactions, aux universités et aux fondations de signaler ce qui est authentique et ce qui ne l’est pas. »
Pour sauver le journalisme, pour sauver la démocratie elle-même, les Américains devraient compter sur les fondations et les philanthropes – des gens comme Pierre Omidyar, fondateur d’eBay, George Soros, de l’Open Society Foundations, et Reid Hoffman, entrepreneur de l’Internet et collecteur de fonds pour le Parti démocrate.
En d’autres termes, les Américains étaient invités à s’en remettre à des milliardaires privés qui injectaient des milliards de dollars dans des organisations civiques, par l’intermédiaire desquelles ils influenceraient le processus politique américain.
Il n’y a aucune raison de mettre en doute les motivations des collaborateurs de ces ONG, dont la plupart étaient sans doute parfaitement sincères dans la conviction que leur travail consistait à restaurer les « fondements d’une société saine ».
Mais certaines observations peuvent être faites sur la nature de ce travail.
- Tout d’abord, ce mandat les plaçait au-dessous des philanthropes milliardaires, mais au-dessus de centaines de millions d’Américains qu’ils devaient guider et instruire comme une nouvelle cléricature de l’information en séparant la vérité du mensonge, le bon grain de l’ivraie.
- Deuxièmement, ce mandat, et l’énorme financement qui l’accompagne, a ouvert des milliers de nouveaux emplois pour les régulateurs de l’information à un moment où le journalisme traditionnel était en train de s’effondrer.
- Troisièmement, les deux premiers points ont placé l’intérêt personnel immédiat du personnel des ONG en parfaite adéquation avec les impératifs du parti au pouvoir et de l’État sécuritaire américains. En effet, un concept issu des mondes de l’espionnage et de la guerre – la désinformation – a été introduit dans les espaces universitaires et à but non lucratif, où il s’est transformé en une pseudo-science utilisée comme instrument de guerre partisane.
Pratiquement du jour au lendemain, la mobilisation nationale de « l’ensemble de la société » pour lutter contre la désinformation initiée par Obama a conduit à la création et à l’accréditation d’une toute nouvelle catégorie d’experts et de régulateurs.
L’industrie moderne de la « vérification des faits », par exemple, qui se fait passer pour un domaine scientifique bien établi, est en réalité un cadre ouvertement partisan d’agents de conformité pour le Parti démocrate. Sa principale organisation, l’International Fact-Checking Network, a été créée en 2015 par l’Institut Poynter, une plaque tournante du complexe de la contre-désinformation.
Aujourd’hui, partout où l’on regarde, il y a un expert en désinformation. On les trouve dans tous les grands médias, dans toutes les branches du gouvernement, dans les départements universitaires, dans les émissions d’information par câble et, bien sûr, dans les ONG.
La mobilisation en faveur de la contre-désinformation génère suffisamment d’argent pour financer de nouvelles organisations et convaincre celles qui sont déjà établies, comme l’Anti-Defamation League, de répéter les nouveaux slogans et de participer à l’action.
Comment se fait-il que tant de personnes puissent soudainement devenir des experts dans un domaine – la « désinformation » – qu’aucune d’entre elles sur 10 000 n’aurait pu définir en 2014 ?
Parce que l’expertise en désinformation relève d’une orientation idéologique et non d’une connaissance technique. Pour s’en convaincre, il suffit de suivre l’itinéraire du prince Harry et de Meghan Markle, qui sont passés du statut d’animateurs de podcasts ratés à celui de membres de la Commission sur le désordre de l’information de l’Institut d’Aspen.
De telles initiatives ont fleuri dans les années qui ont suivi Trump et le Brexit.
Mais cela ne s’est pas limité aux célébrités.
Selon l’ ancien fonctionnaire du département d’État Mike Benz, « pour créer un consensus de l’ensemble de la société » sur la censure des opinions politiques en ligne qui « jetaient le doute » avant l’élection de 2020, le DHS a organisé des conférences sur la « désinformation » pour réunir des entreprises technologiques, des groupes de la société civile et des médias d’information afin qu’ils parviennent tous à un consensus – sous l’impulsion du DHS (ce qui est significatif : de nombreux partenaires reçoivent des fonds publics par le biais de subventions ou de contrats, ou craignent des menaces réglementaires ou de représailles de la part du gouvernement) – sur l’élargissement des politiques de censure des médias sociaux. »
Un mémo du DHS, rendu public pour la première fois par le journaliste Lee Fang, décrit le commentaire d’un fonctionnaire du DHS, lors d’une discussion stratégique interne, selon lequel l’agence devrait utiliser des organisations à but non lucratif tierces en tant que « centre d’échange d’informations pour éviter l’apparence de propagande gouvernementale ».
Il n’est pas inhabituel qu’une agence gouvernementale veuille travailler avec des entreprises privées et des groupes de la société civile, mais dans ce cas, le résultat a été de briser l’indépendance des organisations qui auraient dû examiner d’un œil critique les efforts du gouvernement.
Les institutions qui prétendent jouer le rôle de chien de garde du pouvoir gouvernemental se sont louées comme des véhicules de fabrication de consensus.
Ce n’est peut-être pas une coïncidence si les domaines qui ont le plus applaudi la guerre contre la désinformation et appelé à une plus grande censure – lutte contre le terrorisme, journalisme, épidémiologie – partagent un bilan public d’échecs spectaculaires au cours des dernières années.
Les nouveaux régulateurs de l’information n’ont pas réussi à convaincre les sceptiques des vaccins, ni les partisans de MAGA que l’élection de 2020 était légitime, ni à empêcher le public de s’interroger sur les origines de la pandémie de COVID-19, comme ils ont désespérément essayé de le faire.
Mais ils ont réussi à galvaniser un effort extrêmement lucratif de l’ensemble de la société, offrant des milliers de nouvelles carrières et un nouveau mandat du ciel aux institutionnalistes qui voyaient dans le populisme la fin de la civilisation.
IX. COVID-19
En 2020, la machine de contre-désinformation était devenue l’une des forces les plus puissantes de la société américaine.
C’est alors que la pandémie de COVID-19 a injecté du carburant dans son moteur.
Outre la lutte contre les menaces étrangères et la dissuasion des extrémistes nationaux, la censure de la « désinformation mortelle » est devenue une nécessité urgente.
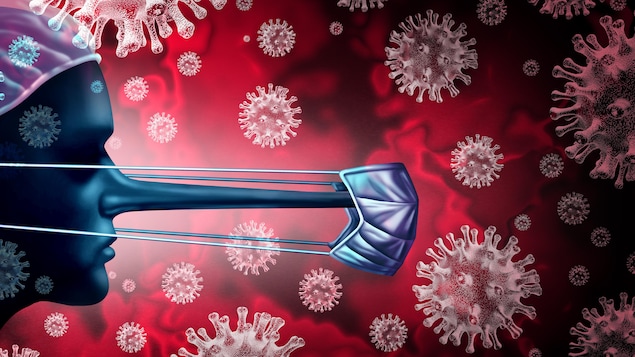
Pour ne prendre qu’un exemple, la censure de Google, qui s’appliquait aux sites de ses filiales comme YouTube, prévoyait de « supprimer les informations problématiques » et « tout ce qui irait à l’encontre des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé » – une catégorie qui, à différents moments du récit en constante évolution, aurait inclus le port de masques, l’interdiction de voyager, l’affirmation que le virus est hautement contagieux et l’idée qu’il pourrait provenir d’un laboratoire.
Le président Biden a publiquement accusé les entreprises de médias sociaux de « tuer des gens » en ne censurant pas suffisamment la désinformation liée aux vaccins.
Grâce à ses nouveaux pouvoirs et à ses canaux directs au sein des entreprises technologiques, la Maison-Blanche a commencé à envoyer des listes de personnes à bannir, comme le journaliste Alex Berenson.
Alex Berenson a été expulsé de Twitter après avoir tweeté que les vaccins à ARNm n’arrêtaient pas l’infection, ni la transmission. Il s’est avéré que cette affirmation était vraie.
Les autorités sanitaires de l’époque étaient mal informées ou mentaient sur la capacité des vaccins à empêcher la propagation du virus. En fait, malgré les affirmations des autorités sanitaires et des responsables politiques, les personnes en charge du vaccin le savaient depuis le début.
Dans le compte rendu d’une réunion tenue en décembre 2020, le Dr Patrick Moore, conseiller de la Food and Drug Administration, a déclaré:
« Pfizer n’a présenté aucune preuve dans ses données d’aujourd’hui que le vaccin a un effet quelconque sur le portage ou l’excrétion du virus, qui est la base fondamentale de l’immunité collective ».
Dystopique dans son principe, la réponse à la pandémie a également été totalitaire dans la pratique. Aux États-Unis, le DHS a produit en 2021 une vidéo encourageant « les enfants à dénoncer les membres de leur famille sur Facebook pour « désinformation » s’ils remettent en cause les récits du gouvernement américain sur le Covid-19″.
« En raison de la pandémie et de la désinformation concernant les élections, il y a un nombre croissant de ce que les experts en extrémisme appellent des « individus vulnérables » qui pourraient être radicalisés », a averti Elizabeth Neumann, ancienne secrétaire adjointe à la sécurité intérieure chargée de la lutte contre le terrorisme et de la réduction des menaces, à l’occasion du premier anniversaire des émeutes du Capitole.
Klaus Schwab, directeur du Forum économique mondial et capo di tutti capi de la classe des experts mondiaux, a vu dans la pandémie une occasion de mettre en œuvre une « grande remise à zéro » qui pourrait faire avancer la cause du contrôle de l’information à l’échelle planétaire :
« L’endiguement de la pandémie de coronavirus nécessitera un réseau de surveillance mondial capable d’identifier les nouveaux foyers dès qu’ils apparaissent ».
X. Les ordinateurs portables de Hunter : l’exception à la règle
Les ordinateurs portables sont réels. Le FBI le sait depuis 2019, date à laquelle il en a pris possession pour la première fois.
Lorsque le New York Post a tenté d’en faire état, des dizaines de hauts responsables de la sécurité nationale aux États-Unis ont menti au public, affirmant que les ordinateurs portables faisaient probablement partie d’un complot de « désinformation » russe.
Twitter, Facebook et Google, fonctionnant comme des branches entièrement intégrées de l’infrastructure de sécurité de l’État, ont exécuté les ordres de censure du gouvernement sur la base de ce mensonge. La presse a avalé le mensonge et a applaudi la censure.
L’histoire des ordinateurs portables a été décrite de bien des façons, mais la vérité la plus fondamentale est qu’il s’agit de l’aboutissement des efforts déployés pendant des années pour créer une bureaucratie réglementaire fantôme spécialement conçue pour empêcher que la victoire de Trump en 2016 ne se reproduise.
Il est peut-être impossible de savoir exactement quel effet l’interdiction de publier des informations sur les ordinateurs portables de Hunter Biden a eu sur le vote de 2020, mais il est clair que cette histoire a été considérée comme suffisamment menaçante pour justifier une attaque ouvertement autoritaire contre l’indépendance de la presse.
Les dommages causés au tissu social sous-jacent du pays, dans lequel la paranoïa et la conspiration ont été normalisées, sont incalculables.

Pas plus tard qu’en février, la représentante Alexandria Ocasio-Cortez a qualifié le scandale d’« histoire à moitié fausse de l’ordinateur portable » et d’« embarras », des mois après que même les Biden ont été contraints de reconnaître que l’histoire était authentique.
Si l’ordinateur portable est le cas le plus connu de l’intervention du parti au pouvoir dans la course Trump-Biden, son effronterie était une exception.
La grande majorité des ingérences dans l’élection étaient invisibles pour le public et ont eu lieu par le biais de mécanismes de censure mis en œuvre sous les auspices de l’« intégrité électorale ».
Le cadre juridique avait été mis en place peu après l’entrée en fonction de Trump, lorsque le chef sortant du DHS, Jeh Johnson, a adopté une règle de dernière minute – malgré les objections véhémentes des parties prenantes locales – déclarant que les systèmes électoraux étaient des infrastructures nationales critiques, les plaçant ainsi sous la supervision de l’agence.
De nombreux observateurs s’attendaient à ce que la loi soit abrogée par le successeur de Johnson, John Kelly, nommé par Trump, mais curieusement, elle a été laissée en place.
En 2018, le Congrès a créé une nouvelle agence au sein du DHS, l’Agence pour la Cybersécurité et la Sécurité des Infrastructures (CISA- Cybersecurity and Infrastructure Security Agency), chargée de défendre les infrastructures américaines – y compris les systèmes électoraux – contre les attaques étrangères.
En 2019, le DHS a ajouté une autre agence, la Direction générale de l’influence et de l’interférence étrangères(Foreign Influence and Interference Branch), chargée de lutter contre la désinformation étrangère.
Comme s’il s’agissait d’une volonté délibérée, les deux rôles ont fusionné. Le piratage russe et d’autres attaques malignes par des informations étrangères menaceraient les élections américaines.
Mais, bien entendu, aucun des responsables de ces services n’était en mesure de dire avec certitude si telle ou telle affirmation relevait de la désinformation étrangère, si elle était tout simplement erronée ou si elle était simplement gênante.
Nina Jankowicz, choisie pour diriger l’éphémère Conseil de gouvernance de la désinformation du DHS, a déploré ce problème dans son livre Comment perdre la guerre de l’information : la Russie, les fausses nouvelles et l’avenir des conflits .
« Ce qui rend cette guerre de l’information si difficile à gagner, écrit-elle, ce ne sont pas seulement les outils en ligne qui amplifient et ciblent ses messages ou l’adversaire qui les envoie ; c’est le fait que ces messages sont souvent délivrés à leur insu non pas par des trolls ou des robots, mais par des voix locales authentiques. »
La latitude inhérente au concept de désinformation a permis d’affirmer que la prévention du sabotage électoral nécessitait la censure des opinions politiques des Américains, de peur que ne soit partagée en public une idée qui avait été à l’origine implantée par des agents étrangers.
En janvier 2021, la CISA « a transféré son groupe de travail sur la lutte contre l’influence étrangère afin de promouvoir une plus grande flexibilité pour se concentrer sur la GDM générale [ndlr : un acronyme pour la désinformation, la désinformation et la malinformation]« , selon un rapport d’août 2022 du bureau de l’inspecteur général du DHS.
Après la disparition du prétexte de la lutte contre une menace étrangère, il ne restait plus que la mission principale consistant à imposer un monopole narratif sur la vérité.
Le nouveau groupe de travail axé sur le marché intérieur comptait 15 employés chargés de trouver « tous les types de désinformation » – mais plus particulièrement ceux liés aux « élections et aux infrastructures critiques » – et d’être « réactifs aux événements actuels », un euphémisme pour promouvoir la ligne officielle sur les questions qui divisent, comme ce fut le cas avec le « COVID-19-Boîte à outils sur la désinformation » publié pour « sensibiliser à la pandémie ».
Gardé secret pour le public, le changement a été « tracé sur les propres livestreams et documents internes du DHS », selon Mike Benz.
La justification collective des initiés du DHS, sans rien dire des implications révolutionnaires de l’échange, était que la « désinformation domestique » constituait désormais une plus grande « menace cybernétique pour les élections » que les faussetés découlant de l’ingérence étrangère.
C’est ainsi que, sans annonce publique ni hélicoptère noir volant en formation pour annoncer le changement, l’Amérique a eu son propre ministère de la vérité.
Ensemble, ils ont mis en place une machine de censure à l’échelle industrielle dans laquelle le gouvernement et les ONG envoyaient des tickets aux entreprises technologiques pour signaler les contenus répréhensibles qu’ils souhaitaient voir supprimés.
Cette structure a permis au DHS de sous-traiter son travail à l’Election Integrity Project (EIP– Projet d’intégrité électorale), un consortium de quatre groupes :
- L’Observatoire de l’Internet de Stanford, la société privée de lutte contre la désinformation Graphika (qui avait déjà été employée par le ministère de la Défense contre des groupes comme ISIS dans le cadre de la guerre contre le terrorisme)
- le Center for an Informed Public (Centre pour un public informé) de l’Université de Washington
- Et le Digital Forensics Research Lab (Laboratoire de recherche en criminalistique numérique) du Conseil de l’Atlantique.
Fondé en 2020 en partenariat avec le DHS, l’EIP a servi de « signaleur de désinformation domestique délégué par le gouvernement », selon le témoignage au Congrès du journaliste Michael Shellenberger, qui note que l’EIP affirme avoir classé plus de 20 millions d’« incidents de désinformation » uniques entre le 15 août et le 12 décembre 2020.
Comme l’a expliqué Alex Stamos, directeur de l’EIP, il s’agit d’une solution de contournement au problème du manque de financement et d’autorisations légales du gouvernement.
En examinant les chiffres de la censure que les propres partenaires du DHS ont rapportés pour le cycle électoral de 2020 dans leurs audits internes, La Fondation pour la liberté en ligne a résumé l’ampleur de la campagne de censure en sept points :
- 22 millions de tweets qualifiés de « désinformation » sur Twitter ;
- 859 millions de tweets collectés dans des bases de données pour l’analyse de la « désinformation » ;
- 120 analystes surveillant la « désinformation » dans les médias sociaux, par équipes de 20 heures;
- 15 plateformes technologiques surveillées pour détecter les « fausses informations », souvent en temps réel ;
- Le temps de réponse moyen entre les partenaires gouvernementaux et les plateformes technologiques est inférieur à 1 heure;
- Des dizaines de « récits de désinformation » ont été ciblés pour être étranglés à l’échelle de la plateforme ; et
- Des centaines de millions de posts Facebook, de vidéos YouTube, de TikToks et de tweets ont été touchés en raison de la modification des conditions d’utilisation du service de « désinformation », un effort que les partenaires du DHS ont ouvertement préparé et dont ils se sont vantés, et que les entreprises technologiques n’auraient jamais fait sans l’insistance des partenaires du DHS et « l’énorme pression réglementaire » exercée par le gouvernement.
XI. Le nouvel État à parti unique
En février 2021, un long article de la journaliste Molly Ball dans le magazine Time célébrait la « campagne de l’ombre qui a sauvé l’élection de 2020 ».
La victoire de Joe Biden, écrit-elle, est le résultat d’une « conspiration qui s’est déroulée en coulisses » et qui a rassemblé « une vaste campagne trans-partisane pour protéger l’élection » dans un « extraordinaire effort de l’ombre ».
Parmi les nombreuses réalisations des conspirateurs héroïques, Ball note qu’ils ont « réussi à faire pression sur les entreprises de médias sociaux pour qu’elles adoptent une ligne plus dure contre la désinformation et qu’elles utilisent des stratégies basées sur les données pour lutter contre les diffamations virales ».
Il s’agit d’un article incroyable, comme une entrée du registre des crimes qui se serait glissée d’une manière ou d’une autre dans les pages de la société, un hymne aux sauveurs de la démocratie qui décrit en détail la manière dont ils l’ont démembrée.
Il n’y a pas si longtemps, parler d’un « État profond » suffisait à désigner une personne comme un dangereux conspirationniste à surveiller et à censurer.
Mais le langage et les attitudes évoluent, et aujourd’hui, les partisans de l’État profond se sont réapproprié l’expression avec insolence.
Par exemple, un nouveau livre, American Resistance, de l’analyste néolibéral de la sécurité nationale David Rothkopf, est sous-titré L’histoire intérieure de la façon dont l’État profond a sauvé la nation.
L’État profond désigne le pouvoir exercé par des fonctionnaires non élus et leurs auxiliaires paragouvernementaux qui ont le pouvoir administratif d’outrepasser les procédures officielles et légales d’un gouvernement.
Mais une classe dirigeante décrit un groupe social dont les membres sont liés par quelque chose de plus profond que la position institutionnelle : leurs valeurs et instincts communs. Bien que le terme soit souvent utilisé de manière vague et parfois comme une étiquette péjorative plutôt que descriptive, la classe dirigeante américaine peut en fait être définie de manière simple et directe.
Deux critères définissent l’appartenance à la classe dirigeante.
Tout d’abord, comme l’ a écrit Michael Lind, elle est composée de personnes qui appartiennent à une « oligarchie nationale homogène, avec le même accent, les mêmes manières, les mêmes valeurs et le même niveau d’éducation, de Boston à Austin et de San Francisco à New York et Atlanta ».
L’Amérique a toujours eu des élites régionales ; ce qui est unique à l’heure actuelle, c’est la consolidation d’une classe dirigeante nationale unique.
Deuxièmement, être membre de la classe dirigeante, c’est croire que seuls les autres membres de cette classe peuvent être autorisés à diriger le pays.
En d’autres termes, les membres de la classe dirigeante refusent de se soumettre à l’autorité de toute personne extérieure au groupe, qu’ils disqualifient en la considérant comme illégitime d’une manière ou d’une autre.
Face à une menace extérieure sous la forme du trumpisme, la cohésion naturelle et la dynamique d’auto-organisation de la classe sociale ont été fortifiées par de nouvelles structures de coordination descendantes qui étaient l’objectif et le résultat de la mobilisation nationale d’Obama.
Dans la période précédant l’élection de 2020, selon le rapport de Lee Fang et Ken Klippenstein pour The Intercept, « les entreprises technologiques, y compris Twitter, Facebook, Reddit, Discord, Wikipédia, Microsoft, LinkedIn et Verizon Media, se sont réunies tous les mois avec le FBI, la CISA et d’autres représentants du gouvernement […] pour discuter de la manière dont les entreprises allaient gérer la désinformation pendant l’élection. »
L’historien Angelo Codevilla, qui a popularisé le concept de « classe dirigeante » américaine dans un essai publié en 2010 et qui en est ensuite devenu le principal chroniqueur, considère la nouvelle aristocratie nationale comme une émanation du pouvoir opaque acquis par les agences de sécurité américaines.
« La classe dirigeante bipartisane qui s’est développée pendant la guerre froide, qui s’est imaginée et qui a réussi à être considérée comme habilitée par expertise à mener les affaires de guerre et de paix de l’Amérique, a protégé son statut contre un public dont elle a continué à s’écarter en traduisant les affaires de guerre et de paix, qui relèvent du bon sens, dans un langage privé, pseudo-technique et impénétrable pour les non-initiés », écrit-il dans son livre de 2014, To Make and Keep Peace Among Ourselves and with All Nations (faire et maintenir la paix entre nous et avec toutes les nations).
Que croient les membres de la classe dirigeante ?
Ils croient, selon moi, « aux solutions informationnelles et managériales aux problèmes existentiels » et à leur « destin providentiel et à celui des gens comme eux de gouverner, indépendamment de leurs échecs ».
En tant que classe, leur principe suprême est qu’ils sont les seuls à pouvoir exercer le pouvoir. Si un autre groupe devait gouverner, tout progrès et tout espoir seraient perdus, et les forces obscures du fascisme et de la barbarie s’abattraient immédiatement sur la terre.
Si, techniquement, un parti d’opposition est toujours autorisé à exister aux États-Unis, la dernière fois qu’il a tenté de gouverner au niveau national, il a été soumis à un coup d’État qui a duré des années. En effet, toute contestation de l’autorité du parti au pouvoir, qui représente les intérêts de la classe dirigeante, est dépeinte comme une menace existentielle pour la civilisation.
Le célèbre athée Sam Harris a récemment présenté une articulation admirablement directe de ce point de vue.
Tout au long des années 2010, le rationalisme de haut niveau de Harris a fait de lui une star sur YouTube, où des milliers de vidéos le montraient en train de « posséder » et de « battre » des adversaires religieux dans des débats.
Puis Trump est arrivé. Harris, comme tant d’autres qui voyaient dans l’ancien président une menace pour tout ce qui était bon dans le monde, a abandonné son engagement de principe pour la vérité et est devenu un défenseur de la propagande.
Lors d’une apparition dans un podcast l’année dernière, Harris a reconnu la censure politiquement motivée des reportages liés aux ordinateurs portables de Hunter Biden et a admis « une conspiration de gauche pour refuser la présidence à Donald Trump ». Mais, faisant écho à Ball, il a déclaré qu’il s’agissait d’une bonne chose.
« Je me fiche de ce que contient l’ordinateur portable de Hunter Biden. […] Hunter Biden aurait pu avoir des cadavres d’enfants dans sa cave, et je m’en serais moqué », a déclaré M. Harris à ses interlocuteurs.
Il pouvait ignorer les enfants assassinés parce qu’un danger encore plus grand se cachait dans la possibilité d’une réélection de Trump, que M. Harris a comparée à « un astéroïde fonçant sur la Terre ».
Face à un astéroïde fonçant sur la Terre, même les rationalistes les plus respectueux des principes pourraient finir par privilégier la sécurité au détriment de la vérité. Mais un astéroïde tombe sur la Terre chaque semaine depuis des années.
Dans tous ces cas, la classe dirigeante justifie les libertés prises avec la loi pour sauver la planète, mais finit par violer la Constitution pour cacher la vérité et se protéger.
XII. La fin de la censure
Les aperçus du public sur les premières étapes de la transformation de l’Amérique de la démocratie au léviathan numérique sont le résultat de poursuites judiciaires et de FOIA (Freedom of Information Act-Loi sur la liberté de l’information)- des informations qui ont dû être arrachées à l’État sécuritaire – et d’un heureux hasard.
Si Elon Musk n’avait pas décidé d’acheter Twitter, de nombreux détails cruciaux de l’histoire de la politique américaine à l’ère Trump seraient restés secrets, peut-être pour toujours.
Mais le système reflété dans ces divulgations pourrait bien être en voie de disparition.
Il est déjà possible de voir comment le type de censure de masse pratiqué par l’EIP, qui nécessite un travail humain considérable et laisse derrière lui de nombreuses preuves, pourrait être remplacé par des programmes d’intelligence artificielle qui utilisent les informations sur les cibles accumulées dans les dossiers de surveillance comportementale pour gérer leurs perceptions.
L’objectif ultime serait de recalibrer les expériences en ligne des internautes en manipulant subtilement ce qu’ils voient dans leurs résultats de recherche et sur leur fil d’actualité.
L’objectif d’un tel scénario pourrait être d’empêcher la production de contenus susceptibles d’être censurés.
En fait, cela ressemble beaucoup à ce que Google fait déjà en Allemagne, où l’entreprise a récemment dévoilé une nouvelle campagne visant à étendre son initiative « prebunking » qui « vise à rendre les gens plus résistants aux effets corrosifs de la désinformation en ligne », selon l’Associated Press.
L’annonce a suivi de près l’apparition du fondateur de Microsoft, Bill Gates, dans un podcast allemand, au cours de laquelle il a appelé à utiliser l’intelligence artificielle pour lutter contre les « théories du complot » et la « polarisation politique ».

Meta dispose de son propre programme de prébunkerisation.
Dans une déclaration au site web Just The News, Mike Benz a qualifié le prebunking de « forme de censure narrative intégrée dans les algorithmes des médias sociaux pour empêcher les citoyens de former des systèmes de croyances sociales et politiques spécifiques » et l’a comparé au « pré-crime » présenté dans le film de science-fiction dystopique Minority Report.
Pendant ce temps, l’armée développe une technologie d’IA militarisée pour dominer l’espace d’information.
Selon USASpending.gov, un site officiel du gouvernement, les deux plus gros contrats liés à la désinformation proviennent du ministère de la Défense et visent à financer des technologies de détection automatique et de défense contre les attaques de désinformation à grande échelle.
- Le premier, d’un montant de 11,9 millions de dollars, a été attribué en juin 2020 à PAR Government Systems Corporation, un entrepreneur de la défense situé au nord de l’État de New York.
- Le second, émis en juillet 2020 pour un montant de 10,9 millions de dollars, a été attribué à une société appelée SRI International.
SRI International était à l’origine liée à l’université de Stanford avant de s’en séparer dans les années 1970, un détail pertinent si l’on considère que le Stanford Internet Observatory, une institution toujours directement liée à l’école, a dirigé l’EIP de 2020, qui pourrait bien avoir été l’événement de censure de masse le plus important de l’histoire du monde – une sorte de point d’orgue à l’histoire de la censure avant l’IA.
Il y a aussi les travaux en cours à la National Science Foundation, une agence gouvernementale qui finance la recherche dans les universités et les institutions privées.
La NSF (National Science Foundation- Fondation nationale de la science) a son propre programme, appelé Convergence Accelerator Track F, qui contribue à l’incubation d’une douzaine de technologies automatisées de détection de la désinformation, explicitement conçues pour surveiller des questions telles que « l’hésitation face aux vaccins et le scepticisme électoral ».
Selon M. Benz, « l’un des aspects les plus inquiétants » du programme « est sa similitude avec les outils de censure et de surveillance des réseaux sociaux de niveau militaire mis au point par le Pentagone pour les contextes de contre-insurrection et de lutte contre le terrorisme à l’étranger ».
En mars, Dorothy Aronson, responsable de l’information à la NSF, a annoncé que l’agence était en train de « construire un ensemble de cas d’utilisation » afin d’explorer comment elle pourrait utiliser ChatGPT, le modèle de langage d’IA capable de simuler raisonnablement la parole humaine, pour automatiser davantage la production et la diffusion de la propagande d’État.
Les premières grandes batailles de la guerre de l’information sont terminées.
Elles ont été menées par une classe de journalistes, de généraux à la retraite, d’espions, de patrons du parti démocrate, d’apparatchiks du parti et d’experts en contre-terrorisme contre le reste du peuple américain qui refusait de se soumettre à leur autorité.
Les futures batailles menées grâce aux technologies de l’IA seront plus difficiles à voir.
XIII. Après la démocratie
Moins de trois semaines avant l’élection présidentielle de 2020, le New York Times a publié un article important intitulé « Le premier amendement à l’ère de la désinformation ».
L’auteur de l’essai, Emily Bazelon, rédactrice au Times et diplômée de la faculté de droit de Yale, affirme que les États-Unis sont « au milieu d’une crise de l’information causée par la propagation de la désinformation virale », qu’elle compare aux effets « catastrophiques » sur la santé du nouveau coronavirus.
Elle cite un ouvrage du philosophe de Yale Jason Stanley et du linguiste David Beaver :
« La liberté d’expression menace la démocratie tout autant qu’elle permet son épanouissement ».
Le problème de la désinformation est donc aussi un problème de la démocratie elle-même, et plus précisément du fait qu’il y en a trop.
Pour sauver la démocratie libérale, les experts ont prescrit deux étapes cruciales : l’Amérique doit devenir moins libre et moins démocratique.
Cette évolution nécessaire impliquera de faire taire les voix de certains rabatteurs de la foule en ligne qui ont renoncé au privilège de s’exprimer librement. Il faudra suivre la sagesse des experts en désinformation et abandonner notre attachement à la Déclaration des droits.
Ce point de vue peut heurter ceux qui sont encore attachés à l’héritage américain de liberté et d’autonomie, mais il est devenu la politique officielle du parti au pouvoir et d’une grande partie de l’intelligentsia américaine.
L’ancien ministre du Travail de Clinton, Robert Reich, a réagi à l’annonce du rachat de Twitter par Elon Musk en déclarant que la préservation de la liberté d’expression en ligne était « le rêve de Musk. Et celui de Trump. Et celui de Poutine. Et le rêve de tous les dictateurs, hommes forts, démagogues et barons voleurs des temps modernes sur Terre. Pour le reste d’entre nous, ce serait un nouveau cauchemar. »
Selon Reich, la censure est « nécessaire pour protéger la démocratie américaine ».
Pour une classe dirigeante qui s’était déjà lassée de l’exigence démocratique de liberté accordée à ses sujets, la désinformation a fourni un cadre réglementaire pour remplacer la Constitution américaine.
En visant l’impossible, l’élimination de toute erreur et de tout écart par rapport à l’orthodoxie du parti, la classe dirigeante s’assure qu’elle sera toujours en mesure d’évoquer la menace imminente des extrémistes – une menace qui justifie sa propre mainmise sur le pouvoir.
Un chant de sirène appelle ceux d’entre nous qui vivent à l’aube de l’ère numérique à se soumettre à l’autorité des machines qui promettent d’optimiser nos vies et de nous rendre plus sûrs.
Face à la menace apocalyptique de l’« infodémie », on nous fait croire que seuls des algorithmes super-intelligents peuvent nous protéger contre l’ampleur écrasante et inhumaine de l’assaut de l’information numérique.
Les vieux arts humains de la conversation, du désaccord et de l’ironie, dont dépendent la démocratie et bien d’autres choses, sont soumis à une machinerie flétrissante de surveillance de qualité militaire – une surveillance à laquelle rien ne peut résister et qui vise à nous faire craindre pour notre capacité de raisonnement.
Si vous travaillez dans le domaine de la « désinformation » ou de la « mésinformation » pour le gouvernement ou dans le secteur privé et que vous souhaitez discuter de vos expériences, vous pouvez me contacter en toute sécurité à l’adresse [email protected] ou sur Twitter @jacob__siegel. La confidentialité des sources est garantie.
Source: Jacob Siegel via tabletmag.com
IMPORTANT - À lire
Vous voulez aller plus loin que cet article et comprendre tous les enjeux géopolitiques actuels ? Chaque mois, notre revue papier décortique l'actualité géopolitique et économique pour vous offrir des analyses approfondies.
Ne vous laissez plus manipuler par des élites déconnectées du réel. Abonnez-vous à notre revue dès maintenant et recevez chaque mois des informations exclusives, des décryptages précis et des révélations sur les véritables enjeux qui se cachent derrière les décisions de nos dirigeants.
Reprenez le contrôle de votre épargne et de votre avenir !