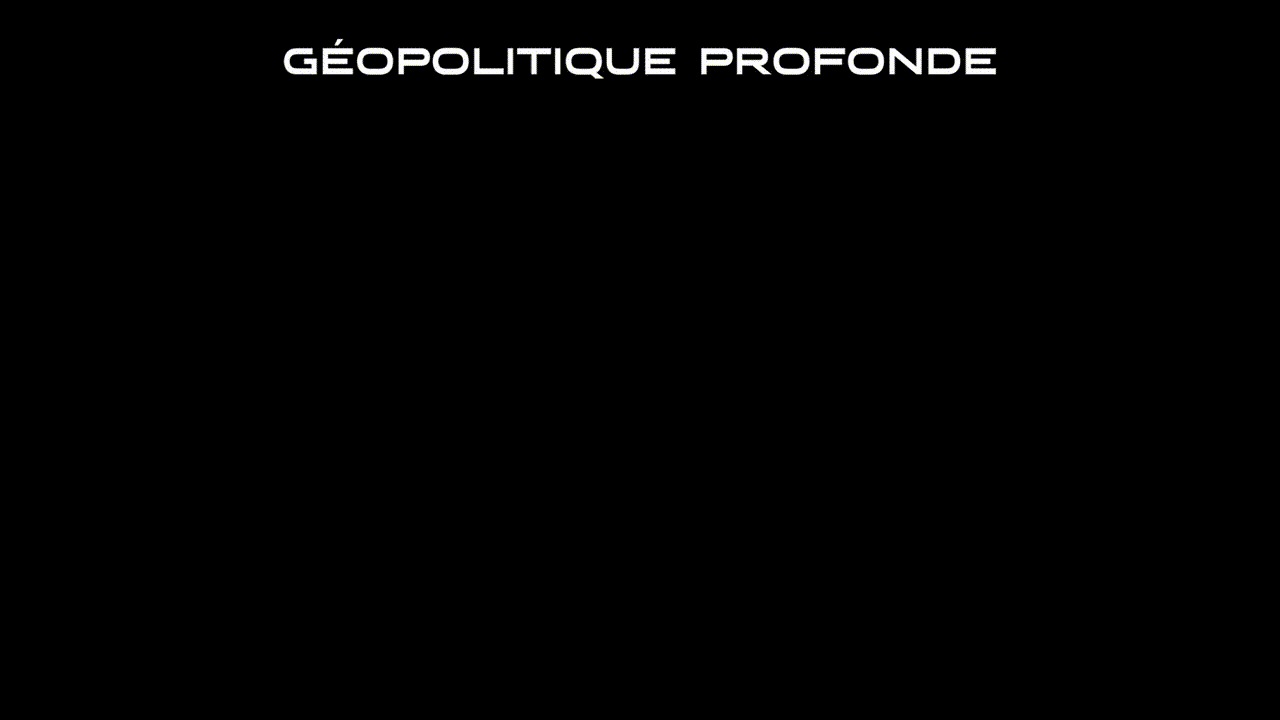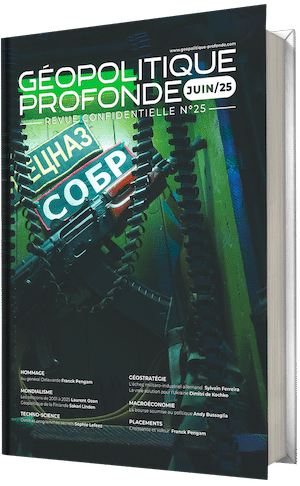Alors que la dernière crise financière de 2008 partait des Etats-Unis, le prochain krach pourrait bien se déclencher sur le Vieux continent. Ce dossier ne se focalise donc pas sur les signes de ralentissement de la Chine et des USA ou sur la guerre commerciale entre ces deux géants, mais bien sur l’Euroland, probable cœur d’une violente crise économique et financière à venir.
La zone euro souffle ses vingtièmes bougies avant la tempête
Pour que l’euro soit un succès, il faudrait deux éléments : que les politiques économiques des pays membres de la zone convergent dans les domaines sociaux et fiscaux et que la solidarité financière entre l’Allemagne (première bénéficiaire de l’euro) et les autres pays de la zone soit possible. Aucun point n’est rempli à ce jour.
Pour le vingtième anniversaire de l’euro de janvier 2019, le président de la Banque centrale européenne (BCE), Mario Draghi, a voulu tenter un dernier soubresaut avant son départ. Il a pour ambition de « finaliser le cadre de la zone euro » et « réduire les divergences entre les États de l’Est et de l’Ouest afin de protéger l’euro dans un monde “instable” ». Plus précisément, ses objectifs consistent à 1) renforcer l’union économique et monétaire (UEM) en finalisant l’union bancaire de la zone euro pour refinancer les banques en difficulté et 2) améliorer le mécanisme européen de stabilité (MES – le fonds anti-crise du continent) avec l’Eurogroupe (la réunion mensuelle des ministres des Finances des États membres de l’Euroland).
L’instabilité est dans l’air, mais les zéropéens prennent leur temps. Suite à la crise de 2008, il a été décidé que la finalisation de l’union bancaire doit être mise en place… d’ici 2024. Celle-ci réorganise la surveillance des grandes banques, la résolution de leurs difficultés et la garantie des dépôts. L’union des marchés des capitaux promus par le n°1 de la Commission européenne, Jean-Claude Drunker, réintroduit les deux meilleurs ingrédients de la crise de 2008 : la dette, qui serait élargie aux petites entreprises et à celles de taille intermédiaire, et la titrisation, pour encourager le crédit aux PME. Autrement dit de la dérégulation financière (Diplomatie n° 94, septembre-octobre 2018, p.75 et 77).
Cette union bancaire, officiellement mise en place pour lutter contre le risque financier, est un pas de plus vers une Europe fédérale sur le modèle des Länders allemands (grandes régions disposant de nombreux pouvoirs, en matière de police, d’éducation, de culture avec une constitution, une assemblée élue et un gouvernement). Ce projet retirerait aux États membres la maîtrise de leur système bancaire pour les transférer aux institutions supranationales européennes (Ruptures n°80, 28 novembre 2018, p.2). Le 14 décembre 2018, le sommet de Bruxelles a également abouti à la décision d’édifier un « instrument budgétaire de la zone euro » soit un budget pour faire émerger un gouvernement économique de la zone euro. Sur l’exemple des USA, ceci permettrait de se reposer sur le budget fédéral en cas de crise locale ; en effet, l’outil stabilisateur du taux de change (dévaluation/réévaluation de la monnaie) ne peut être utilisé entre les États membres vu qu’ils ont une monnaie commune à taux de change fixe dans la zone euro.
Au niveau politique, la remise en question de l’euro est à son apogée. Les gouvernements de gauche dite radicale qui sont au pouvoir au Portugal, en Espagne et en Grèce dénoncent l’austérité budgétaire, sans remettre en question l’UE dans son ensemble. Mais c’est surtout en Italie, où l’imprévisible alliance extrême gauche-extrême droite donne des sueurs froides aux cadres bruxellois. Sont à ajouter, les chocs possibles d’un Brexit, de crises bancaires dues aux bilans des banques européennes, d’une crise de la dette italienne, de la montée des tensions politiques entre pays européens au niveau des valeurs fondamentales et de la vision du monde. L’Europe pourrait être « l’épicentre de la prochaine crise » selon le financier Sebastien Laye. La production industrielle des nations de la zone euro s’étant effondrée au point le plus bas en dix ans (1,7 % en novembre 2018, sa plus forte baisse depuis près de 3 ans). Sa chute a atteint 3,3 % en 2018, alors que le consensus l’établissait à 2,3 % selon Eurostat. Contrairement au ralentissement de 2011-2012, ce ne sont pas des pays périphériques de l’Euroland qui sont aujourd’hui mis en cause, mais bien le cœur de l’économie européenne, soit l’industrie allemande et les problèmes intérieurs français (consommation, gilets jaunes, …). Même les partisans les plus zélés de la monnaie unique ne peuvent plus sérieusement défendre ce que l’on peut aujourd’hui appeler, preuves à l’appui, un beau fiasco. Bon anniversaire.

Les conséquences du Quantitative easing ou de « la planche à billets »
Le Quantitatif easing (QE) est une politique monétaire exceptionnelle (et polémique) d’assouplissement quantitatif, c’est-à-dire d’acquisition massive d’actifs financiers par une banque centrale. Le QE est utilisé en dernier recours quand le niveau d’inflation (2 % = stabilité monétaire) décroît et n’arrive plus à être tenu par la baisse du taux directeur (les taux d’intérêt) de la banque centrale. Une baisse des taux d’intérêt favorisant une hausse de l’inflation. Or, le taux de la BCE, extrêmement bas depuis plusieurs années pour soutenir les banques privées et l’économie européenne, est arrivé à 0,000 % depuis mars 2016. En conséquence, le seul moyen d’éviter la déflation, hantise des banques centrales, est de faire un QE ou de mettre en place des taux d’intérêt négatifs, c’est-à-dire que les banques centrales payent pour prêter de l’argent aux banques commerciales. Ces dernières remboursent donc moins qu’elles empruntent, comme cela se fait déjà au Japon, en Suisse ou en Suède.
En théorie, la politique monétaire de QE vise à augmenter la quantité de monnaie en circulation afin de relancer l’économie et maintenir l’inflation à un niveau correct. Le procédé permet, toujours en théorie, aux banques de faire plus facilement crédit pour relancer ainsi la production et l’emploi. Autrement dit, en Europe, la BCE a racheté les dettes publiques et privées d’États et de sociétés pour les refinancer jusqu’à plus de 80 Mds € par mois ! Ceci se fait par le rachat d’obligation qui est un titre de créance émis par une entreprise ou un gouvernement. Le porteur de l’obligation étant le créancier d’une dette et l’émetteur de l’obligation étant l’emprunteur. Cette technique d’assouplissement quantitatif (QE) est aussi appelée « planche à billets » pour souligner le caractère limite mafieux d’une création monétaire massive ex nihilo gratuite destinée aux marchés financiers. Le principal problème étant que la circulation de liquidités se fait finalement plus au sein du marché interbancaire (où les banques échangent des fonds entre elles) que dans l’économie productive.
Pour doper l’économie, le n° 1 de la BCE, Mario Draghi Malefoy, a donc lancé en mars 2015 le premier QE européen par le biais d’un programme d’acquisition d’obligations souveraines sur les marchés secondaires (PSPP). Suite aux inquiétudes allemandes concernant les conséquences de cette politique « nein » conventionnelle, la Cour de justice de l’UE leur a finalement répondu en décembre 2018 que le QE de la BCE était conforme au droit européen. Mais l’esprit de l’article 123 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne a bien été détourné : il interdit « l’acquisition directe, auprès [des Trésors publics], par la Banque centrale européenne ou les banques centrales nationales, des instruments de leur dette ». Cette acquisition directe des obligations d’État est dite primaire. Mais le PSPP permettait précisément d’acquérir les titres de façon indirecte sur les marchés financiers, c’est-à-dire en secondaire. Traduction : la BCE créée ex nihilo la monnaie et rachète aux investisseurs (banques, assurances, fonds de pension, hedge funds…) des titres obligataires souverains ou corporate (émis par des grandes entreprises) sur le marché secondaire. Ceci donne de l’argent frais à ces investisseurs qui rachètent eux-mêmes des titres sur le marché primaire afin de financer ainsi les États membres. Ce tour de passe-passe a finalement permis à la BCE de racheter la dette des États membres et de les financer à hauteur de plus de 2 000 Mds €.
Si ces mesures non conventionnelles ont pu sauver ou plutôt retarder la crise de l’union monétaire, cela s’est fait à prix coûtant. Il s’agissait principalement de garantir le dogme de l’euro en endettant massivement tous les États membres, car le QE creuse profondément les dettes publiques (c’est un emprunt). De plus, la BCE a vu la taille de son bilan s’accroître avec les acquisitions massives de titres de dettes des États membres de l’Euroland. Ce n’est pas la seule banque centrale dans ce cas (cf. USA, Angleterre, Japon), mais cette augmentation des bilans des banques centrales est un fait entièrement nouveau. En octobre 2018, le bilan de la BCE se montait à 4 632 Mds €, soit 41 % du PIB de la zone euro, autrement dit nous sommes en présence d’une importante bulle obligataire. À titre de comparaison, les États-Unis n’en sont qu’à 22 % de leur PIB, tandis que le Japon (pire exemple au monde) en est à 101 %. La BCE a également sauvé l’euro au détriment du pouvoir d’achat et de l’épargne. Les 2 600 Md€ de création monétaire en 4 ans (plus que le PIB de la France) sont le prix du sauvetage de la monnaie unique. Si le seul succès du QE de la BCE est politique (garder l’euro en vie), c’est un grand échec sur le plan économique.
Mais le plus grave est à venir vu que la récré est terminée : Draghi Malefoy a rendu public l’achèvement de la « morphine monétaire » (le QE) ce qui va entraîner une boucle de répercussions délétères. La fin de la planche à billets de la BCE a été analysée en juillet dernier par Natixis (filiale du Groupe BPCE et deuxième acteur bancaire en France) qui décrit quatre risques majeurs :
- « la chute de la profitabilité des entreprises de la zone euro, dont l’amélioration ne vient que de la baisse des taux d’intérêt », soit une baisse de 20 % des profits des entreprises selon le document ;
- « la réapparition d’un problème de solvabilité budgétaire dans la zone euro hors Allemagne ;
- une forte appréciation de l’euro, le déficit extérieur des États-Unis, qui pousse à la baisse le dollar, n’étant plus compensé par les taux d’intérêt très bas sur l’euro ;
- un transfert important de revenu des ménages emprunteurs vers les ménages prêteurs, qui ferait reculer la demande des ménages ».

Relever les taux d’intérêt : mission impossible
Draghi a reconnu le 24 janvier 2019 que les indicateurs économiques continuent d’être plus faibles que prévu… S’il a raison de stopper le QE, il le fait probablement trop tard, car il y a peu de chance de pouvoir normaliser la politique monétaire. Des taux d’intérêt normaux plus élevés (vers 3 %) seront effectivement très difficiles à mettre en place en raison du poids des intérêts sur la dette ; ils mettraient à mal la solvabilité budgétaire des États et laisseraient entrevoir un éclatement de l’euro. En effet, si le taux d’intérêt d’une dette publique est supérieur au taux de croissance du PIB (très faible en Europe), le poids de cette dette va s’accroître mécaniquement, car le volume des intérêts à verser augmente plus vite que la richesse supplémentaire produite. En France, par exemple, les seuls intérêts de la dette s’élèvent à 46,1 Mds € juste en 2016 ; un chiffre « faible » vu que les taux sont très bas !
Si la BCE décide de remonter ses taux, cela se paiera pour toute banque centrale de la zone euro déjà surchargée par sa dette gouvernementale. Cette mesure de hausse des taux pourrait donc être le déclencheur du krach obligataire redouté par tous, c’est-à-dire une chute brutale du prix des emprunts d’État sur le marché secondaire et une réticence des investisseurs à prêter aux États. Et si avant la hausse des taux, l’Eurosystème (qui regroupe la BCE et les banques centrales nationales des États membres de l’UE qu’ils aient l’euro ou non) essaye de vendre ses obligations, le même effet de crise obligataire peut se produire ! Autant dire que tout le monde est perdant ou presque vu que les grandes crises économiques enrichissent toujours certains malins. Les conséquences d’un krach obligataire sont d’ailleurs bien plus délétères qu’un krach boursier : des récessions d’Etat, des faillites d’entreprise, une forte hausse du chômage et un niveau de vie en baisse à la grecque sont à prévoir dans ce cas.
Dans toute politique monétaire de banque centrale, des taux d’intérêt bas doivent être relevés pendant que l’économie tourne un tant soit peu, pour pouvoir être abaissés en cas d’essoufflement. C’est un instrument important pour accompagner la conjoncture. Si la banque centrale n’a pas commencé à remonter ses taux d’intérêt avant la fin d’une période d’expansion lors d’un QE, la dette publique massive des États impose alors à cette première de ne plus remonter ses taux d’intérêt ou de risquer dans le cas contraire une crise de solvabilité budgétaire et des pertes importantes pour les détenteurs d’obligations (entreprises et États). C’est pour cette raison que Draghi a annoncé que les taux d’intérêt de la BCE resteraient stables « au moins jusqu’à l’été 2019 ». D’autres analystes cités par Le Temps soutiennent que le premier relèvement du taux d’intérêt de la banque européenne depuis 2011 ne devrait pas intervenir au moins avant fin 2019. On n’est vraiment pas sortis de l’auberge. Jean-Claude Drunker non plus.
Au 31 décembre 2018, la BCE s’est donc retirée du marché secondaire de la dette publique de la zone euro. Le problème est que les taux sur les emprunts souverains des pays du Sud de la zone euro n’ont tenu jusqu’à présent que grâce à la planche à billets qui « faussent » les taux de marché depuis 2015. Le QE pour l’instant terminé, le service de la dette en Europe va devenir un calvaire dans ce double contexte de ralentissement de la croissance et de normalisation graduelle de la politique de la BCE. Qui achètera la dette à la place de la BCE alors que les taux faussés pourraient remonter une fois que le marché se normalise sans planche à billets ? Pour rappel, la portion de la dette qui arrive à échéance chaque année n’est pas remboursée (c’est financièrement impossible) mais roulée, c’est-à-dire qu’un autre emprunt est contacté pour rembourser celui qui vient à échéance… Nous payons donc uniquement les intérêts, tandis que la dette s’accroit d’année en année avec les dépenses publiques. Génial comme système non ?
Le 27 septembre 2018, Natixis nomma un de ses Flash Économie « la BCE va craquer » qui postule que quand cette dernière voudra remonter ses taux, elle y renoncera finalement à cause de la faiblesse de l’inflation de la zone euro et de l’affaiblissement de sa croissance couplée à celle du commerce mondial. Une fuite en avant à la japonaise (pays en déflation depuis 1998-1999, en QE depuis 2001 et en taux d’intérêt négatif depuis janvier 2016) se mettra donc en place face à l’impossibilité de la BCE de remonter ses taux d’intérêt. Le QE sera peut-être même relancé, ainsi que la mise en place de taux d’intérêt négatifs constants.
L’Eurozone entre donc « en voie de japonisation » c’est-à-dire qu’elle est condamnée à maintenir des taux d’intérêt bas ou se résoudre à la faillite. La Banque du Japon est contrainte depuis des années de maintenir des taux d’intérêt nuls en raison de la taille de la dette publique du pays et de la détention d’obligations par les banques et les investisseurs institutionnels au Japon. Une remontée des taux d’intérêt à long terme amènerait des effets délétères sur la solvabilité de l’État et des intermédiaires financiers dans le pays. La BCE se retrouve aujourd’hui dans le même traquenard : après de nombreuses années de taux d’intérêt très bas, la remontée des taux d’intérêt à long terme risquerait d’amener à une crise de solvabilité budgétaire dans plusieurs pays (France, Italie, Espagne, Finlande, Belgique…) et des pertes très importantes sur les portefeuilles obligataires des banques et des investisseurs. Qui plus est, la zone euro est plus vulnérable à une crise de la dette, car ses politiques fiscales et monétaires ne sont pas coordonnées comme dans un État-nation tel que le Japon.
Natixis indique notamment que « la Zone euro devient une région à risque pour les investisseurs. […] Ceci implique aussi qu’il apparaît aujourd’hui une substituabilité entre la Zone euro et les pays émergents, qui sont maintenant deux régions à risque : quand le pessimisme augmente dans la Zone euro et que les capitaux sortent de la Zone euro, ils se dirigent vers les pays émergents et y redressent les taux de change. ». De plus, la banque française prévient que la dette publique d’un pays n’est pas forcément un actif sans risque dans l’Euroland : « un défaut sur la dette publique est en théorie possible apparaît peut-être dans certains pays de la Zone euro comme la France et l’Italie. »
Franck Pengam
IMPORTANT - À lire
Vous voulez aller plus loin que cet article et comprendre tous les enjeux géopolitiques actuels ? Chaque mois, notre revue papier décortique l'actualité géopolitique et économique pour vous offrir des analyses approfondies.
Ne vous laissez plus manipuler par des élites déconnectées du réel. Abonnez-vous à notre revue dès maintenant et recevez chaque mois des informations exclusives, des décryptages précis et des révélations sur les véritables enjeux qui se cachent derrière les décisions de nos dirigeants.
Reprenez le contrôle de votre épargne et de votre avenir !