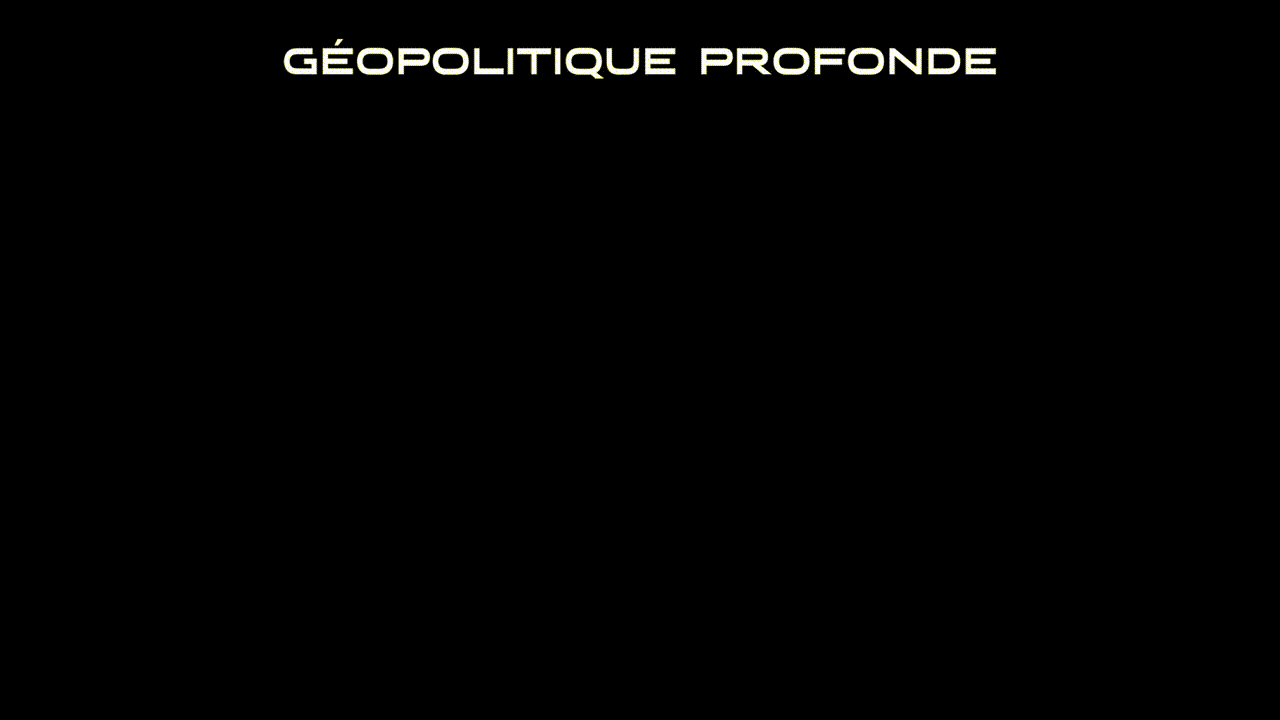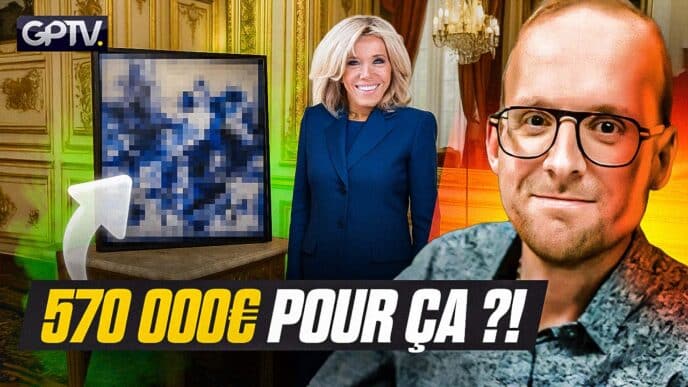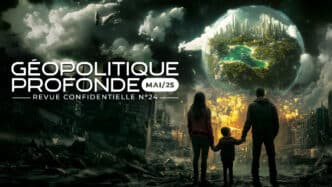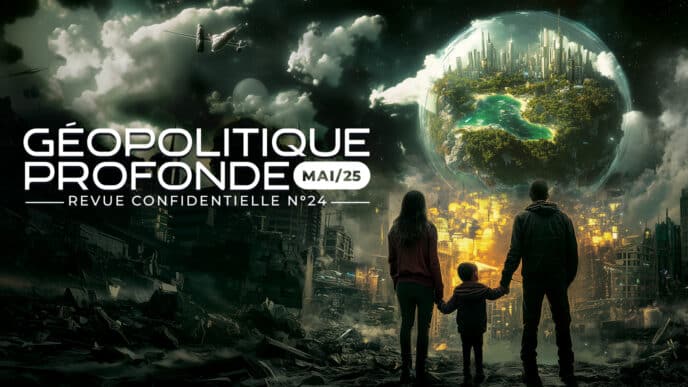🔥 Les essentiels de cette actualité
- Découvrez comment Trump défie le libre-échange et bouleverse l’ordre économique mondial. Ses stratégies suscitent débat et controverse.
- François Martin et Finn Andreen analysent la guerre commerciale. Leur expertise éclaire les enjeux géopolitiques et économiques.
- Le retour de l’État stratège face à la critique du libre-échange. Comprenez pourquoi le protectionnisme devient vital dans un monde instable.
Le 2 mai à 19h, François Martin et Finn Andreen sont les invités de La Grande Émission animée par Nicolas Stoquer en direct sur Géopolitique Profonde.
François Martin est un géopolitologue, journaliste et essayiste français, diplômé de l’ESSEC et de l’EMBA HEC, et auditeur de l’IHEDN et de l’INHESJ. Avec une carrière de 40 ans dans le commerce international de l’alimentaire, il a acquis une expérience considérable sur plus de 100 pays et maîtrise six langues et est connu pour ses analyses pénétrantes sur des sujets internationaux complexes.
Finn Andreen est un entrepreneur et auteur suédois basé en France, spécialisé dans les questions géopolitiques et économiques. Connu pour ses analyses percutantes sur les rapports de force mondiaux, il intervient régulièrement dans des publications et médias pour décrypter les enjeux globaux et les dynamiques internationales.
Libre-échange sacralisé ou totem économique intouchable
Les contempteurs de Donald Trump dans les grands médias jouent leur partition habituelle : indignation de principe, condamnation automatique. Pourtant, une autre critique, plus sophistiquée, plus insidieuse aussi, émerge des rangs des économistes eux-mêmes. Non pas ceux qui vomissent Trump par réflexe idéologique, mais ceux qui, jadis séduits par ses accents protectionnistes, se disent aujourd’hui trahis par sa remise en cause frontale du libre-échange.
Pour eux, toute atteinte à cette mécanique sacralisée sonne comme une hérésie. L’économie serait un ordre naturel autorégulé, où les barrières douanières n’ont plus leur place. Pourtant, cette foi aveugle ressemble moins à du pragmatisme qu’à un dogme hors-sol.
Derrière l’hostilité de ces « experts » se cache une adhésion inconditionnelle à un paradigme qui ne supporte aucune contestation. Le libre-échange n’est plus analysé, il est sanctuarisé. La mise en cause de ses effets délétères sur les classes moyennes, l’industrie ou la souveraineté devient alors suspecte. Cette posture disqualifie toute politique alternative, même lorsqu’elle vise à rééquilibrer des rapports de force écrasants.
Trump, en attaquant les fondements du commerce mondial tel qu’il a été façonné depuis les années 1990, ne fait pas seulement face à ses ennemis idéologiques : il heurte le clergé économique, convaincu que science rime avec abandon total de la puissance publique.
Le retour de l’État stratège face à la critique du libre-échange aujourd’hui
Ceux qui refusent d’enterrer l’interventionnisme d’État au nom d’une orthodoxie néolibérale anachronique s’inscrivent dans une tradition aussi cohérente que redoutablement efficace : celle de l’État stratège. Le gaullisme économique, loin d’être un reliquat nostalgique, incarne cette vision d’une puissance publique moteur de l’innovation, protectrice de ses industries, arbitre de l’équité nationale.
C’est cette ligne qu’a empruntée la France lors de ses plus grandes réussites industrielles, des programmes nucléaires aux télécommunications, en passant par les fleurons aéronautiques.
La dérégulation n’a jamais produit l’utopie du doux commerce vantée par Montesquieu. Elle a au contraire engendré une brutalité sans précédent : celle des monopoles, des chaînes de valeur asservissantes et de la dépendance technologique. Sans État pour réguler, pour orienter, pour protéger, la logique du marché dégénère en domination.
Les États-Unis eux-mêmes, que l’on caricature comme paradis libéral, n’ont jamais cessé d’injecter massivement dans leur appareil industriel : subventions, marchés publics, protectionnisme ciblé. Le libre-échange n’est qu’un masque quand il s’agit de défendre leurs intérêts stratégiques.
Réalisme économique contre foi aveugle au marché
La science économique ne parle pas d’une seule voix. Elle n’est pas cette vérité monolithique que les défenseurs du libre-échange universel voudraient faire croire. Elle produit des analyses, des constats, des modèles, mais elle ne dicte aucune religion.
Croire que l’ouverture totale des frontières commerciales constitue une panacée est une négation même de l’empire économique. Le rééquilibrage des échanges, la relocalisation de certaines productions, la protection de secteurs clés ne sont pas des caprices protectionnistes : ce sont des nécessités vitales dans un monde multipolaire et instable.
Trump, avec ses droits de douane ciblés, sa volonté de rapatrier l’industrie, ne fait que poser des jalons que d’autres appliquent avec plus de méthode : Inde, Chine, même Union européenne sur certains dossiers stratégiques. Il incarne une rupture, brutale mais nécessaire, face à un ordre économique devenu toxique pour les nations.
Refuser cette réalité au nom d’un prétendu réalisme, c’est confondre science et croyance. L’économie ne se résume pas à des équations abstraites ; elle est un champ de bataille où les règles doivent servir la souveraineté, la justice sociale et la cohésion nationale.
IMPORTANT - À lire
Vous voulez approfondir votre compréhension des enjeux géopolitiques et économiques mondiaux ? Découvrez notre revue mensuelle, qui décrypte les rapports de force internationaux et les stratégies des grandes puissances, comme la guerre commerciale initiée par Trump.
Chaque mois, plongez au cœur de l'actualité mondiale avec des analyses pointues rédigées par des experts reconnus. Notre revue papier vous offre un éclairage unique pour saisir les dynamiques complexes qui façonnent notre monde. Abonnez-vous dès maintenant !