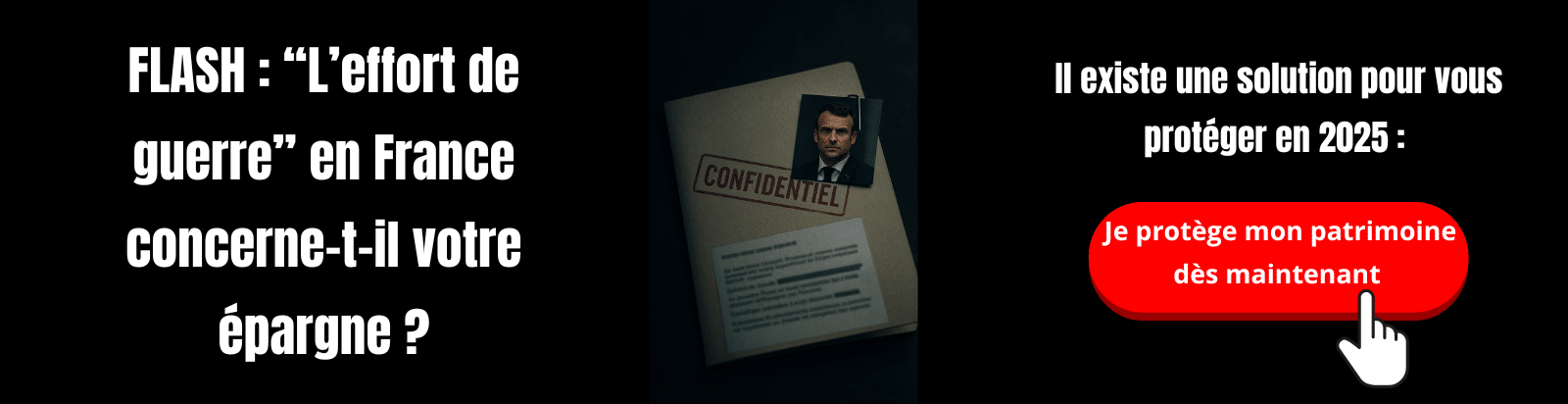🔥 Les essentiels de cette actualité
- Thierry Marignac dévoile une Russie complexe et nuancée dans son enquête immersive, loin des clichés occidentaux.
- La diabolisation systématique de la Russie par l’Occident est dénoncée comme une stratégie de propagande.
- En Russie, la guerre est perçue comme existentielle et défensive, influencée par un sentiment d’encerclement.
- Les récits imposés par l’Occident marginalisent les vérités alternatives, verrouillant le débat sur le conflit.
Le 2 juin à 19h, Thierry Marignac, Sylvain Baron et Patrick Pasin sont les invités de Mike Borowski, en direct sur Géopolitique Profonde !
Thierry Marignac est un écrivain, traducteur et journaliste de terrain. Sa très récente enquête, « Vu de Russie : Chroniques de guerre du camp ennemi », témoigne de sa posture immersive, nourrie de plusieurs mois passés en Russie fin 2024. Il y donne la parole à soldats, civils, nationalistes, opposants clandestins et simples indifférents, pour dresser un portrait vivant, nuancé et sans concession du pays face à la guerre en Ukraine.
Sylvain Baron, journaliste engagé, revient tout juste de son périple en Ukraine, où il a plongé au cœur des zones de conflit à Zaporija et Marioupol.
Patrick Pasin est un auteur, conférencier et entrepreneur français, connu pour ses critiques sur la géopolitique, la santé publique et la souveraineté individuelle.
La diabolisation systématique de la Russie
L’Occident ne se contente plus de critiquer la politique russe : il l’écrase sous une machine de propagande bien huilée. Depuis plus d’une décennie, les médias dominants n’ont cessé d’imposer une vision binaire du monde, où la Russie incarne le mal absolu. Vladimir Poutine est désormais la figure totem d’un récit où l’ennemi ne se combat pas seulement militairement, mais moralement. Chaque discours, chaque image, chaque manchette tend à réduire la complexité géopolitique à un affrontement de civilisations. L’accusation constante de “désinformation russe” sert d’écran pour justifier une censure massive et pour museler toute voix dissidente dans les pays occidentaux.
La comparaison obsessionnelle de Poutine à Hitler est le point culminant de cette stratégie. Ce parallèle historique, simpliste et manipulateur, permet de placer tout désaccord géopolitique au rang de combat contre un néonazisme imaginaire. En mobilisant l’émotion brute de la Seconde Guerre mondiale, la communication occidentale dépolitise le conflit, évitant d’aborder les responsabilités de l’OTAN, l’élargissement vers l’Est ou les intérêts énergétiques en jeu. Assimiler le Kremlin au Troisième Reich n’est pas un acte journalistique ; c’est un outil de guerre psychologique destiné à annihiler toute analyse rationnelle.
Une guerre vue de l’intérieur
En Russie, la guerre n’est ni perçue comme une conquête, ni comme une fuite en avant impérialiste. Elle est présentée comme une guerre existentielle, défensive, contre un Occident qui n’a cessé de briser ses promesses. Ce discours, massivement relayé par les médias russes, s’ancre dans une mémoire collective marquée par les trahisons de l’ère post-soviétique. Les sanctions économiques, les campagnes de diffamation et l’isolement diplomatique ne font que renforcer ce sentiment d’encerclement. Pour beaucoup de citoyens, il ne s’agit pas d’approuver la guerre, mais de refuser l’humiliation permanente imposée par les puissances occidentales.
Le soutien relatif à l’effort militaire repose aussi sur une réalité que les observateurs étrangers minimisent : la population russe ne vit pas dans une dictature militarisée, mais dans un État où le patriotisme a remplacé l’idéologie. Les récits de l’État s’appuient sur une réinterprétation de l’Histoire nationale, où les moments de résistance deviennent les repères identitaires. Ce mécanisme de mobilisation mentale est renforcé par l’expérience de l’effondrement des années 1990, vécu comme un traumatisme collectif dont Poutine aurait été le seul à sortir le pays.
Narratifs imposés et vérités marginalisées
La guerre cognitive engagée par l’Occident repose sur une stratégie bien rodée : saturer l’espace public d’un seul récit, verrouiller le débat, discréditer toute voix alternative. Les ONG anglo-saxonnes jouent un rôle central dans cette opération. Derrière leurs façades humanitaires, elles servent souvent de relais à des agendas politiques précis, notamment celui de Washington et de ses alliés. En imposant des cadres moraux sur les conflits, elles filtrent l’information, sélectionnent les victimes dignes d’intérêt, construisent des figures de héros ou de bourreaux selon la ligne idéologique dominante.
Cette instrumentalisation du discours humanitaire est l’un des piliers de la guerre narrative contre la Russie. Les témoignages opposés, les données gênantes, les analyses dissidentes sont relégués aux marges, quand ils ne sont pas simplement qualifiés de “pro-Kremlin”. Ce climat de suspicion, couplé à la pression sociale, empêche tout débat honnête sur les causes profondes du conflit. L’objectif n’est plus d’informer mais de conformer. Dans ce paysage médiatique verrouillé, faire émerger une vérité nuancée devient un acte de dissidence.
Ce contrôle des récits s’appuie sur une rhétorique émotionnelle permanente. Le discours dominant ne cherche pas à convaincre, mais à mobiliser affectivement, à créer un choc moral. Ainsi se construit une réalité parallèle où la Russie, essentialisée, devient l’ennemi absolu. Loin de pacifier le monde, cette stratégie aggrave les fractures et justifie une escalade sans fin. Elle prive les sociétés occidentales de toute capacité critique face à leurs propres responsabilités, au prix d’une guerre sans fin contre une image façonnée de toutes pièces.
IMPORTANT - À lire
Plongez au cœur des zones de conflit et découvrez les vérités marginalisées grâce à notre revue papier. Chaque mois, nos analyses approfondies vous offrent un regard nuancé sur la géopolitique mondiale, loin des narratifs imposés par les médias dominants.
Dépassez la diabolisation systématique de la Russie et explorez les causes profondes des conflits. Notre revue vous invite à une réflexion critique sur les responsabilités de l'Occident et les enjeux énergétiques en jeu, pour une compréhension globale des défis de notre temps.