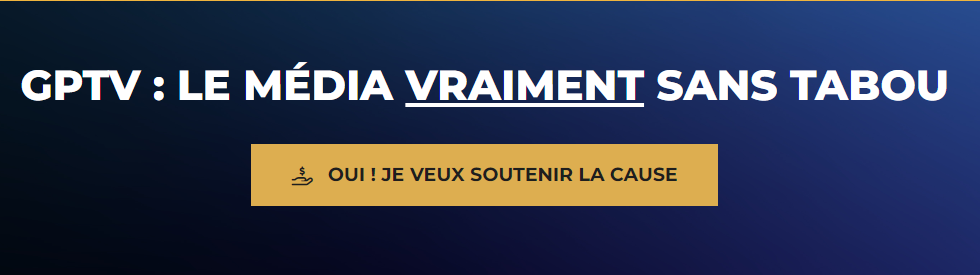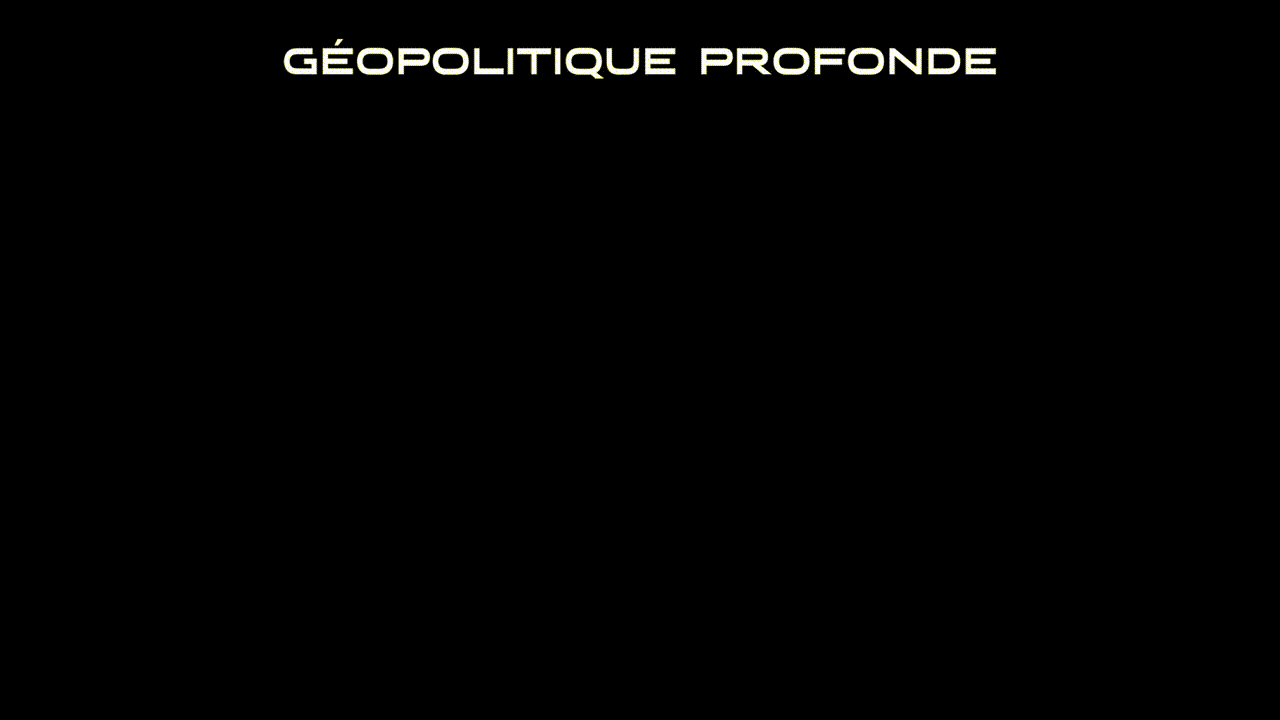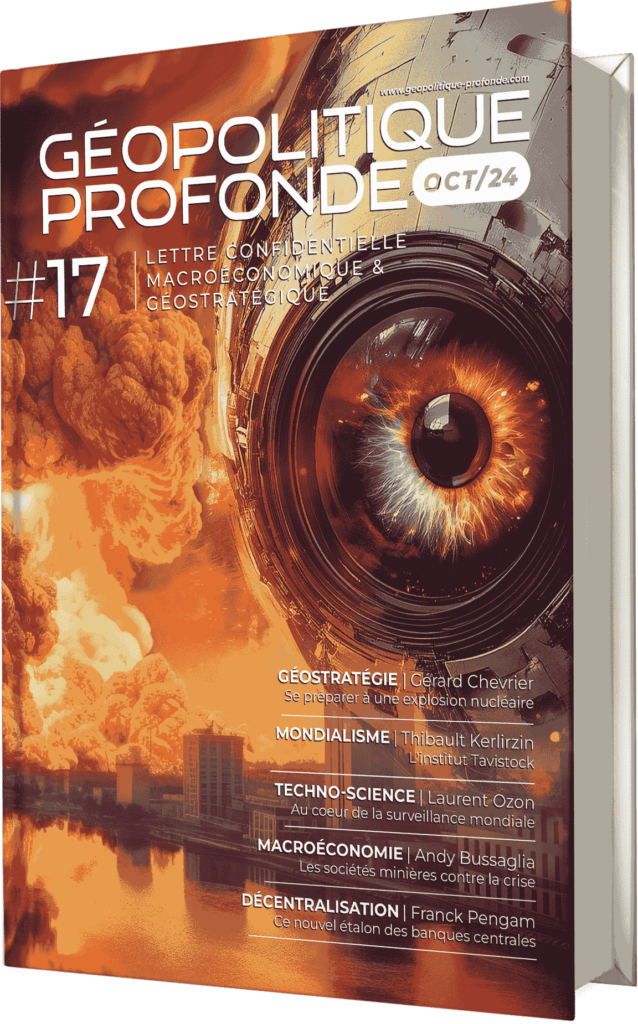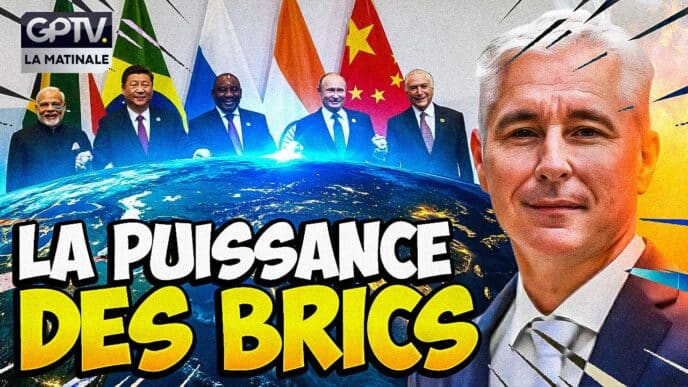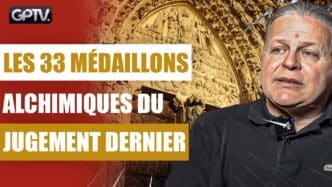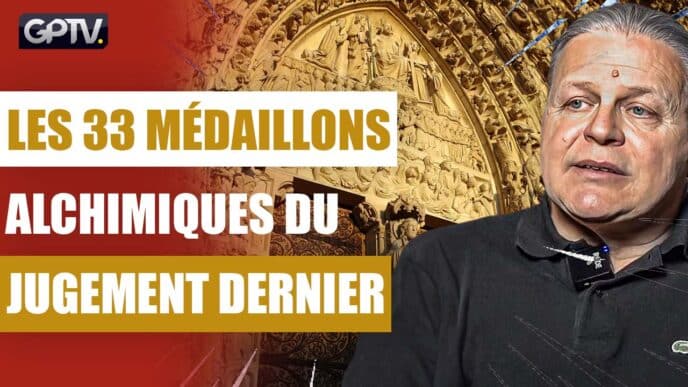Le 27 octobre à 9h, Alain Le Bihan est l’invité de Nicolas Stoquer, sur la chaîne YouTube de Géopolitique Profonde !
Alain Le Bihan est un auteur et économiste français, diplômé en sciences économiques. Il a une expérience variée dans le secteur privé et les institutions, ayant travaillé principalement dans de petites entreprises et acquis une expérience internationale en Europe et en Asie du Sud-Est. Il a récemment publié « ÉNERGIE : UN CRIME D’ÉTAT: « Pourquoi votre facture d’électricité explose » ».
États-Unis et hégémonie mondiale : la fin d’un règne absolu
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont façonné le monde moderne en tant que superpuissance dominante. Cette position hégémonique, appuyée par des alliances militaires et économiques, vise à garantir leurs intérêts tout en imposant leur vision de l’ordre mondial. Chaque président américain, en suivant sa propre doctrine, a su renforcer cette suprématie par des interventions directes, des coups d’État orchestrés, ou par une diplomatie ciblée. Cependant, cette domination sans partage montre aujourd’hui des signes de faiblesse, et l’autorité américaine est de plus en plus contestée sur plusieurs fronts, notamment par des rivaux comme la Chine et la Russie.
Mais qu’est-ce qui motive réellement cette soif de leadership global ? Derrière les idéaux de démocratie et de liberté souvent brandis par Washington, des intérêts économiques et stratégiques se dessinent, révélant une politique d’influence très calculée. En Afrique, au Moyen-Orient, ou encore en Amérique latine, cette quête de domination passe par un jeu subtil d’alliances, de pressions économiques et parfois de conflits. Pourtant, alors que le monde devient de plus en plus multipolaire, cette emprise semble de plus en plus remise en cause, annonçant peut-être un tournant majeur dans l’histoire des relations internationales.
Derrière le masque altruiste des États-Unis
Les États-Unis se présentent souvent comme le gendarme du monde, mais leur engagement sur la scène internationale n’a pas toujours été dicté par des motifs purement altruistes. Derrière les discours officiels se cachent des objectifs de contrôle des ressources, de protection des multinationales américaines et de maintien de leur influence sur les marchés mondiaux. Chaque président, qu’il soit républicain ou démocrate, a ainsi dû jongler entre des impératifs moraux et des impératifs stratégiques, souvent en se heurtant à des dilemmes éthiques et géopolitiques complexes.
La politique étrangère des États-Unis s’est construite autour de deux grands axes : l’interventionnisme et la coopération stratégique. D’un côté, des interventions militaires directes, comme celles en Irak ou en Afghanistan, ont servi des objectifs de sécurité nationale mais ont souvent semé le chaos dans les régions concernées. D’un autre côté, des alliances comme celles avec l’OTAN permettent de stabiliser certaines zones stratégiques et de projeter la puissance américaine sans avoir à déployer de troupes. Ces choix, bien que controversés, visent avant tout à renforcer l’influence américaine et à asseoir leur rôle de leader mondial. Toutefois, la résistance croissante de pays comme l’Iran ou la Russie montre bien que cette domination est loin d’être inébranlable.
Trump et l’Amérique d’abord
L’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche a marqué un tournant inédit dans l’histoire de la diplomatie américaine. Loin des discours de consensus, Trump a mis en avant une vision nationaliste, affirmant haut et fort son intention de se désengager des affaires du monde pour se concentrer sur les intérêts domestiques des États-Unis. Avec sa doctrine « America First », il a rompu avec la tradition d’une diplomatie multilatérale, s’attaquant frontalement à des institutions pourtant essentielles comme l’OTAN, et défiant des puissances économiques telles que la Chine et l’Union Européenne.
Cette approche a suscité de vives réactions, tant au niveau national qu’international. D’un côté, elle a permis aux États-Unis de reprendre une certaine indépendance, mais elle a aussi laissé un vide diplomatique que des puissances rivales se sont empressées de combler. La politique étrangère de Trump a redéfini les règles du jeu, mais elle a également révélé une Amérique de plus en plus divisée quant à son rôle sur la scène internationale. Alors que la place des États-Unis comme leader mondial vacille, cette stratégie isolationniste soulève des questions essentielles sur l’avenir de l’ordre mondial et sur les nouvelles alliances qui pourraient émerger dans les années à venir.
IMPORTANT - À lire
Vous voulez aller plus loin que cet article et comprendre tous les enjeux géopolitiques actuels ? Chaque mois, notre revue papier décortique l'actualité géopolitique et économique pour vous offrir des analyses approfondies.
Ne vous laissez plus manipuler par des élites déconnectées du réel. Abonnez-vous à notre revue dès maintenant et recevez chaque mois des informations exclusives, des décryptages précis et des révélations sur les véritables enjeux qui se cachent derrière les décisions de nos dirigeants.
Reprenez le contrôle de votre épargne et de votre avenir !