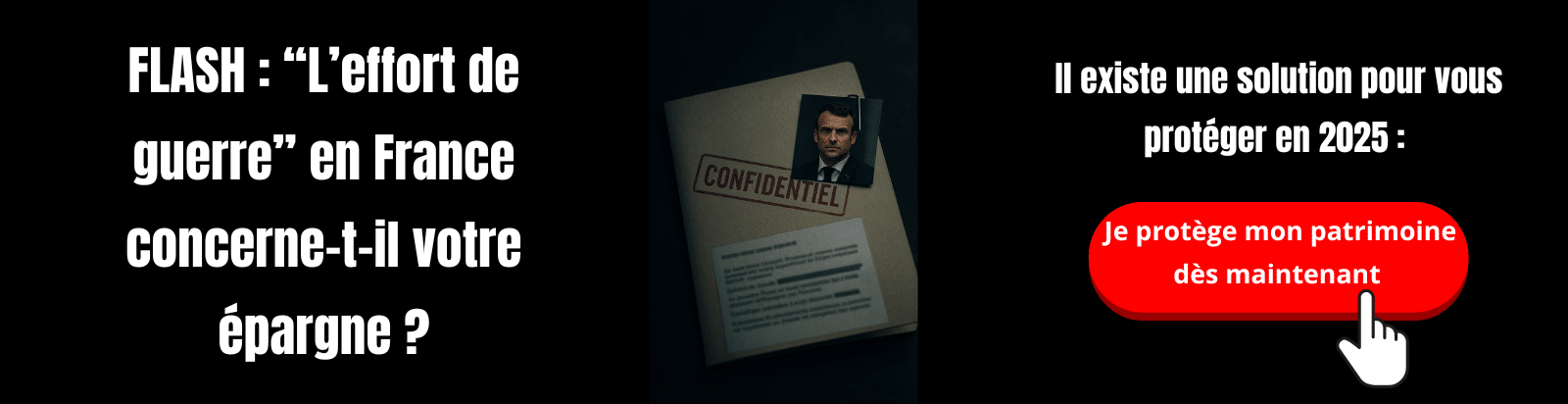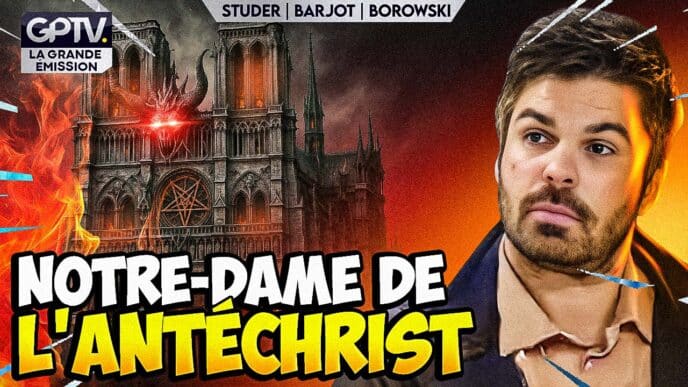🔥 Les essentiels de cette actualité
- Découvrez l’analyse de Sophie Lefeez sur la domination financière et militaire, le 11 mai à 19h sur YouTube avec Raphaël Besliu.
- Explorez comment la foi en la supériorité technique peut mener à des échecs militaires, illustrés par les guerres du Vietnam et d’Afghanistan.
- Comprenez les coûts et les illusions de l’investissement massif dans la technologie militaire et ses impacts sur la logistique et l’autonomie.
- Apprenez pourquoi l’interopérabilité avec les alliés peut compromettre l’autonomie stratégique de la France et favoriser une dépendance technologique.
- Découvrez une nouvelle approche de la puissance militaire, basée sur l’humain et l’intelligence stratégique, pour s’adapter aux guerres modernes.
Le 11 mai à 19h, Sophie Lefeez est l’invitée de Raphaël Besliu, sur la chaîne YouTube de Géopolitique Profonde !
Sophie Lefeez est une chercheuse française en sociologie des techniques, spécialisée dans les questions de défense et d’armement. Docteure de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, elle a travaillé plus de dix ans dans le secteur de la défense, notamment chez Airbus et à la Fondation pour la recherche stratégique. Aujourd’hui chercheuse associée à l’IRIS, elle est l’auteure de L’illusion technologique dans la pensée militaire (2017), où elle analyse la fascination des armées pour la technologie et ses conséquences stratégiques.
Une foi technicienne déconnectée du réel
La course occidentale à l’innovation militaire se fonde sur une croyance tenace : la supériorité technique garantirait la victoire. Cette foi, martelée dans les discours officiels, repose sur une représentation historique biaisée et des dogmes stratégiques hérités du XXe siècle. Pourtant, les faits historiques démontrent que la supériorité technique ne permet pas de gagner une guerre, seulement une bataille. Des conflits majeurs comme le Vietnam, l’Afghanistan ou même l’Irak montrent qu’une armée technologiquement supérieure peut s’enliser, perdre politiquement ou échouer à imposer ses objectifs. L’investissement massif dans le high-tech repose souvent sur une illusion d’efficacité, alimentée par une méconnaissance volontaire des dynamiques asymétriques, où l’adversaire choisit délibérément un autre terrain que celui de la technologie.
Cette vision technicienne fait l’impasse sur les coûts vertigineux induits. Le suréquipement des soldats, l’élévation constante des performances attendues et la complexité croissante des systèmes alourdissent la logistique, fragilisent les chaînes d’approvisionnement et creusent les déficits. Le matériel dernier cri, censé offrir la précision et la sécurité, finit par restreindre l’autonomie des forces et par les enfermer dans une logique de guerre ultra-prévisible. Dans une guerre asymétrique, cette rigidité devient un handicap. L’illusion du « qui peut le plus peut le moins » ne tient pas : le matériel high-tech, conçu pour des cibles sophistiquées, échoue souvent à neutraliser des menaces rustiques. Résultat : un investissement colossal dans une technologie incapable d’apporter la victoire dans les conflits actuels.
Le mirage de l’interopérabilité et de la moralisation guerrière
L’interopérabilité avec les alliés, et notamment les États-Unis, alimente la fuite en avant technologique. Il ne s’agit plus d’optimiser les moyens selon les besoins propres de la France, mais de se conformer aux standards d’une coalition à haute valeur technologique, sous peine d’être relégué à la marge. Ce suivisme stratégique impose un renouvellement constant des équipements, qui ne sert pas toujours les intérêts nationaux mais répond à des impératifs politiques d’intégration. Derrière l’argument de la compatibilité opérationnelle se cache une perte d’autonomie stratégique et une dépendance accrue à l’industrie américaine. Le mimétisme technologique devient une fin en soi, alimentant une spirale inflationniste délétère pour les finances publiques et sans effet garanti sur le terrain.
Mais cette obsession du high-tech ne s’explique pas seulement par des considérations militaires. Elle répond à des attentes sociétales : éviter les morts dans son propre camp, réduire les dommages collatéraux, rassurer l’opinion publique. Loin de la brutalité assumée des conflits passés, la guerre moderne se veut propre, chirurgicale, légale. Cela implique une précision extrême, un traitement massif de données, des capteurs omniprésents, des frappes pilotées à distance. Une sophistication qui coûte très cher et déshumanise le combat. Les drones, les missiles à guidage laser ou les mini-nukes ne sont pas tant là pour vaincre l’ennemi que pour prouver que l’on peut faire la guerre sans salir ses mains. Une illusion de pureté guerrière qui, loin de dissuader l’adversaire, renforce l’effet boomerang stratégique : les Talibans ou le Hezbollah savent que l’image publique occidentale est son talon d’Achille.
Vers une puissance fondée sur l’humain et l’intelligence stratégique
Cette logique de guerre à haute technicité finit par étouffer la puissance d’adaptation. L’histoire montre que les victoires durables ne se jouent pas sur l’équipement mais sur la capacité des soldats à interpréter, improviser, détourner. L’armée occidentale, sur-normée, hyper-planifiée, perd cette souplesse décisive. La judiciarisation du combat, la quête du zéro mort et la dépendance aux ordres écrits réduisent l’autonomie du terrain et renforcent une guerre de procédures. Ce carcan doctrinal affaiblit les forces vives, bride l’innovation tactique et rend les armées vulnérables face à des adversaires moins technologiques mais bien plus imprévisibles. L’adversaire s’infiltre dans les angles morts de nos systèmes, là où la haute performance devient un handicap.
Il est temps de renverser le paradigme. Une armée forte est une armée rustique, mobile, autonome, qui sait bricoler à partir de peu. Une armée fondée sur l’intelligence de situation, la ruse, la capacité à exploiter les failles de l’ennemi. L’aïkido, art martial de la non-consommation de soi, offre un modèle alternatif : efficacité sans force brute, adaptation sans surenchère, équilibre au lieu de domination. L’armement devrait permettre cela : être assez simple pour être compris, détourné, transformé. La France doit sortir du mythe de l’innovation perpétuelle comme horizon unique de puissance. Réarmer ses soldats moralement, quantitativement, et stratégiquement, c’est rétablir la primauté de l’humain sur la machine. Une autre forme de puissance, moins coûteuse, moins vulnérable, infiniment plus adaptée aux guerres du présent et de demain.
IMPORTANT - À lire
Pour aller plus loin dans l'analyse des illusions technologiques et des dérives stratégiques qui affaiblissent nos armées, plongez chaque mois dans les dossiers de notre revue papier. Nos experts décryptent les enjeux géopolitiques et militaires de notre époque, loin des discours officiels.
Commandez dès maintenant votre abonnement pour recevoir des analyses approfondies sur les rapports de force mondiaux, les stratégies d'influence et les mécanismes de domination qui façonnent notre avenir. Une lecture indispensable pour comprendre le monde avec lucidité.