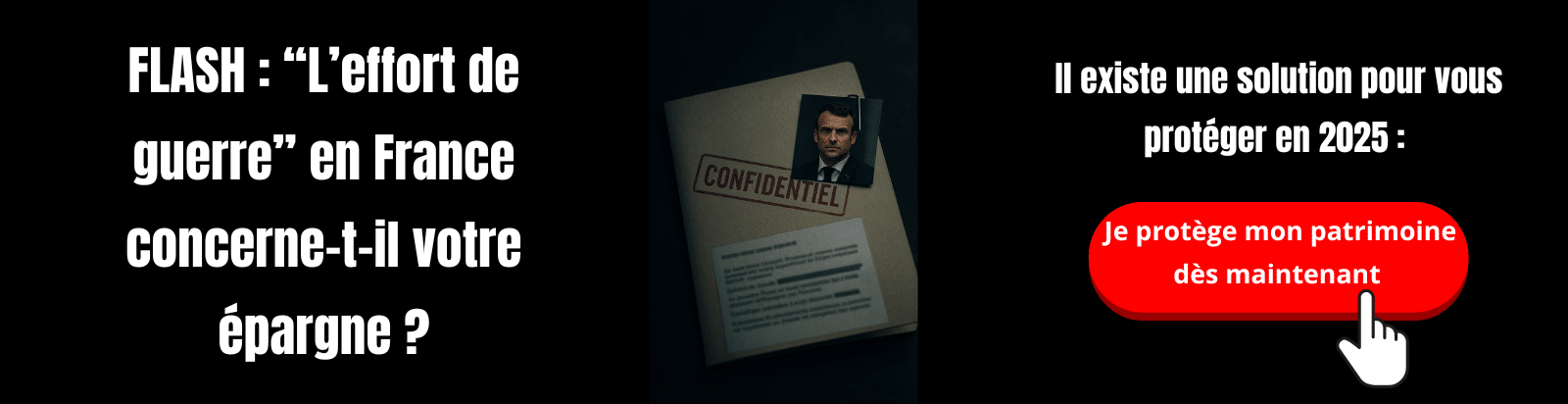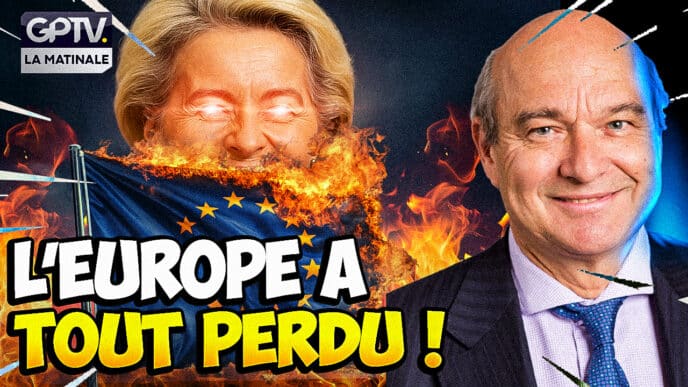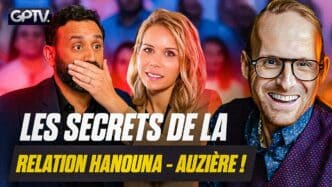Le 5 mars à 19h, Paul-Marie Coûteaux et Sylvain Baron sont les invités de Nicolas Stoquer, sur la chaîne YouTube de Géopolitique Profonde !
Paul-Marie Coûteaux, directeur du Nouveau conservateur, est un homme politique et essayiste français. Ancien diplomate, il est surtout connu pour être l’un des principaux théoriciens du souverainisme en France.
Sylvain Baron, journaliste engagé, revient tout juste de son périple en Ukraine, où il a plongé au cœur des zones de conflit à Zaporija et Marioupol.
Résistance à l’oppression
Le droit de résister à l’oppression ne relève pas d’un simple principe moral ou d’un idéal abstrait : il constitue une pierre angulaire de toute société réellement démocratique. L’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 le place au même rang que la liberté, la sûreté et la propriété. Il ne s’agit donc pas d’un luxe réservé aux intellectuels ou aux révolutionnaires de salon, mais d’un droit inaliénable, inscrit dans le marbre républicain. L’État, lorsqu’il viole ce pacte fondateur, perd de facto sa légitimité. Et chaque citoyen, chaque groupe, chaque portion du peuple, détient alors le devoir d’entrer en résistance.
Ce principe a été renforcé par l’article 35 de la Déclaration de 1793, qui élève l’insurrection au rang de « plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs ». Cette formulation, brutale et sans appel, repose sur une réalité politique simple : un gouvernement qui opprime, qui viole les droits, ne peut être respecté, encore moins obéi. L’obéissance à un pouvoir injuste n’est pas une vertu : c’est une trahison envers la liberté. La soumission n’est pas un acte neutre, elle entretient la perpétuation du despotisme.
En ce sens, la résistance ne nécessite pas l’unanimité du peuple. Attendre que toute la population se soulève revient à enterrer ce droit sous un formalisme paralysant. La minorité opprimée a le droit, et même le devoir, d’agir. L’idée selon laquelle les Gilets Jaunes n’étaient pas représentatifs du peuple ne tient pas : ils étaient la portion lucide d’un corps social écrasé, qui a choisi de refuser l’inacceptable. L’histoire ne donne pas raison à ceux qui se taisent, mais à ceux qui osent agir.
Le pouvoir judiciaire comme nouvel instrument de tyrannie, de persécution, de confiscation démocratique
Le procès de Marine Le Pen illustre une réalité que beaucoup refusent encore de nommer : la judiciarisation du politique est devenue l’arme privilégiée de la classe dominante pour neutraliser ses opposants. Ce n’est pas la justice qui est à l’œuvre, mais une stratégie de persécution politique. Lorsque des magistrats, souvent militants, se substituent au peuple pour décider qui a le droit de se présenter ou de s’exprimer, on assiste à un véritable coup d’État institutionnel.
Le pouvoir judiciaire, censé être indépendant, agit désormais comme un rempart idéologique contre la volonté populaire. Ce n’est plus la loi qui protège, c’est la procédure qui enferme. La multiplication des procédures contre des figures d’opposition n’a rien d’anecdotique : elle révèle une dérive systémique, un basculement vers un autoritarisme qui se cache derrière les apparences légales. La tyrannie moderne ne se présente plus sous les traits d’un dictateur, mais d’un juge en robe noire, armé d’un code de procédure pénale.
Dans ce contexte, résister n’est pas seulement légitime, c’est une question de survie politique. La démocratie ne peut se maintenir si ses opposants sont constamment criminalisés. L’insurrection redevient alors une exigence, non pas contre un État de droit, mais contre un État de contrôle. Le peuple ne doit pas seulement voter : il doit pouvoir contester, renverser, corriger. Sans cela, il ne reste qu’une démocratie fantôme, vidé de toute substance populaire.
Du tyrannicide à l’insurrection
Loin d’être une invention contemporaine, le droit à l’insurrection et même au tyrannicide est profondément enraciné dans la tradition politique européenne. Les penseurs médiévaux, les philosophes de la Renaissance, mais aussi les démocrates grecs et les révolutionnaires français ont tous affirmé que lorsque le pouvoir devient tyrannique, sa chute devient non seulement légitime, mais nécessaire. Ce droit n’est pas un fantasme révolutionnaire, c’est une arme de libération.
Dans l’Antiquité, tuer un tyran n’était pas un crime, mais un acte glorieux. Athènes, berceau de la démocratie, honorait ceux qui avaient pris les armes contre les usurpateurs. Ce n’était pas la violence qui était condamnée, mais la passivité face à la tyrannie. Le tyran était vu comme un parasite, un prédateur politique, que le peuple avait le devoir d’éliminer. Cette pensée n’a jamais disparu. Elle a simplement été enterrée sous les couches de conformisme et de soumission moderne.
Refuser de voir que l’oppression prend aujourd’hui des formes nouvelles — numériques, juridiques, institutionnelles —, c’est tourner le dos à cette mémoire insurrectionnelle. La résistance ne passe pas uniquement par la violence physique : elle peut être civile, numérique, intellectuelle, mais elle doit être ferme, totale, intransigeante. L’insurrection n’est pas un désordre passager : c’est la respiration vitale des peuples étouffés. La limiter au nom de l’ordre, c’est graver la tyrannie dans le marbre de la loi.
IMPORTANT - À lire
Plongez au cœur de l'actualité avec notre revue papier mensuelle, qui décrypte en profondeur les enjeux géopolitiques de notre époque. De la résistance à l'oppression jusqu'aux dérives du pouvoir judiciaire, nous analysons les mécanismes de la tyrannie moderne.
Chaque mois, découvrez des analyses exclusives sur les sujets brûlants qui façonnent notre monde. Notre revue papier vous offre un regard unique et engagé sur les coulisses du pouvoir, pour mieux comprendre et agir face aux défis de notre temps.