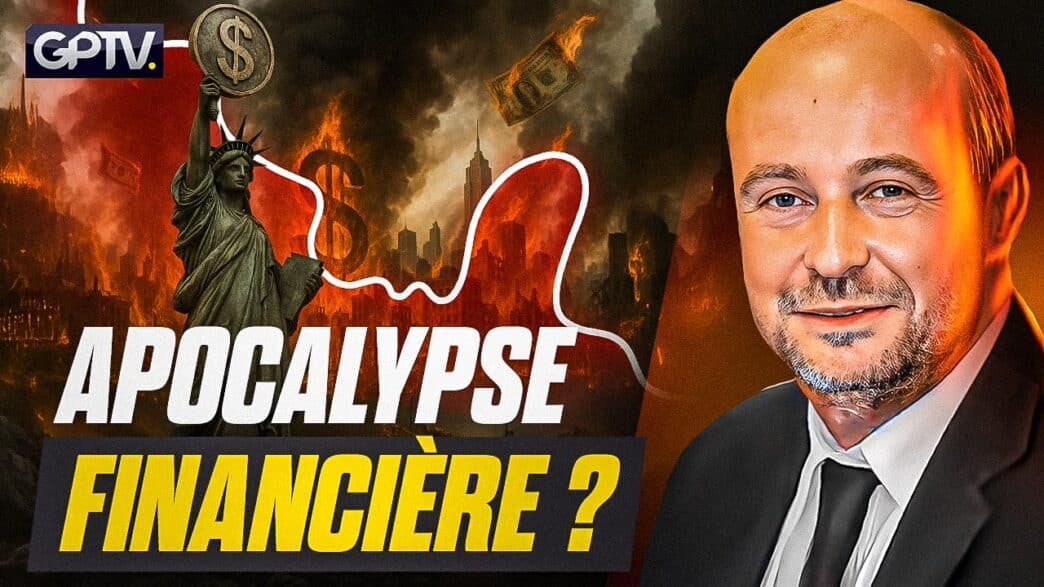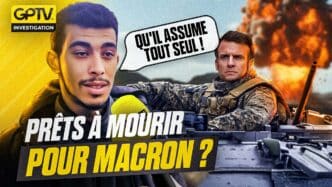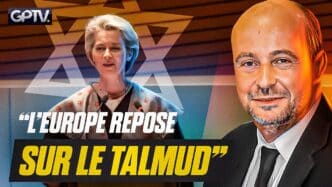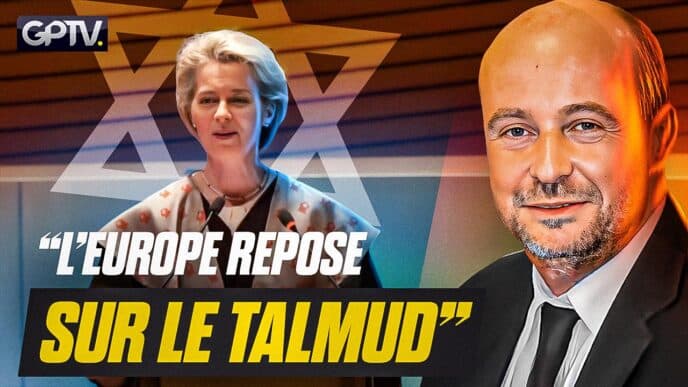Le 8 avril à 12h30, Nicolas Stoquer vous attend pour une émission sur un sujet d’actualité, en direct sur Géopolitique Profonde.
Le libre-échange, une croyance devenue religion
Le libre-échange n’est pas un simple mécanisme économique. C’est un dogme fondateur, un pilier idéologique autour duquel s’est structuré l’ordre mondial depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce principe n’a jamais reposé sur une rationalité purement économique, mais sur une croyance partagée : celle que l’interconnexion des marchés garantit la paix, la croissance et la stabilité. Cette croyance a façonné les traités, dicté les politiques, orienté les choix industriels. Elle a permis à des élites transnationales de verrouiller l’architecture du monde.
Mais aujourd’hui, ce socle se fissure. Le retour des barrières douanières, les relocalisations stratégiques, les politiques industrielles souveraines marquent la fin de l’ère globaliste. Ce n’est pas une évolution technique : c’est un effondrement symbolique. Car ce qui tombe, ce n’est pas seulement un système, c’est une foi collective. Et comme toute religion qui vacille, le doute généralisé ouvre la voie à une spirale de désintégration.
L’anticipation négative et la dynamique mimétique
L’effondrement d’un dogme déclenche une réaction en chaîne d’anticipations négatives. Le système ne s’écroule pas parce qu’il est techniquement faible, mais parce que plus personne n’y croit. Chaque acteur, en prévoyant l’effondrement, le précipite. C’est le cœur de la logique mimétique théorisée par René Girard : l’imitation des comportements dans un climat de panique alimente la montée aux extrêmes.
Dans un monde où le libre-échange est perçu comme mort, les États n’ont plus d’autre choix que l’affrontement. Les gestes protectionnistes des uns provoquent les ripostes des autres. Ce mimétisme n’est plus économique, il devient conflictuel. Et la guerre commerciale se transforme en guerre tout court. Ce scénario n’est pas spéculatif : il est en cours. Les tensions sino-américaines sur les microprocesseurs, les chaînes d’approvisionnement critiques ou les terres rares sont les premiers signes visibles de cette montée aux extrêmes.
La perte du sacré et l’explosion de la violence
Girard l’avait annoncé : la disparition du sacré, qui servait de tampon et de régulateur symbolique, libère une violence incontrôlable. Le dogme libre-échangiste, en tant que religion séculière, contenait la violence à double titre. Il la tenait à distance par le commerce, et il masquait les conflits sous le vernis de la coopération. Sa disparition lève le couvercle. Ce qui suit, c’est la guerre de tous contre tous.
Le risque d’un affrontement direct entre puissances majeures, notamment entre les États-Unis et la Chine, devient tangible. Des hausses tarifaires réciproques, des restrictions technologiques massives, des alliances économiques exclusives peuvent faire sauter les derniers verrous de la stabilité mondiale. Dans cette perspective, ce n’est pas une crise classique que nous traversons, mais une crise de croyance. Et la perte de cette croyance commune précipite le système dans une spirale auto-destructrice.
IMPORTANT - À lire
La fin du libre-échange marque un effondrement symbolique qui précipite le système dans une spirale auto-destructrice. Anticipations négatives, mimétisme conflictuel, montée aux extrêmes : les signes annonciateurs d'un affrontement direct entre puissances majeures se multiplient.
Pour approfondir l'analyse de cette crise de croyance qui ébranle l'ordre mondial, découvrez notre revue papier mensuelle. Nos experts décryptent les enjeux géopolitiques et économiques de ce bouleversement historique, pour vous aider à comprendre le monde de demain.