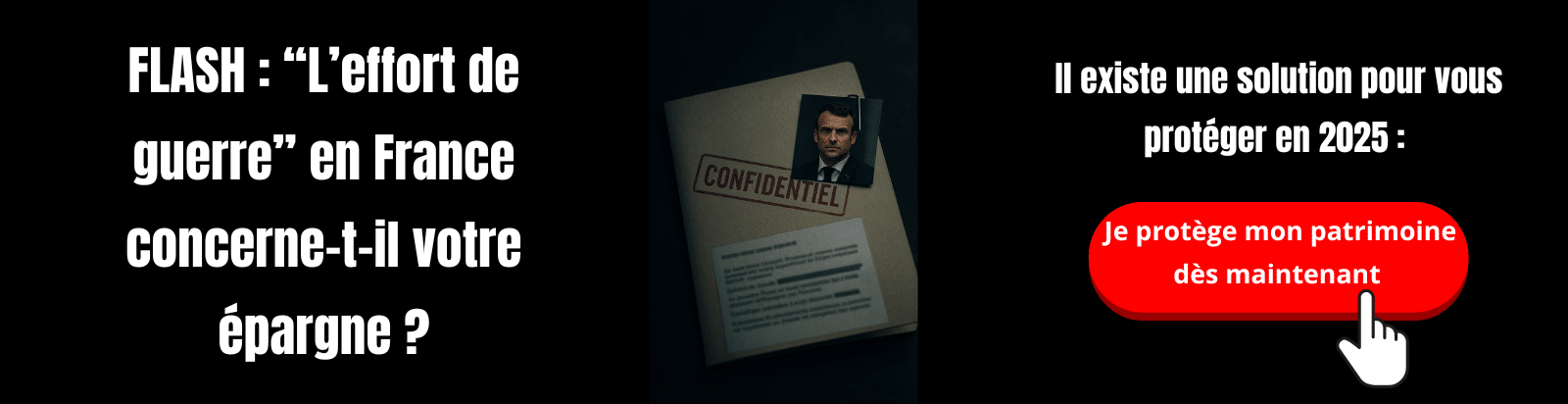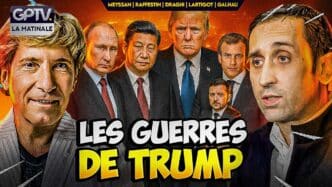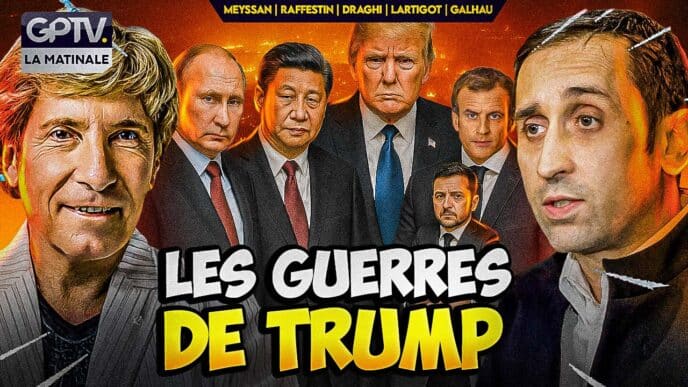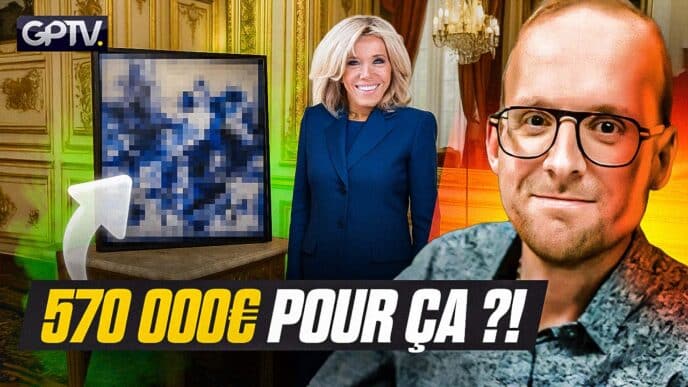🔥 Les essentiels de cette actualité
- Le retour de Donald Trump en 2025 bouleverse la dynamique du conflit ukrainien, gelant les aides militaires et poussant à des négociations directes.
- Les négociations de paix sont systématiquement sabotées par l’Occident, visant l’épuisement de la Russie plutôt que la résolution du conflit.
- Volodymyr Zelensky, symbole d’un pouvoir déconnecté, maintient une ligne dure sous influence étrangère, empêchant toute paix possible.
Le 1er mai à 19h, Vladimir Fédorovski, Philippe de Veulle et Pascal Mas sont les invités de Mike Borowski, en direct sur la chaîne YouTube de Géopolitique Profonde !
Vladimir Fédorovski est un écrivain et ancien diplomate d’origine russo-ukrainienne, naturalisé français. Il a été porte-parole de la perestroïka sous Mikhaïl Gorbatchev avant de s’exiler en France au début des années 1990. Depuis, il s’est fait connaître comme auteur de nombreux ouvrages mêlant histoire, politique et récits intimes sur la Russie et ses dirigeants.
Philippe de Veulle est un avocat au barreau de Paris, docteur en droit, diplômé du Centre d’Etudes Diplomatiques et Stratégiques (CEDS) et de l’Université Paris Descartes. Il est spécialisé dans le droit et le contentieux des affaires, le droit international et le droit pénal financier.
Pascal Mas est un expert des dynamiques de pouvoir entre les grandes puissances et s’intéresse particulièrement aux stratégies de résilience des nations face aux pressions extérieures. Il axe ses analyses sur la défense et la souveraineté nationale, avec un accent sur la Russie, qu’il considère comme un modèle de résistance aux influences occidentales.
Trump change la donne stratégique
Le retour de Donald Trump à la présidence américaine en janvier 2025 a immédiatement bousculé la dynamique du conflit ukrainien. Contrairement à Joe Biden, Trump ne s’embarrasse pas de discours humanitaires ou de justifications idéologiques. Pour lui, l’Ukraine est un gouffre financier et une distraction dangereuse. Dès son arrivée, il a gelé certaines aides militaires et exigé une révision complète des engagements américains. Ce réalignement brutal a choqué les alliés européens, pris au dépourvu par l’abandon progressif de Kiev. Le soutien inconditionnel à l’Ukraine appartient désormais au passé.
Trump considère que cette guerre n’a aucun intérêt pour les États-Unis. Il veut en finir avec les aventures militaires coûteuses, fidèle à son credo « America First ». Les diplomates de son administration s’activent pour pousser à des négociations directes entre Kiev et Moscou. Ce retrait en cours bouleverse l’équilibre du conflit et met à nu la dépendance totale de l’Ukraine à l’égard du soutien occidental. L’illusion d’une victoire occidentale s’effondre.
Le message envoyé est clair : l’Amérique ne mourra pas pour l’Ukraine. Ce revirement provoque des remous au sein de l’OTAN. Plusieurs pays européens, jusqu’ici alignés, commencent à envisager des voies alternatives, voire des médiations. La pression monte pour relancer les négociations, mais le blocage persiste du côté de Kiev, qui refuse toujours tout compromis territorial. Pourtant, sans le parapluie américain, le régime ukrainien devient extrêmement vulnérable.
L’agenda de Trump est guidé par la froideur stratégique. Il veut négocier avec Poutine, rétablir une forme de stabilité et se concentrer sur la rivalité avec la Chine. L’Ukraine devient une monnaie d’échange dans un jeu diplomatique plus large. Les élites de Washington qui misaient sur une guerre longue voient leur stratégie balayée. La rupture est consommée, et la réalité géopolitique s’impose.
Le sabotage occidental des négociations
Le refus de la paix ne vient pas de Moscou, mais du camp occidental. Dès 2022, les négociations d’Istanbul auraient pu aboutir à un cessez-le-feu durable. Kiev et Moscou étaient proches d’un accord. Mais Londres, Berlin et surtout Washington ont imposé le retrait des pourparlers. L’objectif n’était pas la paix, mais l’épuisement de la Russie. Chaque tentative de dialogue a été systématiquement torpillée par les conseillers de Zelensky, eux-mêmes connectés aux cercles du renseignement atlantiste.
Les États-Unis et leurs alliés ont saboté les discussions car ils parient sur une guerre d’usure. Ils espèrent que la pression militaire et économique fera craquer Moscou. Mais cette stratégie a échoué. L’économie russe tient, l’armée avance, et les pertes ukrainiennes sont catastrophiques. Malgré cela, aucune révision de ligne n’est tolérée. Toute voix divergente est écartée ou diabolisée. La paix est devenue un mot tabou, un acte de trahison aux yeux du pouvoir occidental. Le discours de guerre est verrouillé.
Les médias, les ONG, les think tanks sont tous mobilisés pour entretenir la fiction d’une guerre juste, inévitable, noble. Les morts s’accumulent, mais les discours restent figés. Les diplomaties européennes sont réduites au silence. Les rares personnalités appelant à la désescalade sont marginalisées. Le champ politique est contaminé par l’idéologie du conflit. Aucune issue diplomatique n’est sérieusement explorée.
Zelensky, symbole d’un pouvoir déconnecté
Volodymyr Zelensky ne gouverne plus qu’à travers un régime d’exception. Son mandat présidentiel est expiré, mais il continue à se maintenir au pouvoir en invoquant la guerre. Il n’y a pas d’élections prévues, aucune consultation populaire, aucun contre-pouvoir. La démocratie ukrainienne est suspendue, remplacée par une présidence autoritaire soutenue par l’Occident. Les médias sont contrôlés, les partis d’opposition interdits, les voix dissidentes poursuivies ou exilées.
Zelensky continue de refuser toute négociation, même dans un contexte militaire défavorable. Il maintient une ligne dure, non par conviction, mais parce que sa survie politique en dépend. Il n’a plus d’espace de manœuvre. Ses décisions sont dictées par ses alliés étrangers, par les réseaux atlantistes qui l’ont placé au cœur de cette guerre. Loin de représenter son peuple, il devient le garant d’une stratégie étrangère. Sa légitimité s’effondre au rythme des pertes humaines.
Dans le pays, la fatigue est immense. Les mobilisations militaires s’intensifient, les désertions augmentent, la population doute. De plus en plus de soldats refusent de partir au front. Le mythe du héros de 2022 est brisé. Zelensky n’incarne plus l’unité nationale, mais la poursuite aveugle d’un conflit devenu absurde. L’Ukraine s’épuise, pendant que son président récite un scénario dicté d’ailleurs.
Aucune paix ne sera possible tant que Zelensky sera au pouvoir. Il est désormais un obstacle, non un acteur de la paix. Son éviction devient une condition préalable à tout règlement sérieux du conflit. Les forces qui l’ont soutenu le savent. Elles préparent déjà son remplacement, dans l’ombre, pour éviter un effondrement total du régime. La chute du pouvoir ukrainien est désormais une question de temps.
IMPORTANT - À lire
Vous voulez aller plus loin dans la compréhension des enjeux géopolitiques autour du conflit ukrainien ? Notre revue papier approfondit chaque mois l'analyse des stratégies des grandes puissances, des jeux d'influence et des scénarios possibles. De l'impact du retour de Trump à la Maison Blanche aux manœuvres diplomatiques en coulisses, nous décryptons les dessous de cette crise majeure.
Zelensky, Poutine, Xi Jinping... Nous analysons les profils et les motivations des acteurs clés, ainsi que les rapports de force sur le terrain et dans les chancelleries. Notre revue vous donne les clés pour anticiper les évolutions et les conséquences de ce conflit qui bouleverse l'ordre mondial. Abonnez-vous dès maintenant pour recevoir chaque mois une analyse pointue et exclusive.