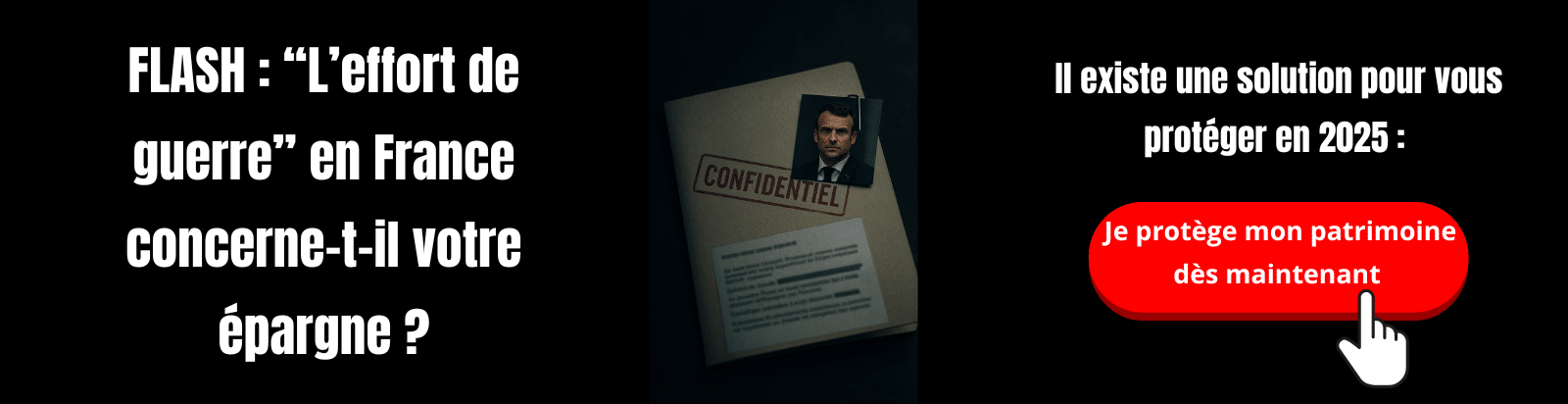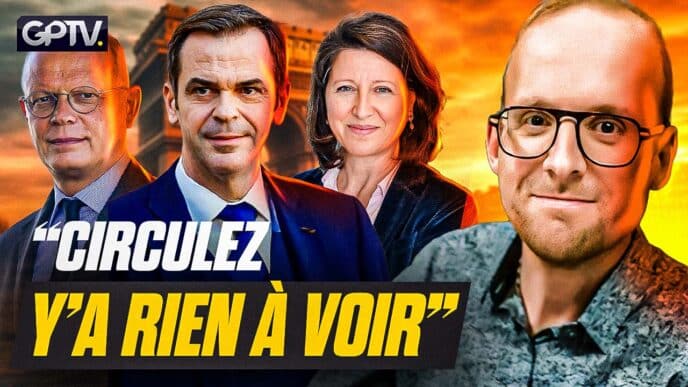🔥 Les essentiels de cette actualité
- Découvrez l’analyse de Oskar Freysinger, Laurent Henninger et Nicolas Dupont-Aignan sur la stratégie de Trump, entre messianisme et impérialisme.
- Trump navigue entre confrontation et retrait, illustré par son dernier coup de force anti-Poutine avec des sanctions jusqu’à 500 % sur le pétrole russe.
- L’Amérique de Trump admet ses limites, passant d’un ordre mondial à une forteresse nationale, malgré les voix interventionnistes comme celle du général Jack Keane.
- L’Europe, face à cette recomposition, finance la guerre en Ukraine avec 100 milliards d’euros supplémentaires, sacrifiant ses propres besoins.
Le 10 juillet à 7h, Oskar Freysinger, Laurent Henninger et Nicolas Dupont-Aignan sont les invités de Nicolas Stoquer, en direct dans La Matinale de Géopolitique Profonde !
Oskar Freysinger est un homme politique suisse, ancien vice-président de l’UDC (Union Démocratique du Centre) et ex-élu au parlement suisse. Il a également exercé la fonction de Secrétaire d’État. Aujourd’hui, il se consacre à l’écriture, la traduction et partage ses analyses en tant que chroniqueur.
Laurent Henninger, historien, est chargé d’études à la Revue « Défense Nationale » . Il est membre du comité de rédaction de Guerres et Histoire , et a collaboré au Dictionnaire de stratégie.
Nicolas Dupont-Aignan est un homme politique français, président de Debout la France, un parti qui se réclame du gaullisme et du souverainisme. Député de l’Essonne de 1997 à 2024, élections lors desquelles il a perdu son siège, il a été candidat aux élections présidentielles de 2012, 2017 et 2022. Il est connu pour ses critiques de l’Union européenne, de l’euro et de l’immigration.
Trump, entre messianisme américain et impérialisme pragmatique
Trump avance en zigzag, mais son cap idéologique reste lisible. Derrière les volte-faces apparentes – vis-à-vis de la Russie, de l’Iran, d’Israël – se dessine un fond doctrinal clair : préserver la suprématie américaine tout en refusant les engagements prolongés. C’est un messianisme de circonstance, réduit à sa fonction instrumentale : frapper quand il faut, se retirer quand cela coûte. Ce n’est plus l’idéalisme néoconservateur des années Bush, mais une projection de force calculée, souvent brutale, toujours centrée sur les intérêts immédiats des États-Unis.
Le dernier revirement anti-Poutine en est l’exemple. Trump, longtemps ambigu vis-à-vis de Moscou, a qualifié les déclarations du président russe de « bullshit » et envisagé de soutenir un projet de loi bipartisan imposant des sanctions d’une brutalité inédite : jusqu’à 500 % de droits de douane sur les importations de pétrole russe. Ce coup de tonnerre a été salué par plusieurs sénateurs républicains, habituellement divisés. John Cornyn a évoqué un « bras d’honneur » de Poutine, Lindsey Graham a annoncé l’imminence d’une action sénatoriale. Trump montre qu’il peut basculer dans la confrontation si cela sert ses intérêts politiques et renforce son image de leader inflexible.
L’illusion impériale confrontée à la réalité matérielle
Le retour du trumpisme met à nu les limites concrètes de l’empire américain. L’Amérique ne peut plus tout faire, partout, tout le temps. Sa base industrielle est affaiblie, son opinion publique fatiguée des guerres, son armée saturée d’opérations extérieures. Trump incarne cette prise de conscience : il ne s’agit plus d’imposer un ordre mondial, mais de défendre une forteresse nationale. Le slogan « America First » ne vise pas seulement à galvaniser les foules : il acte une transition stratégique.
Mais cette stratégie se heurte à des voix militaires influentes comme celle du général Jack Keane. L’ancien vice-chef d’état-major prône un retour pur et simple aux politiques interventionnistes de Biden. Selon lui, seule une victoire militaire claire en Ukraine peut faire plier Poutine, les sanctions économiques n’étant plus dissuasives. Keane défend une ligne offensive, presque maximaliste, à rebours de la prudence trumpienne. Cette tension révèle une fracture au cœur même de l’appareil sécuritaire américain : entre une vision réaliste des capacités nationales et une volonté d’écraser la Russie coûte que coûte.
L’Europe : verbe haut, bras cassés
Face à cette recomposition brutale de la stratégie américaine, l’Europe s’enfonce dans son illusion d’influence. Le discours est global, les moyens dérisoires. Alors que Trump hésite, ralentit ou freine, l’Union européenne s’apprête à jeter 100 milliards d’euros supplémentaires dans la guerre en Ukraine, à travers son budget 2028-2034. Ce chiffre vertigineux marque un basculement du fardeau stratégique : Washington temporise, Bruxelles paie. À l’euro près, les Européens sacrifient hôpitaux, agriculture et cohésion sociale pour financer une guerre par procuration.
Depuis 2022, l’UE a déjà déboursé 160 milliards. Elle n’aide plus ses citoyens, elle subventionne un conflit sans fin. Cette redistribution du budget communautaire signe une Europe otage de ses postures géopolitiques. Au même moment, le directeur de la DGSE, Nicolas Lerner, reconnaît que la Russie déploie une guerre hybride d’une ampleur inquiétante : espionnage, cyber, désinformation. Mais aucune réponse structurelle n’émerge. L’Europe dénonce, l’Europe paie, mais l’Europe ne protège pas.
IMPORTANT - À lire
Vous souhaitez approfondir les analyses de Trump, Poutine et l'Europe ? Chaque mois, notre revue papier décrypte en profondeur les enjeux géopolitiques mondiaux. Des experts reconnus comme Oskar Freysinger, Laurent Henninger et Nicolas Dupont-Aignan partagent leur vision sur les grands défis actuels.
Plongez au cœur des coulisses du pouvoir avec nos dossiers exclusifs. Découvrez les stratégies des dirigeants, les rapports de force entre les nations et les conséquences pour notre avenir. Notre revue vous offre des clés de compréhension uniques pour mieux saisir un monde en pleine mutation.